Un film de Max Ophüls
 Pour son premier film en couleurs, qui se révèlera aussi son dernier, Ophüls choisit d'illustrer la vie tumultueuse de Lola Montès, fameuse courtisane et danseuse provocatrice.
Pour son premier film en couleurs, qui se révèlera aussi son dernier, Ophüls choisit d'illustrer la vie tumultueuse de Lola Montès, fameuse courtisane et danseuse provocatrice.
Depuis que Gaumont avait sorti son coffret Ophüls, ce film me faisait de l'oeil. Les quelques images dévoilées lors de sa ressortie en salle, en septembbre 2009, étaient intrigantes : les teintes de couleurs, éclatantes et oniriques, préfigurent Moulin Rouge ! (Baz Lurhmann, 2001), le vrai format Cinémascope des début (de ratio 2.55 : 1) semble offrir un spectacle total. Et, surprise, il était diffusé par Arte, en HD, à la mi-novembre.
Le rideau s'ouvre sur une personnalité cassée, comme extérieure à elle-même, dont le principe de vie semble être d'enchaîner les conquêtes en donnant à chacune un temps limité qu'elle décide, au jour le jour. Dans un cirque, où Monsieur Loyal n'est autre que Peter Ustinov (impérial, en français dans le texte), Lola Montès raconte en spectacle sa propre vie, dans laquelle elle n'est plus qu'une attraction ; l'attraction principale certes, mais mue par une curiosité voyeuriste et malsaine, Lola s'exposant tel un animal de foire. La première séquence en flash-back la montre avec Franz Liszt, pour la dernière scène de leur vie commune (qu'on imagnie courte) : les adieux de Lola, sans pleurs ni sentiments survoltés ; tout juste peut-on lire sur le visage de Lola une mélancolie triste, qui semble chronique. Elle donne l'impression de souffrir sa vie, la subir, plutôt que d'en décider chaque mouvement comme on pourrait le croire.
Comment penser, en effet, qu'elle choisit de se produire dans un cirque, dans une mise en scène superficielle,mais spectaculaire, de sa vie ? Son envie d'être danseuse, alors qu'elle n'était manifestement pas très douée dans ce domaine, pourrait expliquer sa volonté. Elle qui fut la maîtresse du roi de Bavière (Anton Walbrook, le fiévreux imprésario de Vicki Page dans Les chaussons rouges) sombrera plus bas que terre, dans une belle mise en abîme du processus filmique. La pénombre du cirque renvoie à la lumière des flash-backs, leur donnant un air onirique. Les couleurs sont irréelles, Lola déambule dans des décors gigantesques d'un faste indécent ; mais elle est comme le fantôme d'elle-même. Ce manque d'incarnation est tout de même bien embêtant, enlevant la force d'un récit autrement placé sous le signe de la tragédie. Est-ce le tort de Martine Carol (Lola) seule ? Non, le tout manque juste de vie. C'est dommage lorsque c'est justement celle, exceptionnelle, atypique, d'une femme ayant marqué son temps, se comportant comme un homme, décidant et exigeant.
 Un ogre bougon tout vert, accompagné d’un âne farceur, doit sauver une princesse en détresse pour retrouver le droit de propriété de son marais. Mais les sentiments s’en mêlent…
Un ogre bougon tout vert, accompagné d’un âne farceur, doit sauver une princesse en détresse pour retrouver le droit de propriété de son marais. Mais les sentiments s’en mêlent…
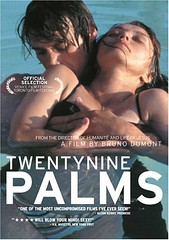 Le choc. La crise. Les larmes, la terreur, lors de la découverte de ce film au cinéma il y a queslques années, qui résonne encore aujourd’hui. Ce film, l’histoire d’un couple hors normes (un américain et une russe) est un dépassement, un exploit, une prouesse. Surpassant le clivage si facile des genres, Bruno Dumont réussit à embrasser toutes les ambiances dans ce road-movie indie. Une trame minimaliste, forte, lourde, fabuleusement visuelle. Une histoire régressive entre deux personnes trop proches dans ce désert pour une fois vraiment (désert).
Le choc. La crise. Les larmes, la terreur, lors de la découverte de ce film au cinéma il y a queslques années, qui résonne encore aujourd’hui. Ce film, l’histoire d’un couple hors normes (un américain et une russe) est un dépassement, un exploit, une prouesse. Surpassant le clivage si facile des genres, Bruno Dumont réussit à embrasser toutes les ambiances dans ce road-movie indie. Une trame minimaliste, forte, lourde, fabuleusement visuelle. Une histoire régressive entre deux personnes trop proches dans ce désert pour une fois vraiment (désert). 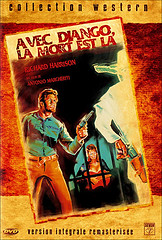 Aussi appelé Vengeance, ce titre, signé par Margheriti sous le pseudo de Anthony Dawson, embraye le pas au Django originel de Sergio Corbucci. Sa parenté avec ce dernier doit être levée, fruit de la traduction française ; le héros de Vengeance s'appelant Joko (on voit d'ailleurs ses initiales sur sa valise). Dans d'autres pays, il sera nommé Rocco ou Roko. Il s'agit donc d'un faux Django parmi d'autres, légion après le succès du film de Corbucci. Dans le rôle de Joko, Richard Harrison joue lui aussi un double de Clint Eastwood dans les films de Leone, le modèle entre tous, comme Franco Nero dans Django. Ce dernier avait malgré tout un charisme bien supérieur à Harrison, qui n'a que la barbe naissante, la peau basanée et un costume de cuir pour rivaliser : c'est maigre, mais déjà ça. Un des personnages principaux de l'intrigue n'est autre que Claudio Camaso, le frère de Gian Maria Volonte (il entretient une ressemblance certaines avec son parent). On essaye ici de trousser un double d'un autre film, les éternelles sources d'inspiration étant Corbucci et Sergio Leone.
Aussi appelé Vengeance, ce titre, signé par Margheriti sous le pseudo de Anthony Dawson, embraye le pas au Django originel de Sergio Corbucci. Sa parenté avec ce dernier doit être levée, fruit de la traduction française ; le héros de Vengeance s'appelant Joko (on voit d'ailleurs ses initiales sur sa valise). Dans d'autres pays, il sera nommé Rocco ou Roko. Il s'agit donc d'un faux Django parmi d'autres, légion après le succès du film de Corbucci. Dans le rôle de Joko, Richard Harrison joue lui aussi un double de Clint Eastwood dans les films de Leone, le modèle entre tous, comme Franco Nero dans Django. Ce dernier avait malgré tout un charisme bien supérieur à Harrison, qui n'a que la barbe naissante, la peau basanée et un costume de cuir pour rivaliser : c'est maigre, mais déjà ça. Un des personnages principaux de l'intrigue n'est autre que Claudio Camaso, le frère de Gian Maria Volonte (il entretient une ressemblance certaines avec son parent). On essaye ici de trousser un double d'un autre film, les éternelles sources d'inspiration étant Corbucci et Sergio Leone.