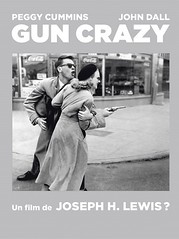Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique :
road movie
-
Gun Crazy - Le démon des armes (1950)
-
Twentynine palms (2003)
Un film de Bruno Dumont
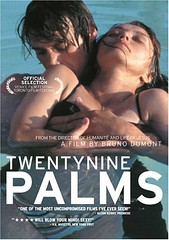 Le choc. La crise. Les larmes, la terreur, lors de la découverte de ce film au cinéma il y a queslques années, qui résonne encore aujourd’hui. Ce film, l’histoire d’un couple hors normes (un américain et une russe) est un dépassement, un exploit, une prouesse. Surpassant le clivage si facile des genres, Bruno Dumont réussit à embrasser toutes les ambiances dans ce road-movie indie. Une trame minimaliste, forte, lourde, fabuleusement visuelle. Une histoire régressive entre deux personnes trop proches dans ce désert pour une fois vraiment (désert).
Le choc. La crise. Les larmes, la terreur, lors de la découverte de ce film au cinéma il y a queslques années, qui résonne encore aujourd’hui. Ce film, l’histoire d’un couple hors normes (un américain et une russe) est un dépassement, un exploit, une prouesse. Surpassant le clivage si facile des genres, Bruno Dumont réussit à embrasser toutes les ambiances dans ce road-movie indie. Une trame minimaliste, forte, lourde, fabuleusement visuelle. Une histoire régressive entre deux personnes trop proches dans ce désert pour une fois vraiment (désert).
Bruno Dumont signe un terrible essai sur la communication, cet outil vital pour co-exister. La communication orale n’est plus d’actualité entre les deux tourtereaux quand la langue est trop différente. Dès lors, c’est sur un plan essentiellement sexuel que s’aborde la communication entre les deux individus, seul plan fusionnel ; les autres sont tous source de conflits, légers ou parfois plus durs. L’incompréhension qui régit l’essentiel des rapports entre les deux personnages est aussi culturelle : voir la scène de la cafétéria où Katia reproche à David de regarder une autre fille ; elle lui dit sans sourciller "tu peux aller avec elle si tu veux". Des incompréhensions ce film bizarre, insoutenable, beau de façon si étouffante, en regorge. Cette relation exclusive, est déséquilibrée dans son rapport excessif à la sexualité, seul terrain d’expression où les deux amants excellent. David, colérique, impulsif, ne vit pas sur la même planète que Katia, naïve, "étrangère", et pourtant a l’air de vivre une histoire belle et simple. Mais rien n’est vraiment simple quand on parle de passion, d’exclusivité. La communication bancale dont font preuve les deux amoureux est pointée comme un manque vital.
Extrême, brutale, cette histoire d’un autre temps où les moments les plus significatifs sont des joutes de grognements bestiaux nous montrent tels que nous pourrions être : des animaux (légèrement) civilisés. Mais grattez le vernis social déjà écaillé et vous y verrez peut-être l’ombre de Twentynine Palms… -
Buffalo'66 (1999)
Un film de Vincent Gallo
 Premier long métrage remarquable, Buffalo’66 est une bouffée d’oxygène à répétition, tant de multiples visions n’entachent jamais l’impression euphorique de la prime fois.
Premier long métrage remarquable, Buffalo’66 est une bouffée d’oxygène à répétition, tant de multiples visions n’entachent jamais l’impression euphorique de la prime fois.
Touchant, le film l’est autant que son interprète principal, Vincent Gallo, chef d’orchestre du projet -scénariste, compositeur, producteur en sus de la réalisation, il renforcera encore son contrôle sur le film avec son dernier en date, Brown Bunny, qu’a édité Potemkine en mars dernier. Il arrive à nous rendre proche et tendre l’itinéraire de ce paumé tout juste sorti de prison, qui kidnappe aussitôt une jeune fille, Layla (Christina Ricci, excellente) visiblement aussi perdue que lui. Malgré la violence psychologique qu’impose Billy (Gallo) à Layla, une connexion s’opère, à la fois entre les deux personnages, et entre le spectateur et les acteurs. Différents, en rupture avec les codes sociaux établis, le duo forcé ainsi formé va rencontrer, avec son regard distancié (que le spectateur épouse), le cercle de connaissance de Billy Brown (Vincent Gallo).
Gallo a sûrement des comptes à régler avec ses parents, tant la visite de Billy chez eux, en compagnie de Layla, offre un décalage ahurissant. Entre une mère fan de football américain à la limite de l’autisme, et un père psychologiquement absent, chanteur raté et obsédé sexuel sur les bords, la séquence du repas est un monument de comédie décalée et délicieusement effrayante. Du même coup, Billy passe alors d’une brute un brin folklo (les chaussures rouges !) au personnage le plus équilibré de la pièce, après Layla.
Le coup de fil au pote d’enfance relèvera de la même dynamique, haussant toujours d’un cran la position d’un Billy Brown pas aidé dès le départ. Ce tour d’horizon des connaissances ne saurait être complet sans un passage au bowling d’enfance de Billy, là encore théâtre d’une séquence au décalage consommé. Champion dès son plus jeune âge, Billy enchaîne les strikes en poussant des cris de victoire, bien que peu enthousiastes, jouant avec / contre lui-même. Comme s’il constatait qu’après ces années passées derrière les barreaux -pour quelqu’un d’autre, soit dit en passant-, rien n’avait changé, pas même lui ; la rage intérieure qui le consume se dirige également vers la personne responsable de son emprisonnement, qu’il veut faire payer. La séquence du bowling offre aussi un beau moment à Christina Ricci qui, pour tuer l’ennui, se paye un numéro de claquettes dans son univers mental (les lumières s’éteignent pour la laisser seule dans un halo ouaté), écho au rêve éveillé du père qui lui a précédemment fait écouter un disque de son (unique ?) succès. Des touches de fantaisies parsèment ainsi joyeusement un univers étrangement beau (les banlieues résidentielles, esthétiquement pauvres, sont filmées à l’aide plans fixes très composés), cernant les personnages dans des gros plans d’une puissance naturelle et rare. Gallo a l’œil d’un photographe, inventant un défilé de belles images sans être pour autant artificielles ; le jeu sur le flou notamment, utilisé pour les arrières plans, opposé à une netteté pointue et vibrante, offre un contrepoint visuellement frappant, tout en étant rempli de sens. Il isole les personnages dans une bulle de réalité qui leur est propre, inadaptés au monde qui veulent se protéger du reste.
Buffalo’66 reste aujourd’hui encore une petite île de bonheur, un des rares films que l’on veut absolument voir se solder par un happy end : ces deux-là le méritent bien. Et l’on dira ce qu’on veut de Vincent Gallo, il a su faire avec ce film une réussite totale et entière, sans aucune fausse note, qu’un parfum d’authenticité parcoure de long en large. -
La Route (2009)
Un film de John Hillcoat
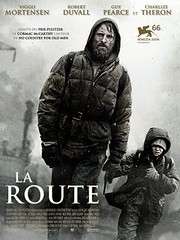 Doté d’un titre simple, court et sans connotation si ce n’est une annonce de road-movie, La route est, de même, un film âpre, dont la brutalité vous saute à la gorge dès les premiers instants. On nous montre l’errance d’un père et son fils, tentant de survivre sur les ruines du monde, menacés par des gangs cannibales sillonnant un paysage désertique.
Doté d’un titre simple, court et sans connotation si ce n’est une annonce de road-movie, La route est, de même, un film âpre, dont la brutalité vous saute à la gorge dès les premiers instants. On nous montre l’errance d’un père et son fils, tentant de survivre sur les ruines du monde, menacés par des gangs cannibales sillonnant un paysage désertique.Même si les films post-apocalyptiques commencent à se multiplier en ce début de vingt-et-unième siècle, rien n’est semblable à cette Route, qui fait ressembler les humains à des individus déjà morts, au teint terreux, et rapprochent le film d’un fantastique très marqué par le thème des morts-vivants. Allant ceci dit bien plus loin, le film ose montrer ses personnages en vrais SDF, tant par leur nature sédentaire et instable, que par leur apparence (amoncelant les couches de vêtements, devant se couvrir de sacs plastiques, manger tout ce qu’ils trouvent, ...). Tout cela, car la vie n’est plus ce qu’elle était : c’est de survie qu’il est désormais question, pour tout le monde. La peur est un pain quotidien et pousse le père (Viggo Mortensen, cadavre magnifique) à des actes terribles au nom de sa protection et, plus important, de celle de son fils. Paradoxalement, il tient dur comme fer à se revendiquer du clan des gentils, comme il le répètera à maintes reprises au fiston ; pour le spectateur cependant, la distinction n’est pas si commode, quand parfois elle n’a même plus lieu d’être. La correction que va infliger le père à un pauvre ère comme lui, ayant dérober leurs affaires laisse froid dans le dos. Elle est néanmoins le fruit de cette peur dont les personnages ne peuvent plus se défaire.
L’univers détruit et sans vie est rendu avec une belle force, les plans d’ensemble laissant voir la terre désolée, aride et vidée, où tout est mort, y compris toutes forme végétale. Les teintes désaturées, désespérément grisâtres, sur lesquels les personnages ne sont plus que masques de mort grimaçant, dessinent la morne survie qui attend tous ceux encore en vie ; elles tranchent avec les couleurs des quelques flash-backs du père, aux couleurs chaudes, offrant le rêve d’un monde semblant totalement étranger à celui-là. Les causes du cataclysme ne seront pas évoquées, mais là n’est pas l’intérêt : c’est là, cela s’est passé, il faut faire avec. C’est le choix que n’a pas pu faire la femme (Charlize Theron), et qui scelle à mon sens la destinée du duo père/fils ; si la mère avait pu rester avec eux, ils auraient peut-être pu mieux vivre toutes leurs horribles péripéties. Car La route est aussi un film d’horreur, la séquence dite de la cave répondant aux canons du genre, rappelant les canons des films de zombies. L’homme y est un loup pour l’homme, comme depuis la nuit des temps, mais d’une façon bien plus animale et directe que celle à laquelle on ne s’habitue toujours pas aujourd’hui. Comme pourra le dire le père, l’humanité a disparu.
Traumatisant, le film l’est à plus d’un titre, tout comme doit l’être le roman de Cormac McCarthy dont il est tiré. Réussi, on peut l’avancer sans peine, tant l’oppression et l’horreur sont constamment prégnantes. Ce qui m’a le plus terrorisé, c’est au moment où je me suis dit : à partir de quand le monde du film va devenir notre monde ? Et c’est, je vous le garantis, la pire pensée probable que le film nous assène, comme un coup de poignard entre les omoplates.
-
Bonnie & Clyde (1967)
Un film d'Arthur Penn

La sortie de Public Enemies (Michael Mann) m’a décidé à enfin découvrir le Bonnie & Clyde d’Arthur Penn, tant certains aspects me semblaient similaires entre les deux films (j’espérais ainsi voir un film très réussi, au contraire de celui de Mann, surévalué comme à l’accoutumée).
Film choc, film du changement (une des amorces du Nouvel Hollywood), Bonnie & Clyde marque dans plusieurs camps : film de gangsters (et film noir), road movie, romance ; de ces trois dimensions, présentes quasi à égalité dans le film, on ressent surtout la dernière, pleine de contrariétés (malgré des "préliminaires" suggestifs, Clyde reste prostré et semble impuissant) et d’un élan romanesque significatif. Clyde a déjà de la prison au compteur quand il rencontre Bonnie Parker, fille de riche qui s’ennuie. C’est l’amour fou en un instant, en même temps qu’une pulsion de mort, destructrice.
Au rayon film de gangsters, le film offre des fusillades tonitruantes (ils ne comptent pas leurs balles), mais surprend à plusieurs reprises par les coups manqués du duo. En effet, certains plans de Clyde se soldent par une banque en faillite, et jamais il ne s’en sort avec de gros butins. La philosophie de Clyde n’est d’ailleurs pas celle du gros-coup-qui-pourra-le-mettre-à-l’abris-du-besoin, comme on pourrait le croire quand l’alliance commence. Ainsi, quand Bonnie en a assez et voudrait tout arrêter, elle demande à Clyde ce qu’il ferait si toute l’ardoise était effacée. Et Clyde de mettre au point une nouvelle stratégie... toujours pour braquer des banques. C’est un véritable mode de vie pour Barrow. Il a néanmoins bon fond (notez que Public Enemies reprend in extenso un échange de paroles entre Clyde et un épargnant à la banque, quand il lui dit "Range ton argent, c’est la banque qu’on vole, [pas toi]." L’hommage va un peu loin, et Mann pousse le vice à l’intégrer dans sa bande-annonce ! Bref. Mais le parcours de Bonnie & Clyde se voit aussi comme une fuite en avant.
Car le film est également un road-movie dans sa plus pure expression. Traversant les états pour ne plus être poursuivis, le gang Barrow, désormais enrichi d’un pompiste, du frère et de la belle-sœur de Barrow, fait les 400 coups. La réalisation épouse cette cavalcade effrénée, Penn filmant souvent les acteurs cheveux au vent, libres mais toujours dans l’urgence. De même, l’enivrante course contre le temps des bandits est accompagnée d’une multitude de cris (de joie, de peur) assourdissants et d’une musique country, totalement inhabituelle dans le genre, qui souligne cette folle danse d’amour et de mort. Public enemies reprend également cette musique à son compte, mais d’une façon beaucoup moins naturelle : la répétition inlassable du même morceau, calé sur les images sans (a)ménagenent, brute, souligne un côté fabriqué.
Enfin, malgré qu’il s’agisse d’un film d’époque, le film ne peut faire abstraction d’une peinture mentale de la fin des années 60 : l’assassinat de JFK, qui a traumatisé toute l’Amérique, occupe les moments les plus violents du film :on y voit un homme recevoir une balle dans la tête en gros plan, plutôt rare à cette époque, l’hémoglobine coule de ses gros flots rouges, et le frère de Clyde (joué par Gene Hackman) connaîtra une fin qui ressemble à s’y méprendre à celle du président américain. La séquence finale, clôturant le film dans une apothéose de violence, symbolise l’éclatement d’un système qui est conscient de sa fin, tel celui des studios de cinéma américain. En effet, Bonnie & Clyde marque aussi un point de non-retour, ouvrant la voie aux jeunes réalisateurs inspirés par le cinéma européen : pour une nouvelle façon de faire des films.Source image : capture dvd Warner Bros.