Un film de Sam Liu & Lauren Montgomery
 Les films animés de DC Comics n'étaient pas, avant le milieu des années 2000, adaptés littéralement de récits pré-existants. Ainsi, les excellents Batman contre le fantôme masqué ou encore Batman beyond : le retour du Joker sont des créations originales piochant dans la mythologie du justicier masqué. Avec la naissance de la collection DC Universe Animated Original Movies en juillet 2006, l'objectif est de transposer, sous formes de films d'animation destinés au marché de la vidéo, les comics qui ont fait l'histoire de la maison d'édition. Il s'agit d'une initiative conjointe de DC, Warner Bros. et Bruce Timm entre autres, à qui l'on doit l'inestimable Batman : la série animée. Sont ainsi portés à l'écran Superman : Doomsday d'après l'arc La mort de Superman, Justice League : New Frontier d'après la BD de Darwyn Cooke, deux titres qui remportent un vif succès. Les films s'enchaînent rapidement, montrant souvent une adaptation fidèle du matériau d'origine, notamment le très bon Batman et Red Hood : sous le masque rouge (Brandon Vietti, 2010). Batman : Year One calque donc sa trame sur le récit de Frank Miller (au scénario) et David Mazzucchelli (au dessin). Un retour aux origines permettant de voir les débuts d'un fringant Bruce Wayne de 25 ans, combattant le crime dans une Gotham City dominée par la mafia et les flics ripoux. Son apprentissage se déroule en parallèle de la trajectoire du lieutenant James Gordon, débarquant aussi fraîchement à Gotham. La BD fut créé après le coup d'éclat de Frank Miller en 1985, The Dark Knight Returns (ressorti ces jours-ci chez Urban Comics avec le film d'animation adaptant la première partir de l'histoire, chronique à venir sur le blog).
Les films animés de DC Comics n'étaient pas, avant le milieu des années 2000, adaptés littéralement de récits pré-existants. Ainsi, les excellents Batman contre le fantôme masqué ou encore Batman beyond : le retour du Joker sont des créations originales piochant dans la mythologie du justicier masqué. Avec la naissance de la collection DC Universe Animated Original Movies en juillet 2006, l'objectif est de transposer, sous formes de films d'animation destinés au marché de la vidéo, les comics qui ont fait l'histoire de la maison d'édition. Il s'agit d'une initiative conjointe de DC, Warner Bros. et Bruce Timm entre autres, à qui l'on doit l'inestimable Batman : la série animée. Sont ainsi portés à l'écran Superman : Doomsday d'après l'arc La mort de Superman, Justice League : New Frontier d'après la BD de Darwyn Cooke, deux titres qui remportent un vif succès. Les films s'enchaînent rapidement, montrant souvent une adaptation fidèle du matériau d'origine, notamment le très bon Batman et Red Hood : sous le masque rouge (Brandon Vietti, 2010). Batman : Year One calque donc sa trame sur le récit de Frank Miller (au scénario) et David Mazzucchelli (au dessin). Un retour aux origines permettant de voir les débuts d'un fringant Bruce Wayne de 25 ans, combattant le crime dans une Gotham City dominée par la mafia et les flics ripoux. Son apprentissage se déroule en parallèle de la trajectoire du lieutenant James Gordon, débarquant aussi fraîchement à Gotham. La BD fut créé après le coup d'éclat de Frank Miller en 1985, The Dark Knight Returns (ressorti ces jours-ci chez Urban Comics avec le film d'animation adaptant la première partir de l'histoire, chronique à venir sur le blog).
Le film d'animation réalisé par Lauren Montgomery et Sam Liu (habitués de l'univers DC, ils ont aussi réalisé conjointement Justice League : Crisis on Two Earths) suit très, très fidèlement le cours du comic, au point que l'on peut pratiquement isoler chaque cadrage pour retrouver son équivalent dans la BD. La plupart des répliques sont également reprises à l'identique ; les connaisseurs retrouveront très exactement les scènes qu'ils ont observées dans les pages du comics, que ce soit l'arrivée de Bruce Wayne et Gordon à Gotham, la rencontre entre Gordon et Flass à la gare, la première sortie du justicier, ou encore la très belle scène fondatrice de "la clochette", qui détermine la future apparence du héros. Sur une durée ramassée de 65 minutes (assez standard pou les animés DC), quelques rares scènes sautent, comme celle où Wayne se repose en Suisse ; seule une photo examinée par Gordon dévoile ce détail.
Rappelons ici que le film, comme la BD, commencent en janvier et se terminent en janvier, décrivant une année entière dans la vie des protagonistes, comme le promet le titre. La ponctuation narrative de la BD, incluant au fil des pages les "cartons" des dates, se retrouvent dans le film ; et, si elles étaient pertinentes dans le comic, offrant une scansion intéressante, impulsant un rythme et une justification aux ellipses, elles bousculent un peu le récit dans le film, apparaissant parfois à des intervalles très rapprochées. Le décalque du comic trouve ici ses limites.
Mazzucchelli avait pris le jeune Gregory Peck comme modèle pour Bruce Wayne ; on ne le retrouve que peu dans l'apparence du millionnaire justicier du film. Ceci étant dit, la réalisation, si elle est classique, affiche un character design très élégant, dans la lignée de la série de Bruce Timm et Paul Dini. Les quelques éléments créés en images de synthèse -les véhicules la plupart du temps- s'intègrent assez bien à l'ensemble. Si les plans sont la plupart du temps statiques, ils savent se démener lors des quelques séquences d'action (Batman au rez de chaussée d'un immeuble en flammes, aux prises avec un groupe d'intervention armé), épaulée par la musique de Christopher Drake, toujours très inspirée par celle de Hans Zimmer sur la trilogie Nolan. Les similitudes sont de même évidentes avec Batman Begins, qui est inspiré en grande partie de Batman : Year One.
Bien que les connaisseurs n'auront pas une once de surprise, par rapport à certains films de la collection (on pense à Justice League : Echec), Batman : Year One "fait le job", et s'en acquitte de belle manière, surtout pour sa fabuleuse esthétique ; le film respecte aussi la charge violence, assez intense pour un animé, de la BD. Cependant, pour conserver toute la force du récit, (re)lisez plutôt l'excellent comic.
Pour plus d'infos, n'hésitez pas à vous rendre sur le bon site La tour des héros !

 De la SF à la française... Cela m'a longtemps laissé songeur (voir mes articles désabusés
De la SF à la française... Cela m'a longtemps laissé songeur (voir mes articles désabusés 


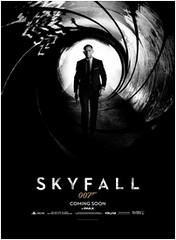 Le James Bond de l'an 2012 est différent. Après la paire Casino Royale /
Le James Bond de l'an 2012 est différent. Après la paire Casino Royale /