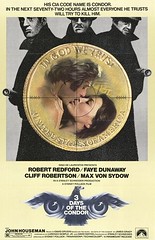Un film de Chang Cheh Précédant de deux années Le justicier de Shanghai, Vengeance met en avant un David Chiang transpirant le charisme par tous ses pores. A-t-on jamais vu, dans le cinéma de Hong-Kong, pareille classe s’imposer à l’écran ? Le cinéaste, très inspiré par les figures hollywoodiennes torturées et charismatiques en diable de James Dean et Marlon Brando, façonne le personnage de Hsia Lo Kuan de la même façon. Il sourit rarement, offrant un visage mutique, hantant les lieux pour mener une vendetta sans merci contre les meurtriers de son frère. Méthodique, froid, il va œuvrer pour la perte de ces assassins.
Précédant de deux années Le justicier de Shanghai, Vengeance met en avant un David Chiang transpirant le charisme par tous ses pores. A-t-on jamais vu, dans le cinéma de Hong-Kong, pareille classe s’imposer à l’écran ? Le cinéaste, très inspiré par les figures hollywoodiennes torturées et charismatiques en diable de James Dean et Marlon Brando, façonne le personnage de Hsia Lo Kuan de la même façon. Il sourit rarement, offrant un visage mutique, hantant les lieux pour mener une vendetta sans merci contre les meurtriers de son frère. Méthodique, froid, il va œuvrer pour la perte de ces assassins.
Un opéra sert de lien entre les deux personnages de Ti Lung (le frère assassiné) et David Chiang : ils sont acteurs et jouent dans les mêmes spectacles, le film étant ponctué de scènes sublimes tournées au ralenti, dont les plans fixes clashent avec les mouvements heurtés des combats auquel se livre David Chiang, véritable ange vengeur. Le théâtre donne une tonalité dramatique qui ne s’éloigne pas tant que cela des tragédies grecques. Les affaires qui se jouent ont tout de l’intrigue politique et des jeux d’influence, qui voueront tout ce petit monde à la mort. Auparavant metteur en scène de théâtre, Chang Cheh s’est servi ici de son bagage technique et nous offre un de ses films les plus personnels.
Ti Lung et David Chiang constituent le duo qui prévaut souvent dans les films de Chang Cheh (La Rage du Tigre, 1971, Le sabreur solitaire, 1969) : deux figures photogéniques, qui promeuvent l’idéal d’une amitié entre hommes où la femme n’a pas sa place. L’attention du réalisateur, tout entière dévoué au personnage sombre de David Chiang, traite le personnage comme une figure démiurgique qui prend la place de la justice. Les habits de Chiang le placent déjà bien au-dessus des autres, toujours sans une tâche, de plus toujours coiffé au millimètre ; il inspire le respect.
Se déroulant dans les années 20, le film offre un tableau d’une rare violence (le meurtre de Ti Lung, cruel au possible, le spectateur étant pris comme le personnage d’un tangible sentiment d’incompréhension, de rare et d’injustice), qui s’oppose avec la beauté des cadres et des personnages. Bâti sur une succession d’oppositions, rythmiques, sonores et d’état (stabilité versus mouvement, bruit versus silence, beauté versus horreur), le film vise une dramatisation des événements à l’extrême, attisant constamment l'attention du spectateur. Les débordements gore, nombreux et marquants, font des personnages des suppliciés victimes d'une brutalité que tout condamne. La portée de l'acte de justice de David Chiang n'en a que plus de poids.
Le retour constant aux scènes d’opéra offre une lecture parallèle des actions, celles répétées de l’opéra se reproduisant avec un mimétisme troublant dans la réalité du film. Mise en abîme du métier d’acteur, les personnages ont maintes fois joué leur mort pour n’être finalement plus tout à fait vivant. Et, quand leur mort "réelle" survient, elle paraît d’ailleurs moins les affecter que leur mort jouée ; en témoigne l’ultime sursaut de David Chiang pour porter un coup fatal au dernier instigateur du complot encore en vie. Véritable réflexion sur les modes de représentation du réel, Vengeance donne à voir un spectacle profond et tragique, digne héritier des tragédies grecques.
Lectures connexes :
Un seul bras les tua tous
Le bras de la vengeance
 Le réalisateur attitré de la saga sera resté fidèle au personnage du détective jusqu’au bout, depuis Sherlock Holmes et l’arme secrète, jusqu’à ce Dressed to kill, dernière (ouf !) adaptation de Sherlock Holmes par la Universal dans ces années 40. Me concernant, il nous aura fallu neuf semaines, une quinzaine d’heures de projection, 9000 mots, pour traiter de la série dans son intégralité : une aventure qui m’aura passionné, et que vous aurez eu plaisir à suivre, j’espère.
Le réalisateur attitré de la saga sera resté fidèle au personnage du détective jusqu’au bout, depuis Sherlock Holmes et l’arme secrète, jusqu’à ce Dressed to kill, dernière (ouf !) adaptation de Sherlock Holmes par la Universal dans ces années 40. Me concernant, il nous aura fallu neuf semaines, une quinzaine d’heures de projection, 9000 mots, pour traiter de la série dans son intégralité : une aventure qui m’aura passionné, et que vous aurez eu plaisir à suivre, j’espère. Ressaisissons-nous du contexte pour aborder Moonwalker, le long-métrage de cinéma de Michael Jackson.
Ressaisissons-nous du contexte pour aborder Moonwalker, le long-métrage de cinéma de Michael Jackson. L’avant-dernier film du cycle Holmes de Rathbone partage cela avec
L’avant-dernier film du cycle Holmes de Rathbone partage cela avec