Un film de Gregg Araki
 Smith, sexuellement "undeclared" (comprendre : couche avec des filles comme des mecs), vivote sur le campus en compagnie de sa meilleure copine, une Daria en puissance. Le récit commence comme une comédie surréaliste, avec sa voix-off décalée et son esthétique acidulée. Mais sous cette surface vernie à l'artifice, se terre une chronique douce-amère des errements sentimentaux de ses protagonistes, qui rappelle un peu les BD indé américaines de Daniel Clowes (David Boring en tête). Comme chez Clowes, la tranche de vie vire rapidement à une enquête (qui sont les hommes-animaux qui apparaissent à Smith ?) flirtant avec le film de complot globalisé. Percutant les genres, Araki nous emmène à une terre d'entre-deux jamais évidente, difficile à prendre au sérieux ; comment être fun et étrange, dramatique et onirique ?
Smith, sexuellement "undeclared" (comprendre : couche avec des filles comme des mecs), vivote sur le campus en compagnie de sa meilleure copine, une Daria en puissance. Le récit commence comme une comédie surréaliste, avec sa voix-off décalée et son esthétique acidulée. Mais sous cette surface vernie à l'artifice, se terre une chronique douce-amère des errements sentimentaux de ses protagonistes, qui rappelle un peu les BD indé américaines de Daniel Clowes (David Boring en tête). Comme chez Clowes, la tranche de vie vire rapidement à une enquête (qui sont les hommes-animaux qui apparaissent à Smith ?) flirtant avec le film de complot globalisé. Percutant les genres, Araki nous emmène à une terre d'entre-deux jamais évidente, difficile à prendre au sérieux ; comment être fun et étrange, dramatique et onirique ?
Ainsi, Kaboom se pose un peu comme un gigantesque point d'interrogation narratif, qu'arriverait-il si... ma copine était une adapte de la magie noire, si mon père était membre d'un ordre secret, … Tellement déconnectée de la réalité qu'Araki semble malgré tout vouloir dépeindre, beaucoup de ces propositions bouchonnent l'empathie et l'intérêt du spectateur.
A un moment, on pressent que Araki a voulu réaliser un film d'envergure, avec sa galerie de personnages tous trempés dans une intrigue mondiale, une prophétie millénariste et ses grandes questions (jamais résolues). Puis, le film reste coincé par ses limites (budgétaires entre autres) et ses parti-pris (indépendant versus commercial). Il ne ressemble finalement à rien d'autre qu'à un film de Gregg Araki, avec ses obsessions et ses thématiques maîtresses. Un peu comme pour Wes Anderson et La vie aquatique, qui visait le film d'aventures et arrive à ... un film de Wes Anderson, atypique, dépressif et joyeux, dramatique et comique.
Kaboom est décevant malgré l'invention, le télescopage des genres et des personnages, car on se désintéresse petit à petit de ce qui se passe à l'écran, jusqu'à un final marquant un certain point de non-retour dans le n'importe quoi intersidéral. C'est dommage tant la première partie (la vie au lycée) est dépeinte avec verve et drôlerie.
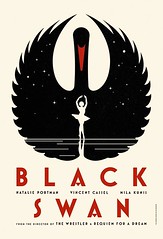 Le film était attendu, la fièvre entretenue par une
Le film était attendu, la fièvre entretenue par une  Pour son premier film en couleurs, qui se révèlera aussi son dernier, Ophüls choisit d'illustrer la vie tumultueuse de Lola Montès, fameuse courtisane et danseuse provocatrice.
Pour son premier film en couleurs, qui se révèlera aussi son dernier, Ophüls choisit d'illustrer la vie tumultueuse de Lola Montès, fameuse courtisane et danseuse provocatrice.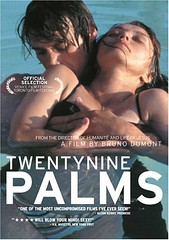 Le choc. La crise. Les larmes, la terreur, lors de la découverte de ce film au cinéma il y a queslques années, qui résonne encore aujourd’hui. Ce film, l’histoire d’un couple hors normes (un américain et une russe) est un dépassement, un exploit, une prouesse. Surpassant le clivage si facile des genres, Bruno Dumont réussit à embrasser toutes les ambiances dans ce road-movie indie. Une trame minimaliste, forte, lourde, fabuleusement visuelle. Une histoire régressive entre deux personnes trop proches dans ce désert pour une fois vraiment (désert).
Le choc. La crise. Les larmes, la terreur, lors de la découverte de ce film au cinéma il y a queslques années, qui résonne encore aujourd’hui. Ce film, l’histoire d’un couple hors normes (un américain et une russe) est un dépassement, un exploit, une prouesse. Surpassant le clivage si facile des genres, Bruno Dumont réussit à embrasser toutes les ambiances dans ce road-movie indie. Une trame minimaliste, forte, lourde, fabuleusement visuelle. Une histoire régressive entre deux personnes trop proches dans ce désert pour une fois vraiment (désert). 