Un film de Tony Scott Il est amusant de voir à quel point certains films, pourtant calibrés et vendus tels des produits comme les autres, révèlent malgré tout des constantes chez des réalisateurs ; j’en veux pour preuve ce Revenge qui, mettant en avant un Kevin Costner charismatique en diable (c’était sa grande époque, juste avant son Danse avec les loups, Bodyguard et l'année du puissant JFK), propose par sa séquence d’introduction -un vol d’avions de combat-, une prolongation à Top Gun, réalisé par Scott quelques années auparavant. Le personnage de Cochran (Costner) peut tout à fait personnifier le Maverick de Top Gun, en fin de carrière. Les deux personnages ont d’ailleurs un caractère similaire et une voix française particulièrement proche -il s’agit de Michel Papineschi, doubleur officiel de Robin Williams et par ailleurs de John Shea / Lex Luthor dans la série Loïs et Clark : les nouvelles aventures de Superman.
Il est amusant de voir à quel point certains films, pourtant calibrés et vendus tels des produits comme les autres, révèlent malgré tout des constantes chez des réalisateurs ; j’en veux pour preuve ce Revenge qui, mettant en avant un Kevin Costner charismatique en diable (c’était sa grande époque, juste avant son Danse avec les loups, Bodyguard et l'année du puissant JFK), propose par sa séquence d’introduction -un vol d’avions de combat-, une prolongation à Top Gun, réalisé par Scott quelques années auparavant. Le personnage de Cochran (Costner) peut tout à fait personnifier le Maverick de Top Gun, en fin de carrière. Les deux personnages ont d’ailleurs un caractère similaire et une voix française particulièrement proche -il s’agit de Michel Papineschi, doubleur officiel de Robin Williams et par ailleurs de John Shea / Lex Luthor dans la série Loïs et Clark : les nouvelles aventures de Superman.
Outre cette première remarque, Tony Scott trousse un film étrange, qu’on peut sans mal qualifier de schizophrène. On y voit en effet s’opposer deux parties clairement distinctes.
Dans la première partie, Kevin Costner s’amourache de la belle Madeleine Stowe, amour interdit car c’est la femme d’une sorte de parrain, autrement bon pote avec Costner. Cette première partie est vraiment à la limite du ridicule aujourd’hui, oscillant entre un esprit Harlequin (pas les bonbons, hein, la série de bouquins), je dis bien esprit car je m’attache juste à leurs couvertures incroyablement kitsch, et une bluette digne d’un téléfilm érotique qui firent les chaudes soirées de M6. Le summum étant la scène "torride" en voiture décapotable, le Costner faisant presque claquer le string de la jeune femme quand elle lui monte dessus. Notez quel sens de la poésie étreint soudain les lignes de cette chronique ! Érotisme de bas étage donc, souligné au stabilo par une musique d’ascenseur, au synthé, toujours de la même eau. On se dit alors, pourquoi pas, ok, mais le film s’appelle Revenge, alors elle arrive quand cette vengeance ? Elle arrivera, mais il faudra attendre... attendre encore... et là, quand les deux tourtereaux sont pris sur le fait, ça commence !
La fameuse vengeance du bad guy (Anthony Quinn, toujours vif) fait totalement bifurquer le ton du métrage : violent, viscéral, limite vigilante movie, la deuxième est aussi excessive dans les images chocs que l’était la première dans la guimauve. La jeune femme défigurée et un Kevin Costner tuméfié sont, il faut bien l’avouer, assez marquantes.
La furie presque barbare de la deuxième partie emporte l’adhésion, mais le souvenir de la première, terriblement datée, reste l’impression la plus prégnante qui se dégage du film. Mais peut-être que Tony Scott n’est pas ma tasse de thé...
drame - Page 6
-
Revenge (1991)
-
Ciné d'Asie : Nuages d'été (1958)
Un film de Mikio Naruse
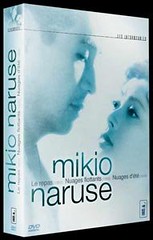 Alors qu’il y a quelques mois, nous découvrions son chef d’œuvre, Nuages flottants (1955), dont on reparlera à coup sûr dans ces colonnes, la vision d’autres films de ce réalisateur prolixe (une carrière de 90 films, ça n’est pas rien) s’imposait. C’est chose faite aujourd’hui grâce au coffret édité il y a quelques années par Wild Side Video dans ses fameux Introuvables. Nuages d’été nous montre une famille d’agriculteurs, dont le patriarche tient à garder le contrôle. En effet, une des lignes d’évolution du film sera l’envie des enfants de s’affranchir de cet héritage agricole, en voulant devenir étudiant, commerçant...
Alors qu’il y a quelques mois, nous découvrions son chef d’œuvre, Nuages flottants (1955), dont on reparlera à coup sûr dans ces colonnes, la vision d’autres films de ce réalisateur prolixe (une carrière de 90 films, ça n’est pas rien) s’imposait. C’est chose faite aujourd’hui grâce au coffret édité il y a quelques années par Wild Side Video dans ses fameux Introuvables. Nuages d’été nous montre une famille d’agriculteurs, dont le patriarche tient à garder le contrôle. En effet, une des lignes d’évolution du film sera l’envie des enfants de s’affranchir de cet héritage agricole, en voulant devenir étudiant, commerçant...
Le monde est en train de changer. La figure du père, incarnant les traditions, la façon de vivre à l’ancienne, est déstabilisée car descend de son piédestal. Les jeunes femmes veulent étudier, les couples s’installent sans s’être mariés au préalable... Situé juste après la deuxième guerre mondiale, présente en filigrane dans le récit (l’héroïne est veuve de guerre), le film nous montre le décalage des désirs et des façons de vivre entre deux générations. Décalage qui s’exprime déjà dans les modes vestimentaires, entre les vestes portées par les jeunes et les kimonos traditionnels qui ont la faveur des générations plus matures. Ces derniers ne semblent pas être issus du même siècle. Malgré la résistance du père, les jeunes vont arriver à leur fin. Cette période de transition s’illustre aussi, dès le début du film, par une enquête où un journaliste interroge la population sur les effets d’une réforme agraire instaurée peu avant, basée sur le partage équitable de l’héritage entre les enfants. Tout est en train d’évoluer, d’être ré-arrangé, bousculant les comportements, en laissant certains sur le carreau. L’empreinte du passé est néanmoins indélébile, et reste à portée tant que la génération des pères reste en vie.
Un autre aspect intéressant de Nuages d’été est son rapport constant aux finances : les questions d’argent y sont prégnantes de bout en bout, laissant imaginer qu’il s’agit d’un personnage supplémentaire et central. L’argent est la raison invoquée qui pousse le patriarche à refuser à sa filles ses études (qui se double bien sûr d’une réaction face à la volonté d’émancipation de la jeune fille), et tout est, tôt ou tard, réduit à des questions financières. D’ailleurs, alors que le film pourrait mettre plus en valeur les trajectoires dynamiques et quasi-révolutionnaires des fils et filles voulant s’échapper de leur déterminisme, on s’attarde plutôt sur le personnage du père, qui veut décider de tout en ce qui concerne l’avenir de ses enfants. On reconnaît derrière ce choix clair la personnalité de Naruse, connu pour ne refuser aucun contrat de film, car il avait sûrement une terrible peur du manque d’argent. Même si ce dernier n’a jamais été considéré comme un auteur par son côté "réalisateur à la chaîne", le rapprochement que l’on peut faire entre l’obsession dépeinte dans le film et son propre comportement est évident.
Mais le personnage principal est présenté comme étant celui de la tante, veuve de guerre qui a clairement besoin de retrouver une sociabilité après des années de solitude ; une amie lui dit même à un moment qu’elle "la croyait morte". Ce besoin va s’exprimer par l’attirance qu’elle éprouve pour le personnage du journaliste, pourtant un home marié -dont on ne verra jamais la femme-. Les choix francs de Naruse concernant les enchaînements d’actions et l’apparition ou non de certains personnages qui auraient pu avoir leur place dans le film, lui donne un côté étrange : alors que certaines choses paraissent manquer, d’autres semblent en trop, notamment toutes les interactions familiales entres différentes générations qui brouillent les pistes de la généalogie de cette famille : au bout d’un moment, on nage dans un léger flou à ce niveau-là. Mais, de cette posture particulière, naît une identité assez unique, car au final on ne se soucie guère de la structure familiale pour laisser la place à l’éclatement du carcan familial.
Nuages d’été est le premier film en couleurs de Naruse, ainsi que le premier où il expérimente le format panoramique. Il en ressort une grande beauté, qui rehausse les paysages agricoles, et des couleurs omniprésentes, comme s’il testait tous les rendus des variations colorimétriques.
Sans égaler la réussite éclatante de Nuages flottants, ce film-ci, malgré un flou qui peut faire décrocher le spectateur, reste digne, et illustre un témoignage de première main, quasi-documentaire, étude sociologique, d’un moment dans l’histoire du Japon. -
Animal Factory (2000)
Un film de Steve Buscemi
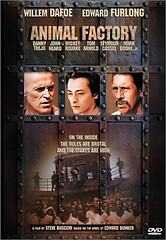 Cet excellent acteur/réalisateur qu’est Steve Buscemi nous sert un exemple du film carcéral dans toute sa dure réalité ; bien que l’intrigue se situe dans la prison de San Quentin, une des plus anciennes des Etats-Unis et lieu de maints autres films avant celui-ci, le film a été tourné dans une ancienne prison d’état à Philadelphie. Adapté du roman de Eddie Bunker, qui connaît San Quentin comme sa poche (il y a séjourné 18 ans, semble-t-il), Animal Factory est d’abord un film de gueules incroyables, à commencer par un Willem Dafoe, tête rasée, excellent. A celui-là s’ajoute l’ex-taulard Danny Trejo, tout en balafres, connu pour jouer les seconds rôles chez Robert Rodriguez. Mickey Rourke, méconnaissable (pléonasme), est à contre-emploi dans un rôle... borderline dont je vous laisserais la surprise. Eddie Bunker lui-même, après avoir été aperçu dans Reservoir Dogs (Mister Blue, c’était lui), joue un rôle secondaire. Au milieu de toute cette troupe, qui reconstitue de façon convaincante une ambiance toujours sur le fil, entre vie et mort, le jeune Ron Decker (Edward Furlong, disparu des écrans et c’est bien dommage) doit rentre dans les cases, se conformer aux usages hors-normes d’une société de psychopathes.
Cet excellent acteur/réalisateur qu’est Steve Buscemi nous sert un exemple du film carcéral dans toute sa dure réalité ; bien que l’intrigue se situe dans la prison de San Quentin, une des plus anciennes des Etats-Unis et lieu de maints autres films avant celui-ci, le film a été tourné dans une ancienne prison d’état à Philadelphie. Adapté du roman de Eddie Bunker, qui connaît San Quentin comme sa poche (il y a séjourné 18 ans, semble-t-il), Animal Factory est d’abord un film de gueules incroyables, à commencer par un Willem Dafoe, tête rasée, excellent. A celui-là s’ajoute l’ex-taulard Danny Trejo, tout en balafres, connu pour jouer les seconds rôles chez Robert Rodriguez. Mickey Rourke, méconnaissable (pléonasme), est à contre-emploi dans un rôle... borderline dont je vous laisserais la surprise. Eddie Bunker lui-même, après avoir été aperçu dans Reservoir Dogs (Mister Blue, c’était lui), joue un rôle secondaire. Au milieu de toute cette troupe, qui reconstitue de façon convaincante une ambiance toujours sur le fil, entre vie et mort, le jeune Ron Decker (Edward Furlong, disparu des écrans et c’est bien dommage) doit rentre dans les cases, se conformer aux usages hors-normes d’une société de psychopathes.
Buscemi filme en gros plans, ou du moins toujours serrés, tentant de cerner dans les plus infimes expressions le ressenti d’être emprisonné ; en étant au plus proches des rides, cicatrices, cernes des protagonistes, il fait de ces marques de la vie le temps qui passe, long, bien long, et dont la brutalité laisse des traces indélébiles, qu’elles soient visibles ou psychologiques.
Dans cet écrin de réalisme, où les prisonniers s'organisent en clans, en binômes (le protecteur et son protégé / parfois souffre-douleurs), et façonnent un cercle vicieux immuable, provocation / agression / vengeance, on sent l’empreinte prégnante d’un Oz, dominant depuis sa fenêtre télévisuelle tout la représentation de l’univers carcéral depuis la création du show. Buscemi, dans sa démarche, ne peut qu’emprunter un chemin déjà tracé par cette magistrale série.
Malgré tout, la relation Willem Dafoe / Edward Furlong échappe aux stéréotypes et aux craintes du personnel encadrant de la prison, créant une fraternité nécessaire dans un monde sans pitié, où les prisonniers s’entretuent et où, quand ce n’est pas eux qui s’en chargent, des surveillants impersonnels (on ne distinguent que leur silhouette) mitraillent à vau-l’eau.
Caractères hétéroclites, besoin de reconnaissance et survie, les prisonniers apparaissent bien comme des animaux, pour lesquels la liberté n’est qu’un fantôme. Furlong redonne vie à cet espoir pour Dafoe, et c’est ce qui est beau dans ce film. On en parlera donc comme d’un essai assez réussi, mais où le personnage de Furlong aurait peut-être du être traité plus en profondeur... A découvrir toutefois ! -
La fille de Ryan (1970)

Un film de David Lean
Dès les premiers instants du film, on est littéralement saisi. Transporté par la beauté magistrale de cette côte irlandaise, de cette plage de sable fin et de cette eau turquoise qui semble baigner tout le cadre. Dégageant un lyrisme et un romantisme certain, ces couleurs convoquent le souvenir des films de Douglas Sirk, souvent soutenus par les teintes d’un flamboyant Technicolor.
Histoire d’amour sur fond de 1ère guerre, récit sur la perte de l’innocence, La fille de Ryan subjugue d’abord par l’adéquation entre le fond et la forme. Cette plage irréelle, véritable paradis, symbolise les espoirs de la jeune Rosy, amoureuse de son maître d’école... qui, contre toute attente, ne va pas poser beaucoup de problèmes pour la prendre pour femme. Rosy est donc déjà sous le coup d’un interdit dans son petit village traditionnel, mais, au moins, elle a ce qu’elle désirait. Ou plutôt... elle ne sait pas vraiment ce qu’elle veut. Son père dit d’elle, dès le tout début, qu’elle a "tous ces hommes dans sa tête", et se rendra compte lors d’une discussion avec sa fille à quel point elle est désorientée.
Son rêve n’est pas vraiment conforme à son idéal, tel son amour de Professeur, qui prendra 30 secondes de la nuit de noces, pour lui faire découvrir les joies (fatiguées) de l’amour charnel. De son plein gré, elle s’est enfermée dans une vie qui ne lui plaît guère, elle, pleine de l’insouciance et de la vigueur de la jeunesse. Lorsqu’un nouveau major anglais arrive dans le campement proche du village, elle décidera de se tourner vers lui pour obtenir une plus grande satisfaction, et faire prendre corps à son rêve, déçu jusque là. Elle entérine alors un nouvel interdit, car son village est un nid de résistance face aux anglais, et cette liaison est signe d’une trahison manifeste pour les esprits échauffés par la bière que sont les habitants de ce bourg perdu. Les trajectoires, décisions des personnages se font soit dans l’inconscience des conséquences, à l’image de Rosy, ou, à l’inverse, dans la trop grande conscience des effets de ces actions, comme Ryan, le père de Rosy, qui, comble de la contradiction, permet à la fois à la résistance de triompher dans un premier temps, puis à la police d’arrêter lesdits résistants.
Ryan, entre deux eaux, car à la fois informateur des anglais et digne serviteur de la résistance, occupera cette double tâche jusqu’au bout de notre histoire. Le personnage du major est aussi intéressant, tout en silence, traumatisé par les horreurs de la guerre passée au front, exprimant un besoin de réconfort tel, que la scène de sa rencontre avec Rosy est comme un éclair dans sa nuit.
Les tonalités de couleurs accompagnent, soulignent les états d’âme de la jeune Rosy, passant de franches couleurs éclatantes lors de ces doux moments à des teintes grisâtres lorsque la réalité reprend le dessus, notamment dans toutes les scènes au village. On a une opposition caractéristique entre la côte et son étendue d’eau semblant se poursuivre à l’infini, lieu de tous les espoirs, possibilité d’évasion par le corps ou par l’esprit, et le village boueux et rempli de qu’en dira-t-on et de méchantes commères (les filles de joie), se refermant comme un cachot derrière les aspirations romanesques de la jeune fille.
Un personnage du village, ceci dit, est une bête magnifique, un quasimodo simplet, qui joue un fou du roi à la perfection et constitue le réceptacle de la haine viscérale des villageois envers la différence, l’altérité. La relation qu’il nouera en pointillé avec Randolph Doryan, le major anglais, est touchante dans un effet de vérité surprenant.
Péchant cependant par trop de longueurs, les errements de Rosy, du maître d’école (très bon Robert Mitchum, qui a sûrement la plus grande scène du film, celle où il est le témoin fantasmé de la ballade de sa femme et de son amant sur la plage) et du major naviguent encore longtemps dans les esprits après sa vision. Preuve, s’il en est besoin, de sa puissance d’évocation. -
Les chansons d'amour (2007)
Un film de Christophe Honoré
 Il y a des films qu’on peut s’attendre à ne pas aimer ; Les chansons d'amour était de ceux-là quand je suis entré dans la salle il y a plusieurs mois de cela. J’en suis ressorti avec l’intense sensation d’avoir senti quelque chose d’important ce jour-là, doublé d’un certain effet de surprise très agréable. Plusieurs mois après, qu’en est-il en dvd ?
Il y a des films qu’on peut s’attendre à ne pas aimer ; Les chansons d'amour était de ceux-là quand je suis entré dans la salle il y a plusieurs mois de cela. J’en suis ressorti avec l’intense sensation d’avoir senti quelque chose d’important ce jour-là, doublé d’un certain effet de surprise très agréable. Plusieurs mois après, qu’en est-il en dvd ?
On retrouve l’ambiance particulière qui donne tout son sel au film : dialogues sur-écrits, personnages-comètes, chansons touchantes et délicieusement pop, et la ville : Paris. Ou l’histoire d’un trio amoureux un peu bancal (forcément), déroutant et dérouté.
Les dialogues font ressentir une préciosité et un amour des mots plus que certain. Très ciselées, il ne fallait pas moins de la trempe d’un Louis Garrel pour pouvoir déclamer ces lignes avec une théâtralité intime. autour de lui, Ludivine Sagnier (toujours un peu énervante) Clotilde Hesme et Grégoire Leprince Ringuet le soutiennent bien, tant c’est finalement sur ses épaules que repose la majorité du métrage. Fragile, inaccessible, sa drôlerie clownesque (la séquence de mime ou le jeu de marionnette) n’est qu’une façade de surréalisme pour pouvoir affronter un monde qu’il ne comprend pas si bien. Tout en auto-analyse très cérébrale, il se débat avec une belle sensibilité.
Les personnages sont tous en recherche, et représentent tous des trajectoires qui convergent vers un big bang sentimental. Chassés-croisés, amour-haine, désespoir, tout y passe et ça passe quand même. La jeune génération est déjà aux prises avec l’éphémère et la brutalité de la vie. La priorité de la caméra est de donner à voir le sentiment, dans toute sa profondeur. A voir, et à écouter aussi.
La musique et les chansons composées par Alex Beaupain apportent à la fois une certaine fraîcheur (où le goût de la poésie prend la suite logique des dialogues du cinéaste) et un espace où les protagonistes se rencontrent pour échanger ou partager leurs moments les plus forts. Sans les chansons, le film ne serait sûrement qu’une cosse vide, sans âme. Elles sont de toutes façons sa raison d’être, comme le titre le proclame bien haut (et bien gros, le générique d’ouverture ne laissant que peu de place à l’image). En cela, plus que de ponctuer le film, et d’offrir des pauses musicales, les chansons participent du même élan scénaristique que les autres passages dialogués. On n’a pas affaire à une cassure du rythme, ni des enjeux dramatiques, mais bien à une continuité ; qui plus est, le fait (quand même bien fantastique) que les personnages se mettent soudain à chanter, au lieu de parler simplement pour exprimer leur point de vue, ne paraît pas du tout déplacé ; au lieu de nous sortir de l’univers du film comme c’est parfois le cas dans un exercice similaire, ce changement brutal de registre se fait le plus naturellement du monde.
Enfin, on perçoit que Christophe Honoré construit son film avec Paris, sur Paris. La ville peut être appréciée comme un personnage à part entière, les personnages de l’histoire déambulant la plupart du temps dans ces rues, le plus souvent de nuit ; la photo met en valeur les éclairages au néon, presque aveuglants, faisant de Paris la ville des lumières, et installent visuellement le sentiment de sur-réalité déjà induit par le langage, comme on l’a vu plus haut. Espace des possibles, les avenues, les arcs, les parcs donnent aux protagonistes un terrain de jeu presque trop éclairé, comme une gigantesque fête foraine. Mais, aux jeux de l’amour, on ne gagne vraiment pas à tous les coups... Les chansons d’amour reste à la seconde vision ce beau film triste et gai-gay à la fois, qui nous avait bien plu lors de sa sortie salles.