L’éveil de Catwoman

Nous avions déjà, par le passé, étudié le cas de Batman, le défi. Sauf que ce n’est pas tout à fait cela qui nous préoccupe aujourd’hui. Le personnage le plus fascinant du film de Tim Burton est sans conteste Catwoman, qui passe de la timide et peu dégourdie secrétaire Selina Kyle -hem... assistante de direction- à la maîtresse SM bardée de noir et de griffes qui sait jouer du fouet pour se faire entendre. Cela valait bien qu’on s’y attarde, d’autant plus que les séquences de naissance des bad guys se sont toujours révélées comme des grands moments, même dans des films mineurs : voir à ce propos la magnifique naissance de l’homme-sable dans Spider-Man 3.
La séquence qui nous intéresse dure environ dix minutes, et se positionne dans le premier quart du film. Elle offre une très nette construction en tryptique ; composée par trois scènes, trois temps. Une scène centrale entourée de deux scènes se répondant en miroir inversé. Les trois temps d’une transformation ; de la jeune femme infantilisée à la femme ; de la femme à l’animal.


Selina Kyle rentre dans son appartement, éreintée par sa journée de travail et l’agression d’un des membres de la bande du pingouin ; la rencontre avec Batman l’a aussi bouleversée. Arrivée dans la douce monotonie de son chez-elle, elle semble perpétrer un rituel immuable, qui se trouvera néanmoins chamboulée lors du troisième temps de la séquence. Allumant la lumière sur un intérieur rose pâle (on retrouve les teintes du quartier de Edward aux mains d’argent, le précédent film du cinéaste), comme légèrement passé, déteint., et décrépi. Un "Honey, I’m home" retentit, typique de la femme des années 50, (rappelez-vous de William H. Macy, qui reprend l’expression à l’identique, à maintes reprises, dans le très beau Pleasantville), suivi d’un désespéré "Oh, I forgot, I’m not married" ("Ah, j’oubliais, je ne suis pas mariée"). Durant cette scène, elle parlera toute seule, avec son chat, son répondeur, ou à elle-même comme ici ; le dialogue qu’elle a avec elle-même la dévalue systématiquement, se traitant à plusieurs reprises de corn dog (saucisse à hot-dog). Son manteau lourdement jeté sur le dossier de son fauteuil, elle orientera son regard et son attention sur sa chatte, unique compagnon de jeu qui semble avoir une vie beaucoup plus intéressante que celle de sa maîtresse, remplies d’escapades érotiques sur lesquelles la questionne Selina. Machinalement, elle allume la lumière, donne du lait à sa chatte, consulte les messages de son répondeur, (la symétrie avec la troisième scène de la séquence, dans laquelle Selina, née à nouveau, pénètre transformée dans son appartement, allant jusqu’à dupliquer quasi-exactement l’origine des messages : sa mère, puis les cosmétiques Schrek) et déplie son lit, dissimulé dans une armoire, indiquant la petitesse d’un appartement très "maison de poupée". La langueur et l’éternelle répétition de sa vie de tous les jours sautent aux yeux, accentués par un aspect un peu misérable (le bruit du métro qui passe, loin du confort rêvé de Selina).
Son appartement, rempli à craquer d’objets aussi rassurants qu’infantiles (des montagnes de peluches ornent ses fauteuils) semble être le dernier rempart contre la folie du dehors, tout en la contenant aussi, traçant à grands traits une personnalité immature et mal dans sa peau. L’appartement la contient, la retient en fait, à la façon toujours d’une maison de poupées (Selina dénaturera son exemplaire à la bombe, faisant jaillir le chaos là où tout, avant, régnait sous le joug du "mignon"). Cette maison de poupée qui est tout à fait une réplique de son propre appartement rêvé, plus grand, mais toujours aussi... rose. L’ensemble, s’il se veut effectivement rassurant, n’est est pas moins extrêmement effrayant, à la façon de ces magasins de poupées vieillissants que l’on peut croiser dans certains centres-villes. En mettant côte à côte les représentations de l’éternelle jeunesse et de la dégradation due au temps, le cinéaste crée une atmosphère étrange, cette illusion de la vie dite normale qui lui a toujours parue artificielle et bizarre. Ainsi, Selina Kyle est habitée par deux pulsions : une appelant à une normalité inatteignable (une relation amoureuse stable, qui restera impossible même une fois transformée) et l’autre grondant, couvant sous le vernis de la civilisation, l’envie folle de tout envoyer paître. Selina ne rayonne pas, c’est le moins que l’on puisse dire. Les cheveux tirés en arrière, le regard gommé par d’énormes lunettes qui lui donnent son air triste, vêtue d’un strict tailleur brun, digne d’une grand-mère, elle ne s’est pas trouvée son look de femme.
Introvertie et vraiment idiote, Selina doit à son ultime oubli sa transformation qui, comme tous les grandes figures de Batman, est subie. Se rendant de nuit dans les locaux de Max Schreck (le film est quasi uniquement nocturne), elle se fait surprendre par le chef qui découvre une employée beaucoup trop zélée pour lui...

Dans cette seconde phase de la séquence, Selina vit alors dans un monde en total décalage avec ce qu’elle pense comme étant en droit de donner et de recevoir. Ainsi, lorsque Max Schrek la traitera de secrétaire zélée (elle a pu accéder à des fichiers cachés en décodant le mot de passe de son chef), elle en sourira d’abord de fierté lors d’un bref contre-champ, qui laissera rapidement la place à sa mine déconfite, comprenant trop tard que ce qu’elle prenait comme un compliment est, en réalité, un défaut. Schrek lui lancera alors ce magnifique "You know what curiosity do the cat ?" auquel répondra dans une symétrie troublante le docteur Finklestein dans L’étrange noël de monsieur Jack : "Curiosity kills the cat, you know ?", à l’encontre de Jack cherchant à percer le secret de Noël. Et, effectivement, l’objectif de Schreck sera de la tuer, ce qu’il réussit à cacher temporairement en feignant l’étonnement avec panache. Et déjà, dans cette scène, l’éclairage sur les lunettes de Selina Kyle dessine le futur masque de Catwoman...
La chute de Selina, d’une extrême violence -amplifiée par le montage et la bande son-, doit l’achever. Et pourtant, la caméra, haut placée dans une perspective plongeante, se rapproche peu à peu d’elle, comme si son âme la rattrapait pour une nouvelle chance, une nouvelle vie. Les chats, dont elle était proche en tant qu’humaine, se rassemblent pour lui raviver les sangs sur une musique crescendo, percussions cinglantes et envolées de violons stridents se disputant le devant de la scène sonore. Là, au milieu des ordures et sur un tapis de neige, Selina revit dans un clignement d’œil. Mais est-ce la même ? La suite nous prouvera que non.

De retour dans son appartement, elle agit comme une marionnette sans marionnettiste, essayant de reproduire ses mouvements habituels, sans en avoir jamais la maîtrise complète. Dans une sorte de veille éveillée, comme somnambule, elle offre un décalque mécanique mais malade de la première scène. Faisant tomber la lampe, elle verse du lait sur son vieux plancher, puis en boit à pleine gorgée. Sa demi-conscience va s’éveiller dans un torrent de violence avec l’ultime message de son répondeur, laissé encore une fois par les cosmétiques Schreck. Déchaînée par son nom, qu’elle associe de plus à la figure masculine qu’elle a sûrement cessé de chercher, elle explose.


Tous les aspects de sa vie passée à la moulinette, littéralement. Une explosion de violence, soutenue par une orgie de violons -merci Danny Elfman, pour la plus belle de vos partitions- qui réduit au néant son petit intérieur de la Selina Kyle d’avant. Elle rentre dans un état de transe créatrice : de sens, (le néon Hello There, "Bonjour, toi", qui devient Hell here, "ici l’enfer"), traduisant avec une acuité inédite son état mental), d’objets physiques (la tenue en simili-plastique et griffes), prenant soin de signer son passage et son œuvre (la bombe de graffitis noirs, dont elle appose la marque sur ses objets roses : murs, tenues, meubles) ; Tim Burton tisse là un parallèle entre Selina Kyle / Catwoman et Jack Napier / Joker, qui dans le premier opus passait un musée du centre de Gotham à la bombe verte et rouge, transfigurant plutôt que défigurant les œuvres d’art droitement installées. Mettant à sac son appartement, remplaçant le rose flétri par un noir électrique, elle se découvre en chatte, comme un animal qui a soif d’action, de violence et de sexe. A ce sujet, l’accoutrement qu’elle se crée, recyclant une veste qu’elle ne mettait sûrement jamais, moulante et dévoilant ses charmes de bien belle façon, est équivoque.

Un personnage complexe, révélée à elle-même par une séquence cataclysmique, que Burton tourne en plan-séquence, laissant libre cours au délire de Michelle Pfeiffer, qui signe là une des meilleures scènes de toute sa carrière d’actrice.
Sources images : captures DVD Warner Bros. Entertainment



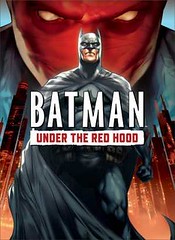 Les inédits dvd de chez DC témoignent d'un niveau tel qu'on est presque surpris de les découvrir directement chez soi, dans la quiétude (rapidement chamboulée) de notre salon, ou bien devant son ordinateur, la tête surmontée d'un casque audio (pour la VO, c'est bien mieux, je vous le conseille !). Superman Doomsday (Laurent Montgomery, 2007) était d'une redoutable efficacité ; Justice League : New Frontier (Dave Bullock, 2008) faisait preuve d'une belle recherche esthétique et constituait une adaptation honnête de la BD de Darwyn Cooke ; Batman et Red Hood vient aujourd'hui jouer sur les terres du superbe
Les inédits dvd de chez DC témoignent d'un niveau tel qu'on est presque surpris de les découvrir directement chez soi, dans la quiétude (rapidement chamboulée) de notre salon, ou bien devant son ordinateur, la tête surmontée d'un casque audio (pour la VO, c'est bien mieux, je vous le conseille !). Superman Doomsday (Laurent Montgomery, 2007) était d'une redoutable efficacité ; Justice League : New Frontier (Dave Bullock, 2008) faisait preuve d'une belle recherche esthétique et constituait une adaptation honnête de la BD de Darwyn Cooke ; Batman et Red Hood vient aujourd'hui jouer sur les terres du superbe 






