Un film de Fritz Lang
 Ce vendredi 12 février 2010, aux alentours de 23h20, la projection exceptionnelle de la version la plus complète de Metropolis à la 60ème édition de la Berlinale touchait à sa fin. Fruit d'un parcours épique, dont l'histoire des déboires est aussi dense que celle d'un (bon) film, Metropolis tient donc debout pour la première fois depuis sa première projection.
Ce vendredi 12 février 2010, aux alentours de 23h20, la projection exceptionnelle de la version la plus complète de Metropolis à la 60ème édition de la Berlinale touchait à sa fin. Fruit d'un parcours épique, dont l'histoire des déboires est aussi dense que celle d'un (bon) film, Metropolis tient donc debout pour la première fois depuis sa première projection.
Production pharaonique de la UFA, qui accompagnait Fritz Lang depuis quelques années, et avait déjà permis à son réailsateur de créer sa vision démesurée du mythe des Nibelungen (1924), Metropolis est le film de tous les superlatifs : figuration dantesque (35000 personnes, chômeurs pour le plus grand nombre, permis par les salaires très bas pratiqués à l'époque), décors gigantesques, expérimentations graphiques de tous les instants au service d'une réflexion sur les rapports de force entre les classes sociales, et c'est loi de faire le compte. Face à son budget incontrôlable, le film est un échec cinglant et le film est rapidemment coupé, découpé dans les grandes largeurs. Si l'on se retrouve aujourd'hui avec une version quasi-complète de 2h30 (de rares cartons nous décrivent encore une ou deux scènes manquantes), l'on ne pouvait voir à la fin des années 20 qu'un film d'une durée de 1h30 ! Le film met ainsi longtemps, très longtemps avant d'acquérir le statut de classique mondial (premier film enregistré à la Mémoire du monde de l'Unesco), et ce n'est quà partir des années 70 que le film, sous le coup d'une première restauration, va inspirer les metteurs en scène, mais aussi le monde de la mode, ....
La copie retrouvée au musée de Buenos Aires remet donc les pendules à l'heure, car elle permet de voir près de 25 minutes inédites par rapport à la dernière restauration de 2004, celle présentée sur le DVD MK2 en France, qui comportait encore nombre de cartons descriptifs rendant l'intrigue encore confuse. Ici, le challenge était de produire une copie exploitable en HD, pour de futures éditions Blu-ray. La version diffusée sur Arte est celle-ci, en plus d'être un ciné-concert, l'orchestre symphonique de Berlin jouant pendant que le film était projeté. La partition originale est très importante, entre nous soit dit, car elle a permis de se rendre compte que la copie argentine était bien la plus complète : la partition comporte en fait plus de mille points de synchronisation musique / images, qui permettent de faire vivre le film beaucoup plus qu'une musique générique comme c'était souvent le cas pour sonoriser des films muets.
On peut facilement différencier les passages déjà connus, retranscrits avec une pureté jamais atteinte (la HD pour les films de patrimoine, fussent-ils si anciens, est vraiment visible!) des scènes inédites, la copie argentine, en 16 millimètres, faisant preuve d'un état lamentable, restaurée au mieux mais aux dégâts irréversibles. D'innombrables stries barrent l'immage verticalement, le spectateur pouvant discerner derrière ces véritables barreaux ce à quoi ressemblait ce rêve de Metropolis, ce mythe du film génial mutilé et retrouvé. Dans ces scènes inédites, qui ne s'en tiennent parfois qu'à des plans de coupes, on découvrent de nouveaux personnages, tel le sbire du chef de l'usine, un gars à la mine patibulaire, mâchoire carrée, chapeau noir à longs bords et oreilles naturellement pointues : mandaté pour tuer Freder Fredersen, il va poursuivre l'ouvrier à qui ce dernier a fait don de son costume. 11811, car il est ainsi nommé, a droit a plus de scènes, et notamment une dambulation en voiture durant laquelle il veut se rendre au quartier des plaisirs (nommé Yoshiwara, du même nom que le quartier bien connu, pour les mêmes raisons, dans le Japon de l'ère Edo). La fin du film est la plus dense en scène nouvelles, principalement axée autour de l'inondation du monde souterrain ; l'eau monte, jaillit de toute part, à l'instar de la peur de tout un peuple.
La tenuer christique du récit, voyant un homme du peuple d'en haut aller dans les souterrains, prendre la place d'un ouvrier, pour finalement symboliser le coeur entre "le cerveau et la main", leitmotiv martelé tout au long du film, est claire et finalement très naïve (le jeu de Gustav Frohlich, tout en yeux écarquillés et poses théâtrales, n'élévant certes pas le propos). L'acteur a d'ailleurs une particularité amusante : il est atteint d'un mal plus tard connu sous le nom de syndrome Forrest Gump, à savoir qu'il ne se déplace qu'en courant comme un dératé, même sur des courtes distances, ce qui est est très drôle -malgré lui.
Le film, opposant le monde d'en haut, terre des artistes, de la beauté et de la richesse, aux tons blancs éclatants, à celui du bas, noir de charbon pour les ouvriers qui semblent nourrir les machines d'eux-mêmes pour assurer le bon fonctionnement d'en haut, est ainsi construit en miroir constant. Marie, jeune fille pure qui exhale la foi des opprimés, et son double robotique, pervertie; Freder le bourgeois et 11811 l'ouvrier , dont il prend la place et qui, une fois maquillé en rupin, lui ressemble beaucoup ; A ses oppositions symétriques s'ajoutent les effet de miroir dans le cadre, qui démultiplient les visages, ou les regards (le visage de Maria répété à l'infini). L'opposition cerveau / main s'offre une résolution, un lien possible entre les deux en la personne de Freder, défini comme l'élu, le médiateur rêvé. Dans un autre axe de lecture, on peut néanmoins penser que le véritable lien, le médiatuer véritable n'est autre que la femme robotique, croisement entre l'homme et la machine, et ainsi trait d'union entre le cerveau (l'homme) et la machine (la main). Le centre de gravité de metropolis est donc mouvant entre ces deux potentialités.
On retrouve aussi dans Metropolis des moments qui préfigurent Les Temps Modernes de Chaplin ; avec le thème des masses épuisées par l'industrialisation galopante, transformés en zombies (la relève dans l'usine de Metropolis / les tour de clés mécaniques de Chaplin dans Modern Times), Metropolis offre une lecture sociale et avant-gardiste. La relation entre le patron de l'usine et le chef machinot, par écrans interposés, est illustré par des procédés très similaires.
Une nouvelle vision salutaire, qui témoigne de la richesse d'une oeuvre-monstre. Vivement le Blu-ray, pour le courant de l'année 2010 !

 Production Disney atypique, née de la vague de science-fiction déferlant sur le monde à l’époque, Le trou noir est assez méconnu, malgré un casting bien pourvu, jugez plutôt : Anthony Perkins, Robert Forster (Jackie Brown) et Ernest Borgnine (La Horde sauvage,
Production Disney atypique, née de la vague de science-fiction déferlant sur le monde à l’époque, Le trou noir est assez méconnu, malgré un casting bien pourvu, jugez plutôt : Anthony Perkins, Robert Forster (Jackie Brown) et Ernest Borgnine (La Horde sauvage, 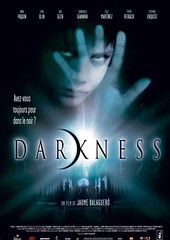 Shining reloaded
Shining reloaded Tout d’abord, une fois n’est pas coutume, permettez-moi de vous conter un midi peu ordinaire. Ce 25 janvier, je relève, comme d’habitude, ma boîte aux lettres, découvrant un colis m’étant adressé. Après une demi-seconde d'intense réflexion, je me rappelle avoir participé à un jeu sur
Tout d’abord, une fois n’est pas coutume, permettez-moi de vous conter un midi peu ordinaire. Ce 25 janvier, je relève, comme d’habitude, ma boîte aux lettres, découvrant un colis m’étant adressé. Après une demi-seconde d'intense réflexion, je me rappelle avoir participé à un jeu sur