Un film de Paul Verhoeven
 L'éditeur Filmédia réédite le 19 septembre 2012 La chair et le sang (Flesh + Blood) en DVD et en blu-ray (exclusivité française!), un des tous meilleurs films du réalisateur Néerlandais Paul Verhoeven ; malgré cela, il reste encore assez méconnu, encore aujourd'hui.
L'éditeur Filmédia réédite le 19 septembre 2012 La chair et le sang (Flesh + Blood) en DVD et en blu-ray (exclusivité française!), un des tous meilleurs films du réalisateur Néerlandais Paul Verhoeven ; malgré cela, il reste encore assez méconnu, encore aujourd'hui.
La chair et le sang nous offre un tableau du Moyen-âge barbare, violent et sensuel, concrétisant la promesse de son titre. On y retrouve Martin, interprété par Rutger Hauer, le Roy Batty de Blade Runner en 1982, entouré d'une bande de mercenaires complètement allumés. Leur ancien frère d'armes, Hawkwood, les a trahi au profit du seigneur Arnolfini. Qu'à cela ne tienne, Martin et sa bande retrouvent les deux hommes et enlèvent la belle-fille d'Arnolfini -interprétée par la toute jeune Jennifer Jason Leigh-, puis envahissent son château. Steven, un jeune homme érudit et passionné de science, à qui Agnès était promise, va tout faire pour la récupérer. L'esquisse du scénario ne dépareillerait pas dans la longue liste de films d'aventures moyen-âgeux qu'a pu produire hollywood durant son âge d'or : un preux chevalier vient arracher une princesse en détresse des griffes d'un bandit sans foi ni loi. Et pourtant, le film va à l'encontre de tous les poncifs du genre. Fini, les ciels radieux en Technicolor, les vilains grimaçants, les impeccables salles de banquets, les combattants virevoltant moulés dans leurs collants multicolores ! Au lieu de ça, le film table sur la peinture sans concession d'une époque sombre et cruelle, bâtie sur une succession d'ambiguïtés.
Tous les personnages sont montrés sous leurs mauvais jours, les nobles et les religieux complotant, les mercenaires sont incultes et violents ; Steven, le jeune érudit, est le seul à n'être que l'incarnation de l'amour romantique par excellence... que le réalisateur tente à tout prix de désamorcer : le serment d'amour de Steven et Agnès se déroule au pied d'un arbre où deux pendus bien amochés sont en train de pourrir ! D'autre part, ce sont les méchants qui sont les héros de la chair et le sang, prenant la encore le contre-pied du film de chevalerie.
De même, deux mondes s'opposent, symbolisés chacun par un des personnages : La chair et le sang, c'est le moyen-âge contre la renaissance, la croyance contre la science et la connaissance, Martin contre Steven. Au centre de toutes les attentions, le personnage d'Agnès est double, tout à la fois amoureuse de l'esprit de Steven et du corps de Martin : d'abord inexpérimentée, elle sera violée par la bande, puis ensuite, avec Martin, elle découvrira contre toute attente un plaisir inégalé. Leur scène d'amour dans un bain vaporeux, capte une puissance érotique incomparable, ce qui rappellera aux amateurs que Verhoeven a plus tard réalisé Basic Instinct, avec là encore, une blonde incendiaire, Sharon Stone. On est bien loin de l'image vierge et diaphane de la princesse « classique ». Lors d'une tentative de sauvetage, une invention de Steven suscite même le rire, sûrement non intentionnel, tellement la grosse machine en bois qui s'avance devant la portez du château ressemble à celle qu'on a pu apercevoir dans Monty Python sacré Graal !
On a sûrement là une des preuves des difficultés rencontrées sur le film, tant Verhoeven a perdu la bataille du contrôle sur La chair et le sang ; il s'est en effet vu imposer l'histoire d'amour entre Agnès et Steven par Orion films, alors que lui aurait aimé axé tout la dynamique sur la lutte entre les deux anciens frères d'armes désormais ennemis. D'un autre côté, Rutger Haurer, comédien fétiche du cinéaste, veut le beau rôle : il un beau début de carrière aux états-unis -Blade Runner en 82 avec Ridley Scott, Ladyhawke de Richard Donner en 1985, film dans lequel il a une rôle chevaleresque aux côtés de Michelle Pfeiffer- ; mais cela n'y change rien : son personnage est un bandit violent, Verhoeven et Hauer se brouillent et à ce jour La chair et le sang constitue leur dernière collaboration.
Le film n'est pas non plus avare en violence de toute sorte ; la bataille qui inaugure le métrage, qui permettra à Arnolfini de retrouver sa cité, en est un bon exemple : membres arrachés, têtes scalpées, rien n'est vraiment épargné au spectateur. Plus tard, la peste jouera un rôle prépondérant dans le film, se propageant dangereusement dans la région. C'est un peu la marque de fabrique de Verhoeven, qu'on surnomme le Hollandais violent ; il réalisera deux ans plus tard son premier film américain, RoboCop, qui laisse là aussi quelques traces ensanglantées dans l'imaginaire des cinéphiles. C'est la violence et les excès en tous genres (sexe, amoralité) qui sont la cause de son départ des Pays-Bas, où il a pu tout de même réaliser de véritable perles ; on pense à Katie Tippel, l'odyssée d'une jeune femme qui, d'une pauvreté sans nom, arrivera à s'insérer petit à petit dans l'aristocratie ; ou encore à Soldier of Orange, un film de guerre très romanesque avec déjà Rutger Hauer dans le rôle principal. La chair et le sang est son premier tourné hors de son pays, en langue anglaise. C'est une véritable charnière dans la carrière de Verhoeven, qui œuvrera par la suite principalement aux Etats-Unis (il ne reviendra tourner dans son pays qu'au milieu des années 2000, pour le très beau Black Book).
La très belle musique de Basil Poledouris, dans la mouvance de son travail sur le magnifique Conan le barbare, est puissante et entraînante, participant à donner au fil sa réalité historique.
Mélange détonnant, excessif et jouissif, La chair et le sang saura faire oublier ses quelques anachronismes, restant aujourd'hui un des plus grands films sur le Moyen-Âge : à (re)découvrir de toute urgence !


 Une mère traumatisée à vie (à mort) par le meurtre de sa petite fille reçoit cinq ans après ce terrible fait divers un coup de fil. Sa fille l’appelle…
Une mère traumatisée à vie (à mort) par le meurtre de sa petite fille reçoit cinq ans après ce terrible fait divers un coup de fil. Sa fille l’appelle…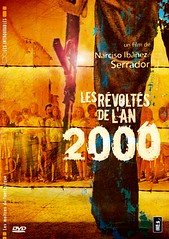 Un traumatisme. Un malaise dérangeant et durable. Le cinéma mondial n’avait alors que peu de représentants du genre des enfants tueurs, si bien qu’on a du mal trouver un précédent valable. Le très bon Le village des damnés (1960), de Wolf Rilla, dont John Carpenter signa
Un traumatisme. Un malaise dérangeant et durable. Le cinéma mondial n’avait alors que peu de représentants du genre des enfants tueurs, si bien qu’on a du mal trouver un précédent valable. Le très bon Le village des damnés (1960), de Wolf Rilla, dont John Carpenter signa 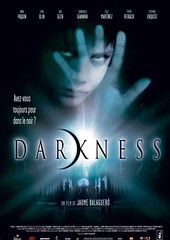 Shining reloaded
Shining reloaded