Un film de Tony Scott Il est amusant de voir à quel point certains films, pourtant calibrés et vendus tels des produits comme les autres, révèlent malgré tout des constantes chez des réalisateurs ; j’en veux pour preuve ce Revenge qui, mettant en avant un Kevin Costner charismatique en diable (c’était sa grande époque, juste avant son Danse avec les loups, Bodyguard et l'année du puissant JFK), propose par sa séquence d’introduction -un vol d’avions de combat-, une prolongation à Top Gun, réalisé par Scott quelques années auparavant. Le personnage de Cochran (Costner) peut tout à fait personnifier le Maverick de Top Gun, en fin de carrière. Les deux personnages ont d’ailleurs un caractère similaire et une voix française particulièrement proche -il s’agit de Michel Papineschi, doubleur officiel de Robin Williams et par ailleurs de John Shea / Lex Luthor dans la série Loïs et Clark : les nouvelles aventures de Superman.
Il est amusant de voir à quel point certains films, pourtant calibrés et vendus tels des produits comme les autres, révèlent malgré tout des constantes chez des réalisateurs ; j’en veux pour preuve ce Revenge qui, mettant en avant un Kevin Costner charismatique en diable (c’était sa grande époque, juste avant son Danse avec les loups, Bodyguard et l'année du puissant JFK), propose par sa séquence d’introduction -un vol d’avions de combat-, une prolongation à Top Gun, réalisé par Scott quelques années auparavant. Le personnage de Cochran (Costner) peut tout à fait personnifier le Maverick de Top Gun, en fin de carrière. Les deux personnages ont d’ailleurs un caractère similaire et une voix française particulièrement proche -il s’agit de Michel Papineschi, doubleur officiel de Robin Williams et par ailleurs de John Shea / Lex Luthor dans la série Loïs et Clark : les nouvelles aventures de Superman.
Outre cette première remarque, Tony Scott trousse un film étrange, qu’on peut sans mal qualifier de schizophrène. On y voit en effet s’opposer deux parties clairement distinctes.
Dans la première partie, Kevin Costner s’amourache de la belle Madeleine Stowe, amour interdit car c’est la femme d’une sorte de parrain, autrement bon pote avec Costner. Cette première partie est vraiment à la limite du ridicule aujourd’hui, oscillant entre un esprit Harlequin (pas les bonbons, hein, la série de bouquins), je dis bien esprit car je m’attache juste à leurs couvertures incroyablement kitsch, et une bluette digne d’un téléfilm érotique qui firent les chaudes soirées de M6. Le summum étant la scène "torride" en voiture décapotable, le Costner faisant presque claquer le string de la jeune femme quand elle lui monte dessus. Notez quel sens de la poésie étreint soudain les lignes de cette chronique ! Érotisme de bas étage donc, souligné au stabilo par une musique d’ascenseur, au synthé, toujours de la même eau. On se dit alors, pourquoi pas, ok, mais le film s’appelle Revenge, alors elle arrive quand cette vengeance ? Elle arrivera, mais il faudra attendre... attendre encore... et là, quand les deux tourtereaux sont pris sur le fait, ça commence !
La fameuse vengeance du bad guy (Anthony Quinn, toujours vif) fait totalement bifurquer le ton du métrage : violent, viscéral, limite vigilante movie, la deuxième est aussi excessive dans les images chocs que l’était la première dans la guimauve. La jeune femme défigurée et un Kevin Costner tuméfié sont, il faut bien l’avouer, assez marquantes.
La furie presque barbare de la deuxième partie emporte l’adhésion, mais le souvenir de la première, terriblement datée, reste l’impression la plus prégnante qui se dégage du film. Mais peut-être que Tony Scott n’est pas ma tasse de thé...
Le film était presque parfait - Page 88
-
Revenge (1991)
-
Cypher (2003)
Un film de Vincenzo Natali
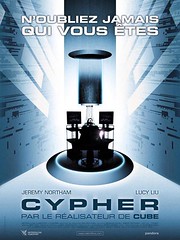 Même si je ne pense pas que ce film soit "indéfendable", il reste tout du moins mésestimé par le plus grand nombre. Il s’agit s’un trip très construit, à cheval entre espionnage, SF et thriller paranoïaque, dans lequel Morgan Sullivan (Jeremy Northam) incarne l’homme ordinaire qui veut changer de vie : il devient alors espion industriel pour la firme Digicorp, mais ses missions sont, comment dire, loin de celles d’un James Bond, jugez plutôt : il se rend à des conférences pour enregistrer des discours sans intérêt... On se doute rapidement qu’il est utilisé.
Même si je ne pense pas que ce film soit "indéfendable", il reste tout du moins mésestimé par le plus grand nombre. Il s’agit s’un trip très construit, à cheval entre espionnage, SF et thriller paranoïaque, dans lequel Morgan Sullivan (Jeremy Northam) incarne l’homme ordinaire qui veut changer de vie : il devient alors espion industriel pour la firme Digicorp, mais ses missions sont, comment dire, loin de celles d’un James Bond, jugez plutôt : il se rend à des conférences pour enregistrer des discours sans intérêt... On se doute rapidement qu’il est utilisé.
Opérant une variation chromatique tout au long du film, passant d’un ensemble désaturé qui s’agrémente peu à peu de couleurs, pour finir dans une apothéose bariolée, Vincenzo Natali construit son film par petites touches impressionnistes. Le moment du premier véritable envahissement de couleurs à l’écran accompagne ainsi la révélation conjointe, pour le personnage principal comme pour le spectateur, d’une première vérité, dans ce monde où l’information semble toujours cachée. De plus, le glissement progressif d’un genre à l’autre suit cette variation chromatique, et la découverte progressive de la vérité par Sullivan. Même si le début du métrage fait invariablement penser à un Matrix du pauvre, il ne faut pas s’y fier. Derrière un budget qu’on n’imagine certes pas à la hauteur des ambitions du cinéaste -les effets spéciaux sont très visibles-, le film déroule sa trame avec une droiture et une absence d’ironie qui le sert bien. Le jeu des doubles, illustré ici jusqu’aux antagonismes des multinationales qui s’affrontent, donne un léger vertige par la richesse des virages scénaristiques, qui s’estompera cependant bien vite, n’ayez crainte. La dernière partie, qui démêle le vrai du faux, est jouissive pour qui y est réceptif (j’en suis, évidemment).
Lucy Liu est bien castée dans un rôle ambigu, personnage coloré et atypique dans un univers formaté où l’on ne parle que de données échangées, volées, à prendre... Jeremy Northam, quant à lui, a la bonne tête et les manières maladroites de l'homme dépassé par les événements, mais qui jouit en même temps de ce revirement dans sa vie. Northam reste, malheureusement, trop discret dans le paysage cinématographique.Ne se prétendant pas autre chose qu’un divertissement, le film surprend par sa foule d’idées, dont certaines sont franchement casse-gueule -la citation de La mort aux trousses, transposée de nuit, et l’apparition qui s’en suit-, mais qui organise tranquillement sa petite réussite, en sachant bien qu’il ne révolutionne pas le genre. Je rapprocherais volontiers Cypher d’un Passé Virtuel (Josef Rusnak, 1999), voire d’un Planète hurlante (Christian Duguay, 1996), deux films qui n’ont pas la réputation qu’ils méritent. Sans être des chefs d’œuvres évidents, ils sont des réussites, tant formelles que scénaristiques, et font du bien pour leur fraîcheur.
-
Ciné d'Asie : Un seul bras les tua tous (1967)
-
Capricorn One (1978)
Un film de Peter Hyams
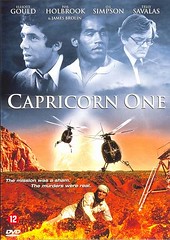 La première originalité du film de Peter Hyams, réalisateur semblant fait avant tout pour filmer l’action (Timecop, Mort subite), est son incroyable idée de départ, un vaste complot politique qui aboutit à la falsification d’un voyage sur Mars. Alors que les médias de toute la planète sont focalisés sur le voyage et l’atterrissage des spationautes américains sur la planète rouge, ces derniers sont retenus dans un grand hangar, devenu pour l’occasion véritable plateau de cinéma, afin de simuler le bon déroulement de leur voyage.
La première originalité du film de Peter Hyams, réalisateur semblant fait avant tout pour filmer l’action (Timecop, Mort subite), est son incroyable idée de départ, un vaste complot politique qui aboutit à la falsification d’un voyage sur Mars. Alors que les médias de toute la planète sont focalisés sur le voyage et l’atterrissage des spationautes américains sur la planète rouge, ces derniers sont retenus dans un grand hangar, devenu pour l’occasion véritable plateau de cinéma, afin de simuler le bon déroulement de leur voyage.
Cette idée s’inscrit dans la grande thématique du complot gouvernemental, comme on a pu le voir dans la vague de thrillers paranoïaques des années 70. D’ailleurs, on décèlera dans les dialogues du film une énième référence à l’affaire du Watergate, illustrée par une des plus grandes réussites du genre, Les hommes du président. Ce concept sera repris avec jubilation dans un fameux documenteur, Opération Lune, de William Karel, qui part du principe que le gouvernement américain aurait demandé l’appui de Stanley Kubrick pour réaliser le faux alunissage de la mission Apollo 11 (un faux documentaire extraordinaire).
Si la première partie est bien de cette trempe, la seconde voit le journaliste Robert Caulfield (Elliott Gould, acteur rare) se focaliser sur les éléments inhabituels de cette mission, on retrouve alors la dimension journalisme d’investigation menacée par des instances et des intérêts qui dépassent tous les protagonistes. La troisième, plus spectaculaire dans l’action, voit une course-poursuite s’engager entre les spationautes et les agents du gouvernements. Le lien entre ces trois parties, relevant chacune d’un type de cinéma particulier, donne au film une richesse et une force indéniable. La poursuite est notamment très réussie, avec en point d’orgue un grand huit en avion qui décoiffe sévère, plus de 30 ans après sa réalisation.
Lorsque nos trois spationautes se retrouvent dans le désert, il se dégage comme un parfum de fantastique, nous ramenant au premier Planète des singes, dans lequel l’arrivée des hommes sur ladite planète recèle de moments, de décors et de costumes identiques.
Épaulé par un casting astucieux (mis à part O.J. Simpson, spécialiste du regard vide), il montre notamment un James Brolin charismatique dont la ressemblance avec Christian Bale peut parfois être troublante. La participation de Telly Savalas, monsieur Kojak (mais aussi temporaire Blofeld chez James Bond) est assez savoureuse.
Haletant, soutenu par une caméra mobile, dont une grande valeur se dégage de son scénario incroyable, on découvre ici un film assez méconnu qui constitue en l’état un moment de cinéma à l’ancienne tout à fait honnête. -
Watchmen - Tales of the Black Freighter (2009)
Un film de Daniel DelPurgatorio & Mike Smith
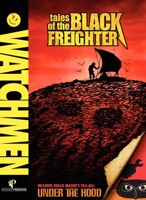 Bizarre, cette vision de ce qui devait être, à l’origine, inclus dans la version ciné du Watchmen de Zack Snyder. Rappelons que ledit-film, adaptation du comics de Alan Moore et Dave Gibbons, devait faire état d’un passage assez magistral dans la BD, à savoir un jeune noir lisant un bande d’aventures plutôt gore, celle-ci ayant des correspondances avec l’histoire principale du film ; d’où une mise en abîme originale et particulièrement réussie.
Bizarre, cette vision de ce qui devait être, à l’origine, inclus dans la version ciné du Watchmen de Zack Snyder. Rappelons que ledit-film, adaptation du comics de Alan Moore et Dave Gibbons, devait faire état d’un passage assez magistral dans la BD, à savoir un jeune noir lisant un bande d’aventures plutôt gore, celle-ci ayant des correspondances avec l’histoire principale du film ; d’où une mise en abîme originale et particulièrement réussie.
La vision indépendante de ce récit est troublante car on sent clairement qu’il manque quelque chose, sur le strict plan narratif. En l’état, le film prend le format d’un épisode de série animée de 20 minutes, d’habitude utilisé pour de nombreuses séries pour enfants. Ici, point de tout cela ; on est dans le gore et l’horrible, la trame pouvant ressembler à un Conte de la Crypte sous acide (quel épisode de cette série ne l’est pas, d’ailleurs ?). Un marin est le seul survivant d’une attaque de pirates sanguinaires ; il se retrouve seul sur un petit bout d’île, avec comme seuls compagnons les corps sans vie de ses camarades d’infortune, une nuée de charognards aux aguets. La suite ne sera que plongée dans une folie dure, hallucinations comprises. Le bougre arrivera à s’extirper de l’île dans le seul moment d’anthologie gore assez peu vu ailleurs, en animation comme en prises de vues réelles.
L’argument est un peu mince, mais de plus il n’est pas aidé par une animation approximative (mis à part les éléments en numérique, tels les sombres flots d’une mer déchaînée), les personnages n’ayant tous qu’une seule et même expression. Si cela ne suffisait pas, le design général marque par sa grande laideur esthétique (Mon dieu, ça, c’était des requins ?!, ne pourra-t-on s’empêcher de se demander à l'occasion).
On en retiendra tout juste un enchaînement non-stop de morts en décomposition et de meurtres, ce qui n’est pas donné à tout film d’animation qui se respecte. Mais cette oeuvre, qui n’en est pas vraiment une, faisant partie d’un tout beaucoup plus grand qu’elle, peut-elle être considérée comme telle ? La question mérite d’être posée, et nous répondrons non, tant la sensation d’avoir assisté à un fragment d’histoire reste ancré après le visionnage.