Un film de Jaume Balaguero
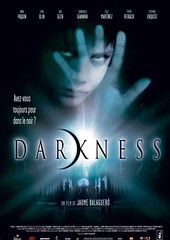 Shining reloaded
Shining reloaded
Un couple et ses deux enfants, Paul et Regina, s’installent dans une vieille maison à la campagne. Le mari commence à avoir un comportement colérique, et c’est le début d’une longue descente aux enfers...
Darkness a un scénario bien dégraissé ; son objet est, de même, aussi simple qu’insondable, la peur du noir. On se retrouve donc en quasi huis-clos dans cette maison à l’allure bien étrange, où les apparitions ne vont pas tarder à surgir. Car, à la différence de Shining (Stanley Kubrick, 1980), dont c’est le grand modèle, le film ne lésine pas sur la réalité du malaise procuré par la maison ; il se manifeste par des entités physiques dès le début du film. Le film joue donc sur l’explicite, mais avec un savoir-faire évident. De même, il investit le terrain ô combien classique des films de maison hantée, mais y apporte un tel soin que c'en est intimement flippant. Au rayon des ressemblances, autant hommage que pillage, voire remake, le mari a les mêmes expressions de folie que Jack Nicholson / Torrance, le petit garçon a une voix tout à fait similaire au Danny Lloyd de l’hôtel. La maison est évidemment une déclinaison de cet Overlook Hotel, partageant avec lui les mêmes teintes cendrées et les apparitions de sœurs jumelles en souffrance. Rien que le resserrement narratif à base de cartons indiquant les jours passant (Tuesday, premier choc temporel, dans Darkness comme dans Shining) en fait un véritable relecture contemporaine, avec en sus les tics de mise en scène de Balaguero. Un montage sensitif, la caméra bougeant au même rythme -infernal- que le cœur des personnages principaux, associé à des bruitages stridents dérangeants (comme des ongles qui grattent un tableau d’ardoise, ou bien encore des dents qui grincent, ça doit parler à tout le monde), une mise en scène qui se voit, à base de symétrie, de travellings proprets, de nombreux inserts, ... Puis, deuxième marque de fabrique de Balaguero, le caractère désespéré de ses scénarios, érigés en principe narratif. Aucune échappatoire n’est laissée, à personne. Que ce soit dans son premier La secte sans nom (1999), terrifiant, ce Darkness, à la fin tout aussi glaçante, bien que moins dérangeante, jusqu’à [Rec.] (2008), en passant par le téléfilm A louer (2006), le message est clair. Lorsque les portes du film se referment, elles retiennent en otage tous le monde, y compris les spectateurs, pris aux tripes par ces aventures qui voyagent jusqu’aux extrêmes de la peur. Il n’y a guère que dans Fragile, qui, malgré une fin triste, nous en laisse moins sur le cœur.
L’autre versant vers lequel penche le film est l’horreur transalpine, tant l’intérieur de la maison, ainsi que l’appartement du grand-père, convoque le cinéma d’Argento et de Mario Bava. Des vitres aux couleurs franches et lumineuses, avec beaucoup de vert (couleur souvent associée à la peur et à la mort) et de rouge, mais aussi des jaunes et des bleus. On pourrait se croire dans le pensionnat de Suspiria (Dario Argento, 1977), ou dans Les trois visages de la peur (Mario Bava, 1966). Tous ces films ont aussi en commun la manipulation perverse du spectateur, qui s’embarque dans une histoire, prend quelques personnages pour repères, souvent ceux-là mêmes qui sont l’origine du mal. Là encore, on peut penser à Anthony Shaffer, un des premiers scénaristes à avoir essayer cela au cinéma, avec grande réussite (Le limier, de Mankiewicz, The Wicker Man de Robin Hardy ou Frenzy d’Alfred Hitchcock).
Pour Balaguero, l’exploration de la peur sous toutes ses coutures, et l’obsession de remonter à la source de la peur, semble être la même fascination morbide qui animait Hitchcock et son éternel crime parfait. Et le cinéaste espagnol de répondre que c’est au sein du cercle où l’on est sensé être le plus en sécurité que peut jaillir le plus terrible des cauchemar. La peinture de ce cauchemar, dans le dernier quart du film, aura inspiré Christophe Gans pour son Silent Hill (2005), avec ses murs sanguinolents, représentation assez classique des feux éternels de l’enfer. Ceci dit, ici l’enfer est plus représenté par l’obscurité que par la chaleur rougeoyante des flammes. Sur ces impressions qui resteront encore longtemps après projection, je vous souhaite une bonne nuit ! (m’en vais me regarder un Tex Avery, moi... Brrrr !)
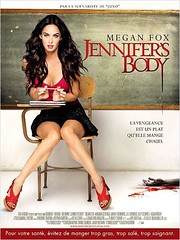 Le corps de Megan
Le corps de Megan Ah, on l’attendait, ce film du renouveau, du réalisateur des Spider-Man (mais surtout de la trilogie Evil Dead et de Darkman !) ; Jusqu’en enfer s’annonçait alors comme un retour aux sources vers les contrées horrifiques qui avaient fait la renommée du cinéaste américain. Retrouve-t-on la maestria d’un Evil Dead dans son nouvel opus ?
Ah, on l’attendait, ce film du renouveau, du réalisateur des Spider-Man (mais surtout de la trilogie Evil Dead et de Darkman !) ; Jusqu’en enfer s’annonçait alors comme un retour aux sources vers les contrées horrifiques qui avaient fait la renommée du cinéaste américain. Retrouve-t-on la maestria d’un Evil Dead dans son nouvel opus ?
