Un film de Don Sharp
 Chez la Hammer Film, il y a les cinéastes et les œuvres révérés, considérés comme majeurs, et les autres. Ainsi, Terence Fisher, Val Guest, John Gilling sont incontestablement les chefs de file. Don Sharp, lui, est défintivement un "autre", bien loin de cette sphère auréolée, malgré une indéfectible fidélité envers la firme, et de bons films à son actif. On lui doit ainsi Les pirates du diable (1964), les premiers Fu-Manchu (1965) et Raspoutine, le moine fou (1966), tous avec Christopher Lee dans le rôle-titre, LA star Hammer.
Chez la Hammer Film, il y a les cinéastes et les œuvres révérés, considérés comme majeurs, et les autres. Ainsi, Terence Fisher, Val Guest, John Gilling sont incontestablement les chefs de file. Don Sharp, lui, est défintivement un "autre", bien loin de cette sphère auréolée, malgré une indéfectible fidélité envers la firme, et de bons films à son actif. On lui doit ainsi Les pirates du diable (1964), les premiers Fu-Manchu (1965) et Raspoutine, le moine fou (1966), tous avec Christopher Lee dans le rôle-titre, LA star Hammer.
Avant cela, on donne au Don l’occasion de réaliser ce Kiss of the Vampire, en plein dans la vague des Dracula de maître Fisher, alors que Christopher Lee rechigne déjà à chausser les crocs une nouvelle fois pour ses macabres aventures pelliculées.
Et, hors continuité Dracula, on va alors assister à l’un des meilleurs crus vampirique de toute la filmo Hammer, pas moins !
L’introduction est classique : un cortège funèbre, des gens éplorés, puis, au loin, une silhouette solitaire qui se détache. Un plan rapproché nous le rend plus détaillé : c’est un homme âgé, observant la procession d’un œil anxieux. Les croque-morts font descendre le cercueil vers l’endroit de son dernier refuge, et notre homme est tout près : alors qu’on lui tend une pelle pour verser la première fournée de terre, il la jette violemment vers le cercueil, lequel ne résiste pas à la force du coup : défoncé, le corps gisant en son sein forme une flaque de sang d’un rouge envahissant. Les villageois sont horrifiés : cette réaction est, encore une fois, assez typique. Puis vient un curieux plan, qui zoome sur le cercueil éventré, pour finir en flou et transiter sur un nouveau plan, le visage d’une jeune fille, à l’intérieur du cercueil. De l’extérieur vers l’intérieur, cette transition est très bien amenée est pas si fréquente chez les Dracula et consorts, qui se bornent en général à l’aspect, certes photogénique, de l’extérieur du cercueil comme plan d’introduction (voir celle des Cicatrices de Dracula, 1970, typique). La vue de ce plan dans Kiss of the Vampire nous révèle la nature vampirique de la jeune personne, crocs dehors.
Après cette introduction marquante, se déroule une trame scénaristique pas si commune : un jeune couple en lune de miel tombe en panne au beau milieu des paysages sylvestres d’Europe centrale. Alors que l’on sent une présence scrutant leurs moindres déambulations, des aubergistes les accueillent dans leur maisonnée. Le jeune couple va alors être convié chez le renommé docteur Ravna. On note au passage le changement d’échelle sociale : de comte, le nouveau vampire (car oui, ce sera lui : Ravna, Dracula, la proximité sonore suffisant à tisser un lien entre les deux) passe à une autre étiquette. Après la première apparition d’un véhicule motorisé, le vampire nouveau est un docteur : un vent de modernité soufflerait-il sur le film ?
Lors de la première soirée passée chez ce bon docteur, la scène de séduction vampirique (passage obligé, tout de même) est effectivement différente des habituels regards -écarquillés et fixes- du vampire en titre. Ici, c’est la musique, un air de piano sombre et envoûtant, qui sert de vecteur à la fascination qui va s’exercer sur la jeune mariée, son mari ne suspectant de son côté absolument rien.
L’idéologie vampire défendue film est étonnante et originale, un esprit sectaire baignant le tout : habillés de blanc, de fiévreux adeptes attendent l’apparition toujours théâtrale d’un docteur Varna, au brushing par ailleurs toujours impeccable.
L’utilisation parcimonieuse des codes vampiriques (gros plans incessants sur les dents pointues, sous-texte sexuel évident), ainsi que l’arrivée tardive du tueur de vampires fait qu’on a plus l’impression de regarder un film qui utilise le thème du vampire comme rouage pour raconter son histoire, mais qui n’est pas centré dessus, ce qui donne une certaine fraîcheur pour les habitués des productions Hammer de l’époque. En 1962, rappelons que la firme n’a alors sorti que Le cauchemar de Dracula (1958) et Les maîtresses de Dracula (1960), réalisés tous deux par Terence Fisher -encore lui !
Enfin, la soirée masquée, toujours tenue chez Ravna, installe un climat très fantastique et baroque, à l’aide de masques grimaçants très graphiques. Vraie réussite, sans fausse note dont un beau final, ce Baiser du vampire est à voir séance tenante ! Oui, mais... il reste désespérément inédit en DVD français, et n’est disponible uniquement en import américain, sans sous-titres... Amis anglophiles, foncez !
Critiques de films - Page 65
-
Le baiser du vampire (1962)
-
Le crime était presque parfait (1954)
Un film de Alfred Hitchcock

Il fallait y passer tôt ou tard, à ce film qui donne son nom à ce blog. C’est, aussi bizarrement, le premier Hitchcock chroniqué en ces lignes. On ne l’avait pas revu depuis un bon moment, je dirais même que cela remonte à notre programmation de ce film au sein d’un ciné-club universitaire, en Avignon, aux alentour de la fin 2003. Notre souvenir en était un film plaisant, mais sans plus.
Adapté d’une pièce de théâtre de Frederix Knott, auteur déjà utilisé par Hitchcock pour La Corde (1948), Le crime était presque parfait a des similitudes avec ce même film. Il s’agit d’abord de la perpétration d’un crime parfait, mûrement réfléchi ; Tony Wendice (Ray Milland) prépare depuis au moins un an le meurtre de sa femme, tandis que La Corde voit deux hommes tuer un total inconnu, raison même, pensent-ils, de leur innocence. Ressemblance assez frappante aussi, avec L’inconnu du Nord-Express (1951), dans lequel Guy Haines (Farley Granger), tennisman, comme Wendice, se voit proposer un échange de meurtres, poursuivant toujours l’idée de la stratégie soi-disant parfaite de ce crime.
Histoire de meurtre donc, dont la présentation est un modèle d’économie narrative : un plan nous montre l’adorable couple Ray Milland - Grace Kelly s’embrasser, prendre le petit déjeuner, et le plan suivant nous montre le même baiser... sauf que le partenaire de Kelly a changé. Robert Cummings a pris la place de Ray Milland, et Grace Kelly est vêtue de rouge au lieu du blanc auparavant. L’image du couple idéal est démontée, et l’on sait désormais que sous les sourires de façade se cache un échec, celui du couple. Grace Kelly a l’air de s’ennuyer, tout comme Ray Milland, qui aura consacré un temps non négligeable aux préparatifs de son plan. On s’occupe comme on peut...
La première demi-heure est extrêmement bavarde, Wendice expliquant à un pauvre gars comment il a réussi à la piéger pour l’obliger à commettre le meurtre de sa femme. On pourrait se croire dans un épisode de Columbo un peu fade, mais la précision de l’explication, les dialogues aux mots si bien choisis, repris de la pièce, garantissent que l’on soit toujours menés vers un objectif clair. Le spectateur découvre ici, au fur et à mesure du premier récit de Wendice, comment il a échafaudé tout son plan. Avec quelle soin il a paramétré chacune des éventualités de l’affaire. C’est là, dans la différence entre l’extrême préparation et l’échec progressif de chaque action, que le film est intéressant. Une montre arrêtée, un meurtrier bien lourdaud, une improvisation continue de Wendice / Milland pour pallier aux ratés du plan, ... Tout s’emboîte finalement avec tant d’intelligence que l’intérêt du spectateur est continuellement renouvelé. Alors, même si Hitchcock ne compte pas ce film parmi ces réussites (voir le livre Hitchcock / Truffaut, à ce propos très éloquent), le public l’aura consacré comme un succès. Premier Hitchcock de Grace Kelly (qui jouera aussi dans Fenêtre sur cour (1954) et La main au collet (1955), il est tout de même honorable.
Si le film n’a pas la maestria visuelle de certaines réalisations du maître, certaines séquences sont très réussies, notamment celle du meurtre, commençant par cette montre arrêtée, et l’agression en direct au téléphone, un moment très bien géré. Entendre les cris étouffés de la victime, sans pouvoir rien y faire, n’est-ce pas le comble de l’horreur ? Ce ne l’est pas pour Wendice, qui, avec un accent bien sado-masochiste quand même, a attendu ce moment pendant des mois. C’est presque avec délectation qu’il reste pendu au téléphone, ne pipant mot, dans l’attente de la preuve sonore de la réussite du contrat.
Un film qui assure le minimum syndical, mais un minimum syndical d’Hitchcock ; ce qui reste toujours le haut du panier, question suspense !
Source image : affiche du film © Collection AlloCiné / www.collectionchristophel.fr
-
L'Énigme du Chicago Express (1952)
Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique du film :

-
Collateral (2004)
Un film de Michael Mann
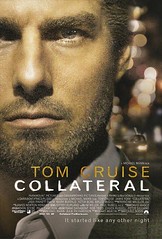 Cinéaste talentueux, bien qu’un brin surestimé (Public Enemies n’est pas, à mon sens, ce chef d’œuvre moderne que tant de critiques s’évertuent à porter aux nues), Michael Mann aime le polar, et nous les rend bien. Sous influence thriller (Le sixième sens, 1988), son approche est toujours esthétiquement marquante, et nous vaut une expérience unique. Cela va comme un gant à ce Collateral majestueux, avec ses ambiances de nuits chaudes à LA.
Cinéaste talentueux, bien qu’un brin surestimé (Public Enemies n’est pas, à mon sens, ce chef d’œuvre moderne que tant de critiques s’évertuent à porter aux nues), Michael Mann aime le polar, et nous les rend bien. Sous influence thriller (Le sixième sens, 1988), son approche est toujours esthétiquement marquante, et nous vaut une expérience unique. Cela va comme un gant à ce Collateral majestueux, avec ses ambiances de nuits chaudes à LA.Le mystérieux Vincent (Tom Cruise) prend un taxi pour une virée nocturne bien particulière ; cinq arrêts, autant de contrats à exécuter. Son conducteur, complice malgré lui, est un rêveur déçu qui va expérimenter une véritable leçon de vie. Ce duo improbable forme un buddy-movie étrange et fascinant, où la ville forme un troisième personnage à part entière. La palette chromatique du film, assez rare, oscille entre les marrons, verts et violets, capté par un prototype de caméra numérique, la Thomson Viper modifiée. Là se joue l’intérêt majeur de Collateral : on sent Mann en terrain d’expérimentation constant, façonnant des plans qui saisissent, avec la sensibilité particulière de l’objectif, les teintes de la nuit telles que le perçoit l’œil humain. Voir un quasi-désert est aussi en total décalage avec la ruche bourdonnante que devient Los Angeles en plein jour, donnant des allures westerniennes dans la jungle urbaine où se joue le duel entre deux personnalités antagonistes. A ce titre, la séquence qui voit Max (Jamie Foxx), le conducteur de taxi, ne pas stopper sa voiture malgré le dépassement de feux rouges, est symptomatique : il ne percute à aucun moment une autre voiture, bien que la tension soit présente à travers le regard du Vincent passager, perdant son calme pour la première fois.
Mann signe une balade, très musicale et très tendue, laissant souvent une large place à l’architecture de la ville. Au-delà du visuel, la prouesse de l’enchaînement des plans est une sensation d’espace et de localisation très exacte, tant on a l’impression de savoir à chaque moment où est qui. Les plans aériens, où ceux au sol en contre-plongée, se lient à la perfection ; parfois, Collateral fait penser à cet excellent jeu d’action qu’est Grand Thieth Auto. Si on pousse plus loin les corrélations, les ressemblances sont frappantes : un trajet en voitures, des arrêts fréquents (qui rappellent les stop aux cabines téléphoniques dans les premières versions), des coups de feu, ... Les éléments du décor étant aussi importants que les acteurs qui y évoluent.
Tom Cruise, y est méconnaissable. Perruque blanche, sourcils grisonnants, barbe... affublé de ce look, il n’a jamais joué comme cela : voix grave et sérieuse, corps monolithique, un prédateurs resserrant ses griffes sur des proies perdues d’avance. Magnétique, philosophe et toujours très concentré, préparé à tout et semblant invincible, il donne l’impression d’un lion. Ses réflexions profondes le font, de même, planer au-dessus du reste de la population. Et pourtant... il n’est qu’un exécutant, tueur à gages tenant ses ordres de plus haut. Tom Cruise donne dans ce film sa plus grande performance, avec La Guerre des Mondes, réalisé la même année, où il était, dans un autre registre, absolument bluffant.
Dernier point, la musique, omniprésente, donnant le rythme des séquences, éclairant ça et là l’état d’esprit des personnes en présence, semblant sortir de la radio du taxi driver. Mann a toujours donné une importance prédominante à la musique, qu’on peut entendre dès Sixième Sens, jusqu’à Miami Vice et Public Enemies (où il reprend à son compte l’esprit d’un Bonnie & Clyde). Il trouve ici le liant indéniable d’une fable des temps modernes, prédateurs contre proies dans le désert de la civilisation.
A lire aussi : la critique du film (bien différente) sur Nightswimming et chez Dr Orlof
-
Jusqu'en enfer (2009)
Un film de Sam Raimi
 Ah, on l’attendait, ce film du renouveau, du réalisateur des Spider-Man (mais surtout de la trilogie Evil Dead et de Darkman !) ; Jusqu’en enfer s’annonçait alors comme un retour aux sources vers les contrées horrifiques qui avaient fait la renommée du cinéaste américain. Retrouve-t-on la maestria d’un Evil Dead dans son nouvel opus ?
Ah, on l’attendait, ce film du renouveau, du réalisateur des Spider-Man (mais surtout de la trilogie Evil Dead et de Darkman !) ; Jusqu’en enfer s’annonçait alors comme un retour aux sources vers les contrées horrifiques qui avaient fait la renommée du cinéaste américain. Retrouve-t-on la maestria d’un Evil Dead dans son nouvel opus ?Drag Me To Hell (son titre original) se pose sur les bases on ne peut plus classiques des films de malédiction ; la personne maudite ne va cesser, dans ces films, d’être tourmentée à chaque coin de rue (parking ?) par une menace sourde, immatérielle mais bien réelle -du moins pour le spectateur.
La séquence d’introduction, sauvage en diable, nous met les pieds dedans avec une force indéniable. La manifestation de cette malédiction est personnifiée jusque dans les mouvement brusques et inattendus d’une caméra survoltée, rappelant la fameuse shaky cam chère à Raimi. La séquence amène à la présentation du titre, tellement bis, Drag Me To Hell remplissant tout l’écran de sa macabre invitation.
Puis vient la suite. Alison Lohman incarne un agent de banque guettant sa promotion, se prenant en pleine face (et c’est le cas de le dire) cette bonne vieille malédiction, par une gitane qui n’obtient pas son report pour le paiement d’un crédit. L’ambiance musicale entretient d’ailleurs, avec ses accents gypsy et son instrumentation traditionnelle, la filiation avec le feeling forain, et effectivement, on se croirait dans une fête foraine, un circus freak (bien propret quand même). S’enchaînent donc moult séquences survoltées, à la manière du plus old school des trains fantômes, avec cependant un net penchant pour la régurgitation régulière de liquides physiologiques tous plus dégueus les uns que les autres (comprenez : amis de la bave et du vomi verdâtre, soyez les bienvenus, vous êtes ici chez vous !). L’insistance carrément too much du réalisateur sur ces moments bien crades nuit à la cohérence de l’ensemble, surtout que la pauvre actrice s’en prend vraiment trop, tout en ne réagissant pas plus que ça à cette accumulation hors du commun.
Côté casting, parlons-en : la série B que nous pond l’ami Raimi n’est en aucun cas relevée par ses acteurs de second plan (remarquez, c’est plutôt cohérent), Lohman et Justin Long ne semblant pas vraiment à leur place. Seule la vieille (Lorna Raver, jusqu’ici coutumière de séries télé) est véritablement flippante. Le scénario qui se déroule péniblement sous nos yeux est un des plus prévisibles jamais vus, jusque dans son dénouement attendu. Sans conteste, on attendait bien mieux du film de Raimi, qui se rapproche plus, au final, de ses dernières productions sans envergure -The Grudge en tête- plutôt que de ses bonnes péloches passées.
S’il remplit le cahier des charges au niveau des sursauts de l’auditoire, l’ensemble fait figure de série B de luxe, photographiée sans talent et où, certes, la caméra fait quelques bonds, mais... ça ne me suffit pas. Décidément, après un laborieux Spider-Man 3, Raimi doit reconquérir son titre de grand cinéaste contemporain du Fantastique. Y arrivera-t-il ? J’ai bien peur que ce n’est pas en ajoutant un énième suite aux aventures de l’homme araignée qu’on puisse être convaincu...
Source image : affiche du film © Metropolitan FilmExport