Un film de Hirotsugu Kawasaki
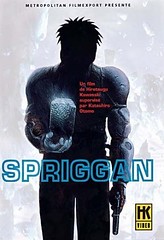 Spriggan fait partie de ces films d’animation japonais qui, bien que (ou à cause de) leur absence sur les écrans français, ont bénéficié d’un buzz important et ont vu leur réputation être surévaluée. Ici, cette surévaluation est également due à Katsuhiro Otomo, mangaka reconnu (Domû, rêves d’enfants et le scénario de Mother Sarah) et surtout créateur d’Akira ; il occupe sur Spriggan le poste de superviseur.
Spriggan fait partie de ces films d’animation japonais qui, bien que (ou à cause de) leur absence sur les écrans français, ont bénéficié d’un buzz important et ont vu leur réputation être surévaluée. Ici, cette surévaluation est également due à Katsuhiro Otomo, mangaka reconnu (Domû, rêves d’enfants et le scénario de Mother Sarah) et surtout créateur d’Akira ; il occupe sur Spriggan le poste de superviseur.
Résumer le propos de Spriggan est assez difficile, mais allons-y en deux mots : Une agence secrète travaille à la découverte et la préservation du savoir d’une société très ancienne. Leurs agents sont les Spriggan. Lors de la mise au jour de l’Arche de Noé sur le mont Ararat, le meilleur de ces agents, un lycéen du nom de Yu, est appelé sur les lieux pour empêcher la CIA de s’approprier la découverte.
On voit, après ces quelques lignes, la dimension casse-gueule que prend cette histoire assez complexe : entre anticipation, espionnage et fable fantastique, le film ne fait aucun choix et décide de traiter tout cela en même temps, sur une durée d’1h30. On a donc un premier problème avec le résultat final qui nous est présenté : il ne sait pas trop sur quel pied danser. Dernier point important sur la tonalité du film, il est conçu avant tout comme un film d’action tout juste bon à accumuler des séquences de courses-poursuites et d'explosions en tous genres. Le fil rouge du récit, cette mystérieuse Arche de Noé aux références bibliques, n’est d’ailleurs pas suffisante pour justifier tous ces éléments périphériques, étant elle aussi sacrifiée par le traitement narratif de l’ensemble.
Les scènes d’action sont certes bluffantes. La course-poursuite au début du film rivalise de nervosité et d’ampleur avec certains des meilleurs films live dans le genre. L’animation du métrage est d’ailleurs son vrai point fort : soignée, alternant les plans et les mouvements de caméra comme un film de prises de vues réelles, elle rappelle un petit chef d’œuvre sorti la même année, Jin-Roh, la brigade des loups (réalisé par Hiroyuki Okiura), qui produit le même effet tout à fait étrange : à partir d’un moment, on ne sait plus qu’on regarde un film d’animation. Cette sensation est toujours extrêmement rare car le principe même de l’animation en fait une œuvre réflexive. On est toujours devant une traduction / appropriation / recréation du réel. Ici, cette recréation calque tellement l’impression de réel que c’en est confondant. Découle de là un autre problème majeur, c’est qu’en étant si réaliste dans les mouvements des personnage et le rendu des décors, les scènes typiquement fantastiques semblent arriver comme un cheveu sur la soupe, à l’image de ces dinosaures (?!) à la poursuite de Yu, à l’intérieur de l’Arche de Noé. Le propos qui en découle, pseudo-écolo, ne trouve pas sa place dans le film, et n’est en tous cas amené avec aucun tact ; on ne peut échapper au ridicule lors de cette séquence.
Finalement, ce qui nuit peut-être le plus à Spriggan, c’est Katsuhiro Otomo. N’étant pas qu’une caution scénaristique ou visuelle, on retrouve dans Spriggan des éléments constitutifs d’Akira tellement similaires qu’on a l’impression de voir une histoire parallèle au chef d’œuvre post-apocalyptique du mangaka/cinéaste japonais. Entre les pouvoirs télékinésiques, les (faux) jeunes garçons qui dissimulent leur (vraie) vieillesse et une esthétique futuriste, le tout constitue un patchwork mal assemblé, qui aboutit à un fourre-tout scénaristique assez faible. Si sa qualité technique n’est pas à mettre en doute, on ne peut parler de réussite, et on conseillera plutôt aux amateurs de revoir le bon Jin-Roh.
-
-
La tour infernale (1974)
Un film de John Guillermin
 Après L’aventure du Poséidon il y a quelques temps, attachons-nous aujourd’hui au sommet du film catastrophe des années 70. A qui doit-on La tour infernale, parangon du genre ? Sûrement moins à John Guillermin, son réalisateur, qu’à la personne d’Irwin Allen, producteur et réalisateur surnommé "le roi des catastrophes" pour son apport au genre au fil des années ; il est d’ailleurs crédité ici de réalisateur des scènes d’actions, ce sui concerne une grande partie des 2h40 du métrage. La carrière de Irwin Allen est jalonnée par l’ombre de la catastrophe depuis les années 50. Déjà à la production de L’aventure du Poséidon en 1972, il réitère ici en promettant "plus de stars, plus d’action, plus de suspense" -dixit la bande-annonce d’époque.
Après L’aventure du Poséidon il y a quelques temps, attachons-nous aujourd’hui au sommet du film catastrophe des années 70. A qui doit-on La tour infernale, parangon du genre ? Sûrement moins à John Guillermin, son réalisateur, qu’à la personne d’Irwin Allen, producteur et réalisateur surnommé "le roi des catastrophes" pour son apport au genre au fil des années ; il est d’ailleurs crédité ici de réalisateur des scènes d’actions, ce sui concerne une grande partie des 2h40 du métrage. La carrière de Irwin Allen est jalonnée par l’ombre de la catastrophe depuis les années 50. Déjà à la production de L’aventure du Poséidon en 1972, il réitère ici en promettant "plus de stars, plus d’action, plus de suspense" -dixit la bande-annonce d’époque.
Après l’eau de The Poseidon Adventure, le nouveau danger de Le tour infernale est... le feu ! Pourquoi pas... De plus, la fameuse tour est un endroit tout à fait propice à la catastrophe, avec ses difficultés d’accès et ses quelques 135 étages qui en font un labyrinthe aux proportions homériques. Cette tour gigantesque est désignée comme la plus haute du monde dans le film ; elle représente le symbole de la réussite du monde capitaliste, mais ses dysfonctionnements nous montrent un tableau beaucoup moins reluisant : pour économiser les coûts de construction, on devine que tous les matériaux prévus par l’architecte (Paul Newman) ont été remplacés par de la marchandise bon marché. La tour va prendre feu et se déliter, petit à petit, à l’image du moral en berne de l’Amérique, en ces temps de crise pétrolière. La tour devient le symbole de cet idéal mis à mal, ainsi que le vestige d’un âge d’or hollywoodien qui a passé la main : les Coppola et consorts, inspirés par le cinéma européen, prennent d’assaut la Mecque du cinéma, cassant les limites d’un certain classicisme. Classicisme dont il est question ici ; on remarquera que les films catastrophes des années 70 font la part belle aux derniers représentants de cet âge d’or disparu, William Holden, Shelley Winters dans l'Aventure du Poséidon et même Fred Astaire dans le film qui nous intéresse aujourd’hui. Bien sûr, les rôles principaux sont tenus par des hommes dans la force de l’âge, ici Steve McQueen et Paul Newman, représentant ce besoin de héros et d’espoir dans cette décennie 70. Car si on décèle une mise en évidence de la lente désillusion face à l’idéal capitaliste, La tour infernale n’en reste pas moins un éloge sans équivoque à l’héroïsme et au sacrifice face à une situation de crise. L’accroche inaugurale ne vante-elle pas le courage des pompiers, auxquels est dédié le métrage ? C’est également une démonstration de force à l’américaine, qui déploie les grands moyens, techniques et humains, pour venir à bout de l’incendie : les voitures et camions de pompiers et autres hélicoptères déboulent dans le panorama à grands bruits. Newman, une fois la catastrophe passée, voudrait que la tour devienne "un temple dédiée à la connerie humaine" ; sa pensée est assez représentative de ce cinéma de crise, mais qui laisse néanmoins place à l’espoir.
Plus efficace que L'aventure du Poséidon, notamment dans les mises à mort des personnages -Robert Wagner et sa femme, seuls, prisonniers de flammes-, le film se caractérise par la surenchère, typique au genre. S’il a dû coûter plus cher, le film est également plus long, et il sa passe un certain temps avant le début de la catastrophe ; cela permet à tous les éléments constitutifs du drame (plans de construction non respectés, rapports de force père/fils, lien entre les personnages principaux) d’être clairement établis. Chose intéressante, alors que l’on pouvait entendre la chanson The morning after pendant l’Aventure du Poséidon, elle laisse la place ici à We may never love like this again ; alors que la première était plutôt positive, pleine d’espoir en n’omettant pas une situation difficile, la seconde est plus fataliste, et marque une plongée plus profonde dans le pessimisme, qui s’installe durablement.
Côté suspense, un film tout à fait recommandable, également radiographie de la période 70's américaine. -
Broadway Danny Rose (1984)
Un film de Woody Allen
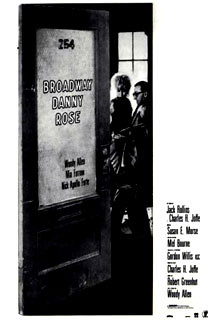 Nous sommes en 1984 et le cinéma de Woody Allen a déjà ses points culminants (Manhattan, Annie Hall, La rose pourpre du Caire). Son style est clairement établi : intellectuel, névrosé, parfois romantique et surtout, terriblement caustique.
Nous sommes en 1984 et le cinéma de Woody Allen a déjà ses points culminants (Manhattan, Annie Hall, La rose pourpre du Caire). Son style est clairement établi : intellectuel, névrosé, parfois romantique et surtout, terriblement caustique.
Danny Rose est un manager étrange, fantasque, capable de tout pour remonter le moral de ses troupes. C’est LE seul personnage de ce film ; tous les autres ne sont que périphériques, ou, mieux, des extensions de Woody Allen lui-même. Son humour, son élocution, sont l’unique objet du film, qu’il habite intégralement. Le flot des mots, dans une dynamique d’invasion, semble dicter sa loi au montage et à l’enchaînement des séquences. Une incroyable drôlerie émerge de ce flux ininterrompu, marquant un des meilleurs crus comiques du cinéaste New-yorkais. Une énergie hors du commun anime le tout, et, assortie à une faible durée (à peine 1h20), permet à l’ensemble de ressembler à une sorte de performance, un one-man show délirant. Les épisodes de la vie de Danny Rose sont vus au travers du prisme de ses amis, qui en discutent, attablés à un restaurant. On retrouvera la même construction plus tard, dans Accords et désaccords (1999), où des interviews de personnes connues (dont Allen) cautionnent le récit. Zelig, fameux docu-menteur réalisé par Allen un an avant Broadway Danny Rose, atteste encore de cette hésitation, cette impression de réel donnée par un dispositif qui installe le propos dans une sorte de réalité alternée qui préside au film.
La mise en scène, construite de longs travelling ou de plans fixes très composés (rehaussés par le choix du noir et blanc, typique du Woody Allen de la période fin 70’s-début 80’s) permet d’apprécier le spectacle d’un peu plus loin, ne se bornant pas à des plans rapprochés, ou à une simple mise en scène fonctionnelle, comme c’est le cas dans les films plus récents de Woody Allen.
Le passage de la poursuite dans le hangar à mascottes de la parade est un grand moment : après un coup de feu, une des baudruches est percée, laissant échapper dans l’air sa charge d’hélium. Les incartades entres les personnages prennent alors l’aspect d’un humour "cartoon" à la Tex Avery, à cause des voix, déformées par le gaz. C’est un bon exemple de l’imagination assez magique dont déborde le film. Mia Farrow, méconnaissable, fait penser à Faye Dunayay dans ce rôle d’une italienne hautaine, tellement high class comparé au pauvre Danny Rose que leur histoire donne au film un bel air de fantaisie, voire de parodie. En somme, un chef d’œuvre relativement méconnu du cinéaste. -
Yakuza (1975)
-
Ivanhoé (1952)
Un film de Richard Thorpe
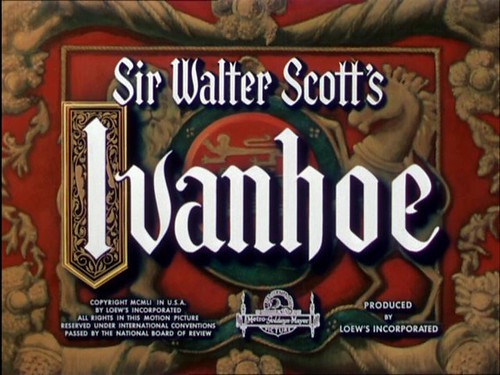
Digne film de chevalerie que Richard Thorpe réalise un an avant son autre classique Les chevaliers de la table ronde, toujours avec Robert Taylor (aucun lien avec Elizabeth), Ivanhoé conte les aventures de celui-ci, parti à la recherche de son bon roi Richard, dépossédé de la couronne d’Angleterre par son félon de frère, Jean.
Les constantes du film de chevalerie sont toutes ici réunies, tant et si bien qu’on a l’impression de voir un frère jumeau aux Aventures de Robin des Bois (Michael Curtiz, William Keighley, 1938), chef d’œuvre incontesté du genre. Robin, de son véritable nom Locksley, est bien présent dans le film, mais seulement en tant que partenaire de Ivanhoé ; lui et sa troupe (on reconnaît frère Tuck entre autres) vont aider notre chevalier à destituer le Prince Jean. Chose étonnante, le personnage n’est jamais nommé par son appellation universelle de Robin des Bois, et ses compagnons le sont encore moins. Sûrement dans le but de ne pas perturber le spectateur sur l’identité du véritable héros de l’histoire, les scénaristes et le réalisateur n’ont-ils pas voulu mettre un nom beaucoup plus connu que celui de Wilfried d’Ivanhoé dans le film. Cela reste tout de même très étrange, car on a tôt fait de se rendre compte qu’il s’agit de la même histoire, sous un autre angle, où les personnages annexes (Richard Cœur de Lion, Prince Jean) sont les mêmes.
Les passages obligés (tournois où l’arc est remplacé par la joute à cheval, duels à l’épée dans la plus grande tradition du genre) désignent une mythologie pure, faite de serments gardés et toujours tenus par les bons, et de traîtrises (un temps) impunies par les fielleux grimaçants. Mais l’esprit est là, débonnaire, et les acteurs portent bien cet idéal de pureté ou de malice. Robert Taylor est le seul, l’unique qui a persévéré pendant des années pour retrouver Richard Cœur de Lion. Il chante pour entendre une réponse, la suite de sa mélodie. Ce geste indique déjà combien le héros symbolise le héros classique dans sa pureté -et assume son origine romanesque via Walter Scott-, où dans un intemporel Moyen-âge sans nuage, des troubadours égayaient la vie des seigneurs avec chansons et drôleries. Pour le côté comique, Ivanhoé s’adjoint de Wamba, un esclave qu’il affranchit, et qui jouait auparavant le rôle du bouffon ; libre, il en sera toujours un.
L’histoire s’enrichit d’un triangle amoureux malheureusement sans enjeu car on sait bien que la droiture du héros empêche de rompre un serment préalablement fait à Lady Rowena (Joan Fontaine). Ainsi, la brune Rebecca (Elizabeth Taylor) aura un rôle plutôt ténu dans cette production hollywoodienne ; mais sa position est paradoxalement plus intéressante, valorisante que celle de sa rivale : elle est juive et en est fière, dans une lutte esquissée entre la chrétienté et le judaïsme ; l’ensemble donne d’ailleurs une bien meilleure image aux juifs qu’aux chrétiens. De plus, elle est experte en médecine "parallèle" -en cela c’est le personnage le plus moderne du film- car a fait son apprentissage avec une femme suspectée de sorcellerie : pour le Prince jean, ces informations sont suffisantes pour vouloir la faire mettre à mort au terme d’un procès truqué.
Les décors et les costumes, magnifiés par un Technicolor flamboyant, façonnent le mythe de la plus belle façon, même si le souffle épique aurait pu être plus accentué. Au lieu de cela, la musique symphonique typique des productions hollywoodiennes de l’âge d’or est de tous les plans, ce qu’on peut regretter, mais participe en même temps au charme d’une époque qui, aujourd’hui, semble bien lointaine, telle le fruit d’un rêve éveillé. En l’état, Ivanhoé est un bon rejeton classique du cinéma de la chevalerie, porteur d’un certain idéal, à ne pas négliger par ces temps de morosité...
