Un film de Franck Vestiel
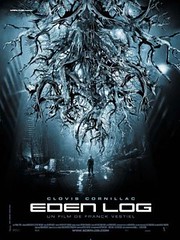 Il y a des films que l'on a envie d’aimer ; ceux qui, sans en avoir vu une seule image, nous disent qu'ils correspondent a priori à tout ce qu'on aime. La science-fiction est un genre placé quelque part au plus haut dans mon panthéon cinéphile perso (2001, Les fils de l’homme, The Fountain, La planète des singes, ou encore Sunshine sont des films dont la seule évocation me donne envie de les revoir), je pense être le public-cible d’Eden Log. Quelle ne fut pas ma déception devant ce film, qui essaye vaguement de raconter son histoire (un homme se réveillant dans une grotte ne se rappelle plus de rien ; son chemin sera de comprendre ce qu'il fait là) au mépris de toute considération pour son spectateur. On touche ici aux limites d'un premier film (raté), c'est qu’il parle beaucoup plus à son auteur qu'aux autres.
Il y a des films que l'on a envie d’aimer ; ceux qui, sans en avoir vu une seule image, nous disent qu'ils correspondent a priori à tout ce qu'on aime. La science-fiction est un genre placé quelque part au plus haut dans mon panthéon cinéphile perso (2001, Les fils de l’homme, The Fountain, La planète des singes, ou encore Sunshine sont des films dont la seule évocation me donne envie de les revoir), je pense être le public-cible d’Eden Log. Quelle ne fut pas ma déception devant ce film, qui essaye vaguement de raconter son histoire (un homme se réveillant dans une grotte ne se rappelle plus de rien ; son chemin sera de comprendre ce qu'il fait là) au mépris de toute considération pour son spectateur. On touche ici aux limites d'un premier film (raté), c'est qu’il parle beaucoup plus à son auteur qu'aux autres.
En prenant pour personnage principal (qui sera le plus souvent seul à l'image) un Clovis Cornillac grognant et beuglant dans une composition essentiellement muette, Vestiel interdit toute empathie et identification au rôle, ce qui pose quand même un sacré problème. Préférant laisser Cornillac seul avec l'obscurité errer sans un mot pendant la -très longue- première demi-heure, il réussit le pari insensé de nous ennuyer dès les premières minutes de son film, dès lors que l’on comprend qu’il ne passera rien de plus. Le spectateur, essayant de réunir les quelques morceaux épars d'un scénario au mieux elliptique, au pire absent, n'a rien à quoi s'accrocher, si ce n’est qu'il peut éventuellement remarquer un bon travail au niveau du design sonore du métrage, ainsi qu'une photo assez belle. Cependant, la faute à un budget ridicule, l’image ne donne finalement pas grand-chose à voir et se laisse aller à un trip claustrophobe pas efficace pour deux sous. Pour toute progression narrative, on a droit à une recherche d’indices qui montre une influence tout droit sortie des jeux vidéo ; on pourrait ainsi le rapprocher d’un Silent Hill (Christophe Gans, 2006), lequel, même s’il ne constitue pas une réussite flagrante, est à 100 lieux de l’échec artistique d’Eden Log. Enfin, on avancera que, si le film se cherche des parrains renommés -notre esprit divaguera en cours de visionnage de Soleil Vert (Richard Fleischer, 1973) à The Fountain (Darren Aronofsky, 2006)- les 5 minutes de la fin voulant concentrer la seule idée du film, l'oeuvre ne peut que laisser un goût amer. celui de la perte de temps. Le film aurait sûrement beaucoup mieux fonctionné au format moyen voire court-métrage. Disons que ce n’est pas avec le film de Franck Vestiel que l’on peut augurer avec confiance de l’avenir du cinéma de science-fiction en France !
 Grosse impression pour la première vision (hé oui !) de ce classique fantastique de l'artiste total Jean Cocteau. Au sortir de la seconde guerre mondiale on pouvait donc voir à l'affiche ce conte de fée sur pellicule, fait avec les moyens du bord (ce n'était pas un gros budget même pour l'époque), qui constitue en soi un vrai miracle cinématographique. Tous les éléments s'y assemblent parfaitement, à commencer par Josette Day, alors amante de Marcel Pagnol, que ce dernier recommanda à son ami Cocteau. Elle est Belle dans une simplicité et une clarté solaire impressionnante. Jean Marais, jouant deux rôles, la Bête et le soupirant de Belle, a transformé sa voix précieuse et haut placée avec le concours de cigarettes à gogo et de rhumes pris exprès. Ainsi, il donne à la Bête une très crédible irritabilité et une voix rauque douloureuse. Les décors somptueux créés par Christian Bérard, dont ce sera l'œuvre la plus significative, imprègnent le film d’une atmosphère gothique propice aux rêves. Cocteau est également épaulé par René Clément, assistant-réalisateur sur le film mais aussi réalisateur de seconde équipe, et déjà cinéaste depuis les années 30, futur réalisateur de Plein soleil (1960) ou Paris brûle-t-il ? (1966). Tous ces éléments sont soumis à la vision d'un artiste, Cocteau, qui commence d'ailleurs le film en écrivant lui-même les crédits du générique devant la caméra, démontrant dès les premières minutes sa position d'auteur. Et le film d'émailler pendant 90 minutes des visions étonnantes : l'entrée de Belle au ralenti dans le château de la Bête, guidée par des torches portées par des bras étrangement animés, la première apparition de la Bête, et diverses transformations et autres ingéniosités qui font de La Belle et la Bête un creuset d'inventions pour faire croire au fantastique. Les costumes, extraordinairement travaillés, sont aussi l'élément qui nous fait y croire.
Grosse impression pour la première vision (hé oui !) de ce classique fantastique de l'artiste total Jean Cocteau. Au sortir de la seconde guerre mondiale on pouvait donc voir à l'affiche ce conte de fée sur pellicule, fait avec les moyens du bord (ce n'était pas un gros budget même pour l'époque), qui constitue en soi un vrai miracle cinématographique. Tous les éléments s'y assemblent parfaitement, à commencer par Josette Day, alors amante de Marcel Pagnol, que ce dernier recommanda à son ami Cocteau. Elle est Belle dans une simplicité et une clarté solaire impressionnante. Jean Marais, jouant deux rôles, la Bête et le soupirant de Belle, a transformé sa voix précieuse et haut placée avec le concours de cigarettes à gogo et de rhumes pris exprès. Ainsi, il donne à la Bête une très crédible irritabilité et une voix rauque douloureuse. Les décors somptueux créés par Christian Bérard, dont ce sera l'œuvre la plus significative, imprègnent le film d’une atmosphère gothique propice aux rêves. Cocteau est également épaulé par René Clément, assistant-réalisateur sur le film mais aussi réalisateur de seconde équipe, et déjà cinéaste depuis les années 30, futur réalisateur de Plein soleil (1960) ou Paris brûle-t-il ? (1966). Tous ces éléments sont soumis à la vision d'un artiste, Cocteau, qui commence d'ailleurs le film en écrivant lui-même les crédits du générique devant la caméra, démontrant dès les premières minutes sa position d'auteur. Et le film d'émailler pendant 90 minutes des visions étonnantes : l'entrée de Belle au ralenti dans le château de la Bête, guidée par des torches portées par des bras étrangement animés, la première apparition de la Bête, et diverses transformations et autres ingéniosités qui font de La Belle et la Bête un creuset d'inventions pour faire croire au fantastique. Les costumes, extraordinairement travaillés, sont aussi l'élément qui nous fait y croire.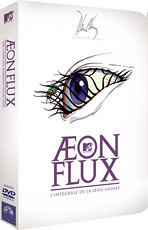
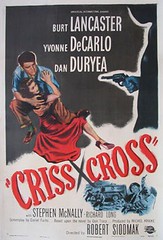 A l’occasion d'un travail sur le film noir, nous découvrons aujourd’hui Criss Cross (Pour toi j'ai tué), réalisé par Robert Siodmak en 1948, deux ans après ses Tueurs, déjà avec Burt Lancaster dans le rôle principal. Après la femme fatale détestable de Detour (Edgar G. Ulmer), la violence sèche de La brigade du suicide et Marché de brutes (Anthony Mann) ou encore la folie apocalyptique de En quatrième vitesse (Robert Aldrich), nous pouvons affilier sans problème aucun Criss Cross dans la veine la plus pure du film noir. Ici, à l'image de certains personnages qui dès le début du film ont déjà perdu et sont marqués par le sceau du fatum en marche, tout est déjà joué dès les premières minutes. La vue aérienne qui débute le film est d’ailleurs très à-propos, s'approchant peu à peu du lieu où tout bascule, un bar interlope du centre-ville ; les activités humaines ont l’air d'un monde miniature où le contrôle de la destinée semble impossible, déterminée par quelque chose de plus grand. La tentative de hold-up d'un camion blindé se soldera, ce n'est jamais une surprise, par un échec sanglant.
A l’occasion d'un travail sur le film noir, nous découvrons aujourd’hui Criss Cross (Pour toi j'ai tué), réalisé par Robert Siodmak en 1948, deux ans après ses Tueurs, déjà avec Burt Lancaster dans le rôle principal. Après la femme fatale détestable de Detour (Edgar G. Ulmer), la violence sèche de La brigade du suicide et Marché de brutes (Anthony Mann) ou encore la folie apocalyptique de En quatrième vitesse (Robert Aldrich), nous pouvons affilier sans problème aucun Criss Cross dans la veine la plus pure du film noir. Ici, à l'image de certains personnages qui dès le début du film ont déjà perdu et sont marqués par le sceau du fatum en marche, tout est déjà joué dès les premières minutes. La vue aérienne qui débute le film est d’ailleurs très à-propos, s'approchant peu à peu du lieu où tout bascule, un bar interlope du centre-ville ; les activités humaines ont l’air d'un monde miniature où le contrôle de la destinée semble impossible, déterminée par quelque chose de plus grand. La tentative de hold-up d'un camion blindé se soldera, ce n'est jamais une surprise, par un échec sanglant.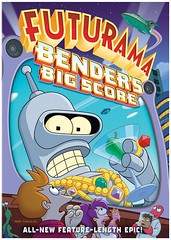 Hier soir, Nous avons vu Cœur de dragon. Cependant, critiquer le manque de talent de Rob Cohen étant plutôt facile et manquant cruellement de savoir-vivre -pourquoi s'acharner sur un homme à terre ?- , attelons-nous à autre chose qui, à l'opposé des aventures médiévales du réalisateur de Fast and furious et La momie 3, aurait pu être un bon film. Oui, il s’agit du premier des 4 téléfilms direct-to-video de la série Futurama, Bender’s Big Score. Au cours de 4 saisons, Futurama a dessiné un univers futuriste et science-fictionnel assez drôle et unique, même si inégal. Le passage à un format plus long (1h30 contre 20 min.) a néanmoins cassé les pattes de cette machine à blagues inventée par Matt Groening, le créateur des immortels Simpsons.
Hier soir, Nous avons vu Cœur de dragon. Cependant, critiquer le manque de talent de Rob Cohen étant plutôt facile et manquant cruellement de savoir-vivre -pourquoi s'acharner sur un homme à terre ?- , attelons-nous à autre chose qui, à l'opposé des aventures médiévales du réalisateur de Fast and furious et La momie 3, aurait pu être un bon film. Oui, il s’agit du premier des 4 téléfilms direct-to-video de la série Futurama, Bender’s Big Score. Au cours de 4 saisons, Futurama a dessiné un univers futuriste et science-fictionnel assez drôle et unique, même si inégal. Le passage à un format plus long (1h30 contre 20 min.) a néanmoins cassé les pattes de cette machine à blagues inventée par Matt Groening, le créateur des immortels Simpsons.