Un film de Adam Elliot

J’assiste à la projection de ce long métrage avec une attente palpable, les antécédents du Monsieur ayant été unanimement salués (Harvie Krumpet, Oscar 2003 du meilleur court d’animation).
Débute alors un film en demi-teintes, narrant la relation épistolaire de deux individus atteints de diverses névroses (comme tout un chacun, en fait). Une jeune fille complexée et aux repères mouvants donnés par son alcoolique de mère ; puis un vieil autiste obèse. Une série d’animation, Les Noblets, les relient indéfectiblement, tous deux étant animés par une même passion pour le show. Petit à petit se développe donc ce lien spécial, à distance, accompagnant chacun dans leur vie de tous les jours. Sur ce canevas pour le moins intéressant, vient malheureusement se greffer une esthétique morne, monochromatique, soutenu par le commentaire atonal d’un narrateur bavard (le casting vocal est d’ailleurs impressionnant, mais seulement sur le papier : Philip Seymour Hoffman, Toni Colette, Eric Bana). L’environnement sonore, clairement opposé entre les deux partis (enjoué pour Mary, désespéré pour Max) est soigné, et certains passages musicaux sont de vraies réussites.
Déroulant certes une histoire touchante, pleine de bizarreries étonnantes -les hot dogs au chocolat du vieux Max, les déambulations et le look de mort-vivant de la mère imbibée de Mary-, le film reste cependant replié sur lui-même, à l’image de l’affection qui touche Max. L’émotion peine à poindre devant tant de morosité. Il est donc permis de s’y ennuyer, voire même d’éprouver une malaise correspondant à l’état d’esprit des deux personnages. Le réalisateur a-t-il réussi son coup ? Etait-ce la réaction escomptée ? Quoi qu’il en soit, ces impressions façonnent la déception qui nous étreint au sortir de la salle.
 A quoi bon résider sur Annecy et ne pas assister à leur Festival du film d’animation de dimension internationale ? Cette année encore, le programme est plutôt alléchant : Coraline (Henry Selick, présent sur place) en compétition, Mary et Max (Adam Elliot), Ghost in the Shell 2.0, le film séminal de Mamoru Oshii, agrémenté de nouveaux effets spéciaux, ou Sword of the Stranger, prometteur film de sabre, bref, pour les longs, il y a de quoi faire.
A quoi bon résider sur Annecy et ne pas assister à leur Festival du film d’animation de dimension internationale ? Cette année encore, le programme est plutôt alléchant : Coraline (Henry Selick, présent sur place) en compétition, Mary et Max (Adam Elliot), Ghost in the Shell 2.0, le film séminal de Mamoru Oshii, agrémenté de nouveaux effets spéciaux, ou Sword of the Stranger, prometteur film de sabre, bref, pour les longs, il y a de quoi faire.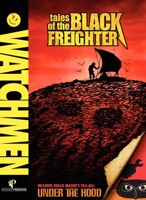 Bizarre, cette vision de ce qui devait être, à l’origine, inclus dans la version ciné du
Bizarre, cette vision de ce qui devait être, à l’origine, inclus dans la version ciné du 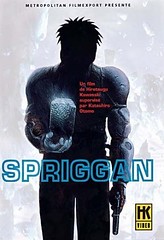 Spriggan fait partie de ces films d’animation japonais qui, bien que (ou à cause de) leur absence sur les écrans français, ont bénéficié d’un buzz important et ont vu leur réputation être surévaluée. Ici, cette surévaluation est également due à Katsuhiro Otomo, mangaka reconnu (Domû, rêves d’enfants et le scénario de Mother Sarah) et surtout créateur d’Akira ; il occupe sur Spriggan le poste de superviseur.
Spriggan fait partie de ces films d’animation japonais qui, bien que (ou à cause de) leur absence sur les écrans français, ont bénéficié d’un buzz important et ont vu leur réputation être surévaluée. Ici, cette surévaluation est également due à Katsuhiro Otomo, mangaka reconnu (Domû, rêves d’enfants et le scénario de Mother Sarah) et surtout créateur d’Akira ; il occupe sur Spriggan le poste de superviseur. Cowboy bebop - le film fait suite au succès mondial de la série éponyme imaginée par Shinichiro Watanabe. Sortie en 2001, cette adaptation devrait ne pas être la dernière, car un projet de film live avec Keanu Reeves dans le rôle-titre semble être sur les rails.
Cowboy bebop - le film fait suite au succès mondial de la série éponyme imaginée par Shinichiro Watanabe. Sortie en 2001, cette adaptation devrait ne pas être la dernière, car un projet de film live avec Keanu Reeves dans le rôle-titre semble être sur les rails.