Un film de Joseph Kosinski
 Il est intéressant de constater le revirement de Disney par rapport à un film émanant de ses Studios. En 1982, Steven Lisberger réalise Tron, premier du nom, et donne un équivalent visuel jamais vu au monde balbutiant des ordinateurs ; il se prend une grosse claque et le film devient, pour un temps, la honte de Disney. Le Studio nage alors en plein dans cette époque d'incertitude où il ne sait plus trop quoi faire, et semble préférer les films en prise de vue réelles pour un public plutôt mature (Le trou noir, 1979, Les yeux de la forêt, 1980 et pour finir un Taram et le chaudron magique glauque à souhait sorti en 1985) à ses traditionnels films d'animation pour enfants. Le changement d'équipe et de direction artistique mettra un temps à retrouver sa voie, comme nous le montre avec force images d'époque le documentaire Waking Sleeping Beauty.
Il est intéressant de constater le revirement de Disney par rapport à un film émanant de ses Studios. En 1982, Steven Lisberger réalise Tron, premier du nom, et donne un équivalent visuel jamais vu au monde balbutiant des ordinateurs ; il se prend une grosse claque et le film devient, pour un temps, la honte de Disney. Le Studio nage alors en plein dans cette époque d'incertitude où il ne sait plus trop quoi faire, et semble préférer les films en prise de vue réelles pour un public plutôt mature (Le trou noir, 1979, Les yeux de la forêt, 1980 et pour finir un Taram et le chaudron magique glauque à souhait sorti en 1985) à ses traditionnels films d'animation pour enfants. Le changement d'équipe et de direction artistique mettra un temps à retrouver sa voie, comme nous le montre avec force images d'époque le documentaire Waking Sleeping Beauty.
Tron donnait à voir l'envers du décor d'un ordinateur dans lequel les puces etautres composants sont remplacés par des humains. Expliquer les concepts abstraits du fonctionneemnt d'un ordinatuer à un public totalement novice était en soi complexe, mais des images inédites venaient soutenir le discours qui, au fil des ans et de la domestication des écrans, fascinèrent de plus en plus de jeunes, plongés eux aussi dans cet univers.
Avec les années, Disney veut lui aussi jouer la carte du geek-friendly et mise beaucoup sur une suite lancée à gros coups de billets. Aux 33 millions de budget du premier, Disney allonge 170 millions pour la suite, non sans avoir pris soin de tester le prodige de la 3D Joseph Kosinski et de débaucher Daft Punk, dont le style musical et le public semble avoir été fait pour le film. Le studio souhaite également rentabiliser l'investissement en lançant une série d'animation au casting vocal impressionnant.

Visuellement et musicalement, le résultat final est juste splendide : tableaux bichromes aux noirs profonds, dans lesquels des lignes fluorescentes semblent glisser jusqu'à l'infini, des machines volantes au design à la fois arrondi et anguleux filant dans un labyrinthe technoïde. Des motos qui laissent derrière elles des traînées colorées, des arènes changeant de formes dans des mouvements fluides, des combattants qui meurent dans une pluie de pixels. Restant en cela très fidèle au Tron original, Joseph Kosinski s'évertue néanmoins à placer la barre plus haut, le plaisir des yeux restant constant. L'image atteint la perfection idéalisée d'un monde numérique où ni le désordre ni l'usure n'ont leur place. Chaque objet, chaque personnage sont fétichisés à l'extrême, les beautés numériques tout droit sorties de la bande dessinée Skydolls. Il est plutôt logique que Tron : l'héritage gagne cette manche par rapport à son prédecesseur, l'expérience visuelle proposé par Tron ayant pris avec les années un bon coup dans l'aile. Plans statiques, découpage des personnages parfois approximatif, teintes un peu tristes... Musicalement parlant, le premier Tron faisait la part belle aux mélodies synthétiques de Wendy Carlos, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles sont terriblement datées. Si elles font corps avec le film qu'elles accompagnent, une écoute à part est vite lassante. celle des Daft punk pour la suite, ont l'effet contraire : elles emmènent le film à un tout autre niveau, tandis que l'écoute seule est tout simplement électrisante. Tant et si bien que le film paraît par moment n'être qu'un long clip dont tout son pourrait être coupé si ce n'est sa musique. En ce sens, Tron : L'héritage fait irrémédiablement penser à Interstella 5555, le film d'animation de Leiji Matsumoto sur le fond sonore de l'album Discovery des Daft. Une très belle expérience audio-visuelle.
L'intrigue ne fait pas vraiment dans l'original, représentant tout de même l'antithèse du premier Tron à l'époque. Ne se reposant sur aucune bande connue, il inventait sa propre mythologie. Dans Tron l'héritage, afin de projeter le plus vite possible le spectateur dans le monde fantastique de Tron, le personnage principal (Garrett Hedlund, bien dans le ton d'un Jeff Bridges jeune) plonge rapidement dans le vortex numérique sans que le scénario se soucie de crédibiliser son entrée. Il se retrouve ainsi dans l'arène à manier son disque comme un pro, pour être ensuite, tout aussi rapidement, récupéré par Quorra (Olivia Wilde, au charisme aveuglant) pour être présenté à son père. On retrouve alors un Jeff Bridges qui aurait tout de même du boire un petit café avant de tourner, son regard apathique et son air totalement absent jurant un peu avec l'importance séminale de son rôle. Et la trame scénaristique générale de reprendre des éléments connus de tous les récits mythologiques classiques, à base d'élu ("il est différent", dit un des premiers programmes du jeu), de figure du mal absolu et de sage omnipotent. Il ouvre ainsi la porte à une foultitude de références geek -Star Wars, Matrix, et même Charlie et la chocolaterie !- et au Graal de la SF, 2001, l'odyssée de l'espace. Comme si le film n'avait pas en lui de potentiel mythologique propre. C'est bien dommage, car malgré cela, le résultat final exerce une fascination indéniable. La preuve : après sa vision, je n'ai qu'une envie, le revoir (et le ré-écouter !).
 Smith, sexuellement "
Smith, sexuellement " Quelle (bonne) surprise à la vision du programme du sympathique festival Cinémino à Annecy, lorsque l'on découvre, au détour d'un programme (bien caché, quand même) la projection de ce documentaire, sorti originellement dans 6 salles en France ; il retrace une décennie-clé dans l'histoire du Studio Disney, de 1984 à 1994, où le passage de témoin entre la vieille garde des aînés (les "Nine Old Men", collaborateurs historiques de Walt Disney) et de jeunes animateurs passionnés par l'animation, voulant faire évoluer le médium, ne se déroule pas sans heurts.
Quelle (bonne) surprise à la vision du programme du sympathique festival Cinémino à Annecy, lorsque l'on découvre, au détour d'un programme (bien caché, quand même) la projection de ce documentaire, sorti originellement dans 6 salles en France ; il retrace une décennie-clé dans l'histoire du Studio Disney, de 1984 à 1994, où le passage de témoin entre la vieille garde des aînés (les "Nine Old Men", collaborateurs historiques de Walt Disney) et de jeunes animateurs passionnés par l'animation, voulant faire évoluer le médium, ne se déroule pas sans heurts.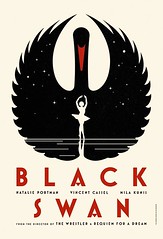 Le film était attendu, la fièvre entretenue par une
Le film était attendu, la fièvre entretenue par une 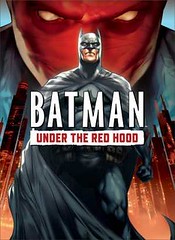 Les inédits dvd de chez DC témoignent d'un niveau tel qu'on est presque surpris de les découvrir directement chez soi, dans la quiétude (rapidement chamboulée) de notre salon, ou bien devant son ordinateur, la tête surmontée d'un casque audio (pour la VO, c'est bien mieux, je vous le conseille !). Superman Doomsday (Laurent Montgomery, 2007) était d'une redoutable efficacité ; Justice League : New Frontier (Dave Bullock, 2008) faisait preuve d'une belle recherche esthétique et constituait une adaptation honnête de la BD de Darwyn Cooke ; Batman et Red Hood vient aujourd'hui jouer sur les terres du superbe
Les inédits dvd de chez DC témoignent d'un niveau tel qu'on est presque surpris de les découvrir directement chez soi, dans la quiétude (rapidement chamboulée) de notre salon, ou bien devant son ordinateur, la tête surmontée d'un casque audio (pour la VO, c'est bien mieux, je vous le conseille !). Superman Doomsday (Laurent Montgomery, 2007) était d'une redoutable efficacité ; Justice League : New Frontier (Dave Bullock, 2008) faisait preuve d'une belle recherche esthétique et constituait une adaptation honnête de la BD de Darwyn Cooke ; Batman et Red Hood vient aujourd'hui jouer sur les terres du superbe