Un film de Vincenzo Natali
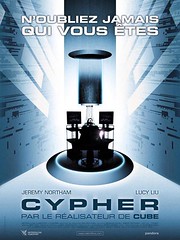 Même si je ne pense pas que ce film soit "indéfendable", il reste tout du moins mésestimé par le plus grand nombre. Il s’agit s’un trip très construit, à cheval entre espionnage, SF et thriller paranoïaque, dans lequel Morgan Sullivan (Jeremy Northam) incarne l’homme ordinaire qui veut changer de vie : il devient alors espion industriel pour la firme Digicorp, mais ses missions sont, comment dire, loin de celles d’un James Bond, jugez plutôt : il se rend à des conférences pour enregistrer des discours sans intérêt... On se doute rapidement qu’il est utilisé.
Même si je ne pense pas que ce film soit "indéfendable", il reste tout du moins mésestimé par le plus grand nombre. Il s’agit s’un trip très construit, à cheval entre espionnage, SF et thriller paranoïaque, dans lequel Morgan Sullivan (Jeremy Northam) incarne l’homme ordinaire qui veut changer de vie : il devient alors espion industriel pour la firme Digicorp, mais ses missions sont, comment dire, loin de celles d’un James Bond, jugez plutôt : il se rend à des conférences pour enregistrer des discours sans intérêt... On se doute rapidement qu’il est utilisé.
Opérant une variation chromatique tout au long du film, passant d’un ensemble désaturé qui s’agrémente peu à peu de couleurs, pour finir dans une apothéose bariolée, Vincenzo Natali construit son film par petites touches impressionnistes. Le moment du premier véritable envahissement de couleurs à l’écran accompagne ainsi la révélation conjointe, pour le personnage principal comme pour le spectateur, d’une première vérité, dans ce monde où l’information semble toujours cachée. De plus, le glissement progressif d’un genre à l’autre suit cette variation chromatique, et la découverte progressive de la vérité par Sullivan. Même si le début du métrage fait invariablement penser à un Matrix du pauvre, il ne faut pas s’y fier. Derrière un budget qu’on n’imagine certes pas à la hauteur des ambitions du cinéaste -les effets spéciaux sont très visibles-, le film déroule sa trame avec une droiture et une absence d’ironie qui le sert bien. Le jeu des doubles, illustré ici jusqu’aux antagonismes des multinationales qui s’affrontent, donne un léger vertige par la richesse des virages scénaristiques, qui s’estompera cependant bien vite, n’ayez crainte. La dernière partie, qui démêle le vrai du faux, est jouissive pour qui y est réceptif (j’en suis, évidemment).
Lucy Liu est bien castée dans un rôle ambigu, personnage coloré et atypique dans un univers formaté où l’on ne parle que de données échangées, volées, à prendre... Jeremy Northam, quant à lui, a la bonne tête et les manières maladroites de l'homme dépassé par les événements, mais qui jouit en même temps de ce revirement dans sa vie. Northam reste, malheureusement, trop discret dans le paysage cinématographique.
Ne se prétendant pas autre chose qu’un divertissement, le film surprend par sa foule d’idées, dont certaines sont franchement casse-gueule -la citation de La mort aux trousses, transposée de nuit, et l’apparition qui s’en suit-, mais qui organise tranquillement sa petite réussite, en sachant bien qu’il ne révolutionne pas le genre. Je rapprocherais volontiers Cypher d’un Passé Virtuel (Josef Rusnak, 1999), voire d’un Planète hurlante (Christian Duguay, 1996), deux films qui n’ont pas la réputation qu’ils méritent. Sans être des chefs d’œuvres évidents, ils sont des réussites, tant formelles que scénaristiques, et font du bien pour leur fraîcheur.
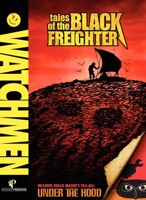 Bizarre, cette vision de ce qui devait être, à l’origine, inclus dans la version ciné du
Bizarre, cette vision de ce qui devait être, à l’origine, inclus dans la version ciné du  Après un premier film, Calvaire, qu’on peut qualifier sans mal de dérangeant, le belge fou revient avec un film-trip, véritable déambulation hallucinée dans les cités bariolées de Thaïlande, puis dans la forêt Birmane, où nous suivons donc les pas d’un couple, interprété par Emmanuelle Béart et Rufus Sewell (Dark City, Chevalier), mis à mal par la perte d’un enfant. La possibilité de le retrouver va faire basculer leur vie une nouvelle fois.
Après un premier film, Calvaire, qu’on peut qualifier sans mal de dérangeant, le belge fou revient avec un film-trip, véritable déambulation hallucinée dans les cités bariolées de Thaïlande, puis dans la forêt Birmane, où nous suivons donc les pas d’un couple, interprété par Emmanuelle Béart et Rufus Sewell (Dark City, Chevalier), mis à mal par la perte d’un enfant. La possibilité de le retrouver va faire basculer leur vie une nouvelle fois.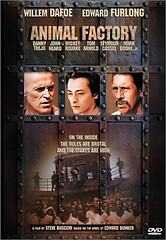 Cet excellent acteur/réalisateur qu’est Steve Buscemi nous sert un exemple du film carcéral dans toute sa dure réalité ; bien que l’intrigue se situe dans la prison de San Quentin, une des plus anciennes des Etats-Unis et lieu de maints autres films avant celui-ci, le film a été tourné dans une ancienne prison d’état à Philadelphie. Adapté du roman de Eddie Bunker, qui connaît San Quentin comme sa poche (il y a séjourné 18 ans, semble-t-il), Animal Factory est d’abord un film de gueules incroyables, à commencer par un Willem Dafoe, tête rasée, excellent. A celui-là s’ajoute l’ex-taulard Danny Trejo, tout en balafres, connu pour jouer les seconds rôles chez Robert Rodriguez. Mickey Rourke, méconnaissable (pléonasme), est à contre-emploi dans un rôle... borderline dont je vous laisserais la surprise. Eddie Bunker lui-même, après avoir été aperçu dans Reservoir Dogs (Mister Blue, c’était lui), joue un rôle secondaire. Au milieu de toute cette troupe, qui reconstitue de façon convaincante une ambiance toujours sur le fil, entre vie et mort, le jeune Ron Decker (Edward Furlong, disparu des écrans et c’est bien dommage) doit rentre dans les cases, se conformer aux usages hors-normes d’une société de psychopathes.
Cet excellent acteur/réalisateur qu’est Steve Buscemi nous sert un exemple du film carcéral dans toute sa dure réalité ; bien que l’intrigue se situe dans la prison de San Quentin, une des plus anciennes des Etats-Unis et lieu de maints autres films avant celui-ci, le film a été tourné dans une ancienne prison d’état à Philadelphie. Adapté du roman de Eddie Bunker, qui connaît San Quentin comme sa poche (il y a séjourné 18 ans, semble-t-il), Animal Factory est d’abord un film de gueules incroyables, à commencer par un Willem Dafoe, tête rasée, excellent. A celui-là s’ajoute l’ex-taulard Danny Trejo, tout en balafres, connu pour jouer les seconds rôles chez Robert Rodriguez. Mickey Rourke, méconnaissable (pléonasme), est à contre-emploi dans un rôle... borderline dont je vous laisserais la surprise. Eddie Bunker lui-même, après avoir été aperçu dans Reservoir Dogs (Mister Blue, c’était lui), joue un rôle secondaire. Au milieu de toute cette troupe, qui reconstitue de façon convaincante une ambiance toujours sur le fil, entre vie et mort, le jeune Ron Decker (Edward Furlong, disparu des écrans et c’est bien dommage) doit rentre dans les cases, se conformer aux usages hors-normes d’une société de psychopathes. L’Espagne est la terre promise du cinéma fantastique actuel. Ce premier film en est la nouvelle preuve, alignant sur un canevas classique de maison hantée un drame familial et personnel assez réussi.
L’Espagne est la terre promise du cinéma fantastique actuel. Ce premier film en est la nouvelle preuve, alignant sur un canevas classique de maison hantée un drame familial et personnel assez réussi.