Un film de Christopher Nolan
 Réalisé entre The Dark Knight et The Dark Knight Rises, Inception est un projet de longue date de Christopher Nolan, qu'il a fait maturer pendant une dizaine d'année afin de lui donner l'ampleur souhaitée. La similitude du logo de sa société de production Syncopy Films, créée en 2005, avec le logo-titre d'Inception, n'en est qu'une preuve de surface.
Réalisé entre The Dark Knight et The Dark Knight Rises, Inception est un projet de longue date de Christopher Nolan, qu'il a fait maturer pendant une dizaine d'année afin de lui donner l'ampleur souhaitée. La similitude du logo de sa société de production Syncopy Films, créée en 2005, avec le logo-titre d'Inception, n'en est qu'une preuve de surface.
Dès la bande-annonce diffusée en janvier 2010, on voit des choses étonnantes ; un verre d'eau dont le contenu tangue, des personnages en apesanteur, une avenue de Paris qui se retourne sur elle-même, etc. Même si certains font le lien avec Matrix (les passages au ralenti), on pressent un film qui "ouvre des horizons". La même sensation nous avait étreint à la vision de la sublime bande-annonce de The Fountain (Darren Aronofsky, 2005), film aussi novateur dans le fond et dans la forme.
Inception prend le parti de nous parler de deux phénomènes parents, les rêves conscients (être conscient d'être en train de rêver), et les rêves emboîtés (on se réveille et l'on est encore dans un rêve). Ces deux dimensions se manifestent furtivement dans notre expérience quotidienne des rêves. Personnellement, il se trouve que j'en fait l'expérience régulièrement et de manière prolongée. Vous comprendrez pourquoi mon rapport au film est éminemment personnel, et lorsque j'ai vu sur l'écran un miroir de mes expériences, cela m'a fasciné.
Nolan part d'un constat simple, décrit par Cobb (Leonardo DiCaprio) : le monde du rêve nous paraît sensé quand on est dedans, ce n'est qu'une fois qu'on s'est réveillé qu'on se rend compte de son étrangeté. C'est la raison pour laquelle le film part dans la direction opposée à celle attendue sur le monde des rêves (thème prolifique au cinéma), à savoir une certaine sobriété dans la représentation graphique du monde. Nolan a construit de la même façon sa renaissance du Chevalier Noir, minimisant les aspects les plus fantaisistes de la mythologie du Batman. Dès lors, les rares moments véritablement fantastiques surgissent avec une force décuplée.
Le film part comme une sorte de dissertation sur les possibilité du rêve, alternant questionnements (l'"inception", immiscer une idée dans la tête d'un individu en pénétrant ses rêves, est-elle possible, combien de niveaux de rêves peut-on supporter, etc.), fonctionnement du cerveau quand il est en état de rêve (la fameuse impression d'arriver tout de suite au milieu de l'action, l'incroyable gymnastique du cerveau qui crée le monde du rêve tout en ayant l'impression de le découvrir), explication des concepts de base (plusieurs personnes rêvant simultanément se retrouve dans un même lieu) et une action continue. Les multiples tableaux sur lesquels joue le film en fait un ensemble complexe, qui demande une concentration de tous les instants pour bien en saisir tous les tenants et aboutissants. Mais, au terme d'un voyage foisonnant, la satisfaction d'avoir été témoin de cette structure très consciemment et intelligemment construite, vaut bien quelques efforts (et autres défauts).

Dom Cobb dirige une équipe qui utilise le monde du rêve pour gagner leur vie : ils vont chercher dans le subconscient des sujets leurs secrets, et les dévoilent au plus offrant. Mais le nouveau contrat qu'ils vont accepter va bien plus loin que ce postulat déjà fantastique : il s'agira de semer une idée dans l’inconscient du sujet, lequel aura alors l'impression qu'elle vient de lui-même. La trame scénaristique est remarquable par sa construction d'une extrême précision. De la même façon que l'équipe de Cobb prépare son attaque, Nolan érige son film en démonstration de cinéma.
Christopher Nolan interroge le monde du rêve par la vision fragmentée qu'il peut donner de la réalité : on passe d'un monde à l'autre, d'un plan à l'autre sans transition. Dans la technique de narration cinématographique, la façon de faire avancer l'intrigue s'offre la plupart du temps par la vue successive de différents plans, lesquels n'ayant pas forcément de rapports flagrants entre eux : d'un plan à l'autre, on passe d'un lieu à l'autre, d'une temporalité à l'autre, différents personnages se succédant, sans que l'on se déplace. Le montage cinématographique peut être ainsi considéré comme similaire à une expérience de rêve, ce dernier baladant parfois son passager de la même façon. Ainsi, le pivot et la beauté d'Inception réside dans son usage de l'ellipse et du montage alterné (également fondement des premiers films de Nolan, Following et Memento).
L'ellipse d'abord, qui se trouve dans l'espace invisible entre deux plans, quand ceux-ci représentent deux séquences ne se suivant pas immédiatement dans le temps diégétique, le temps du film. Par exemple, juste après la première rencontre entre Ariane et Cobb dans son université, on les voit dans un nouveau plan sur le toit d'un building, Cobb lui faisant passer son entretien d'embauche : la création d'un labyrinthe. Puis, le plan d'après les montre attablés à un café, où ils ont une grande discussion sur le monde du rêve. Cobb demande alors à Ariane de se rappeler comment ils sont arrivés jusqu'ici. Elle ne peut pas s'en rappeler, car comme dans un rêve, ils y sont arrivés directement. Comme dans un rêve... comme dans un film, où l'enchaînement de plans distincts peut signifier à la fois un glissement temporel et spatial. En un claquement de doigts, 1/24ème de seconde, le paysage, l'échelle du plan, les personnages changent... Et toute la beauté du cinéma fait que le spectateur lui, reste physiquement immobile : c'est devenu naturel. Et lorsque l'ellipse est posée de façon explicite, l'on peut en venir à se demander si, dans le monde du film, les protagonistes sont en train de rêver, ou dans la réalité. En fait, dans Inception, le grand tour de passe-passe réside dans le fait que toute distinction entre rêve et réalité et tout bonnement impossible : Christopher Nolan installe le doute permanent sur la teneur des événements de son film ; y chercher une résolution paraît totalement illusoire.

Le montage alterné représente deux actions différentes qui se suivent temporellement ; il est grandement utilisé dans le film car, au bout de la première heure, plusieurs couches de récits se superposent, et ce jusqu'à la toute dernière image. Le récit va comporter jusqu'à cinq niveaux différents, tous interconnectés. Le travail de montage y est digne d'un chef d'orchestre virtuose ; il est grandement aidé, jusqu'à un tonitruant final, par la puissante musique électro de Hans Zimmer. Le compositeur, habitué des blockbusters et d'un musique grandiloquente, a intégré le concept des rêves emboîtés dans sa structure musicale même, utilisant le morceau d'Edith Piaf, "Je ne regrette rien", au ralenti, jusqu'à la rendre méconnaissable. En effet, les niveaux de rêves, dans le film, impliquent que plus on descend profond dans les niveaux, plus le temps passe lentement. On entendrait alors chaque son s'étendre encore et encore. Et, plus Inception s'approche de son final, et plus la musique se fait puissante, pour offrir un duo image / musique en forme de feu d'artifice des sens.
Le film, brassant des thèmes variés, n'a pas que des qualités : la partie "action" cannibalise par moments la force de la narration, comme lors du dernier acte dans le bunker enneigé. La poursuite à ski sonne comme un hommage un peu trop appuyé à la saga des James Bond, alors même que le film n'a pas besoin d'emprunts extérieurs pour exister.
D'autre part, la multiplication des éléments perturbateurs, laissant apparaître des failles gigantesques dans une préparation qu'on nous a préalablement fait croire comme méticuleuse, amoindrit la vraisemblance du récit.
Et pourtant, quel voyage au final ! la construction des rêves, la sensation de perdre pied puis de se retrouver, les nappes de synthés de Zimmer (qui lorgnent parfois vers Vangelis époque Blade Runner) s'accordent en symbiose pour un puissance émotionnelle décuplée. Car oui, cette débauche d'effets, de construction alambiquée, n'a au final qu'un seul but qu'elle atteint parfaitement : une très forte émotion, qui se prolonge après la vision du film, parfois ravivée par la seule écoute de la très belle bande originale du film.
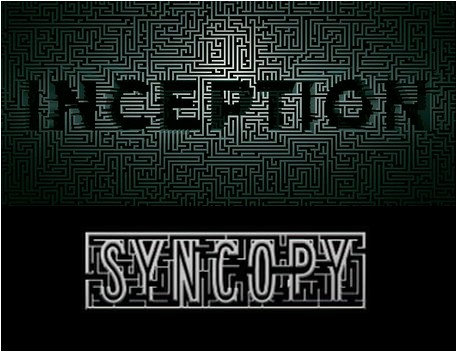
 Première tentative du français Pascal Laugier aux Etats-Unis, The Secret est aussi un bon film, chose assez rare dans ce cas de figure. The Secret (titre original : The Tall Man, décidément les as du marketing sont de sacrés farceurs) est effectivement un film malin, qui joue avec les conventions du thriller pour mieux capturer son spectateur dans une intrigue imprévisible. Film à twist, il est délicat de révéler son scénario ; tout juste peut-on dire que, dans une petite bourgade minière perdue au cœur des Etats-Unis, des enfants disparaissent.
Première tentative du français Pascal Laugier aux Etats-Unis, The Secret est aussi un bon film, chose assez rare dans ce cas de figure. The Secret (titre original : The Tall Man, décidément les as du marketing sont de sacrés farceurs) est effectivement un film malin, qui joue avec les conventions du thriller pour mieux capturer son spectateur dans une intrigue imprévisible. Film à twist, il est délicat de révéler son scénario ; tout juste peut-on dire que, dans une petite bourgade minière perdue au cœur des Etats-Unis, des enfants disparaissent. Réalisé entre
Réalisé entre 

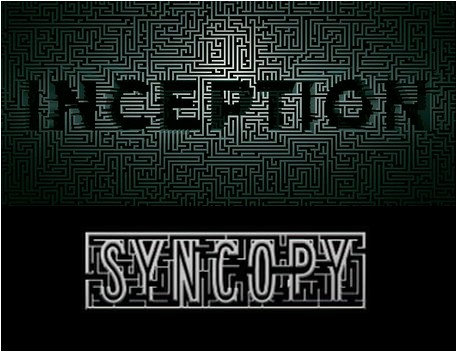



 Les films animés de DC Comics n'étaient pas, avant le milieu des années 2000, adaptés littéralement de récits pré-existants. Ainsi, les excellents
Les films animés de DC Comics n'étaient pas, avant le milieu des années 2000, adaptés littéralement de récits pré-existants. Ainsi, les excellents  De la SF à la française... Cela m'a longtemps laissé songeur (voir mes articles désabusés
De la SF à la française... Cela m'a longtemps laissé songeur (voir mes articles désabusés 

