Un film de Wolfgang Petersen
 La redécouverte de certains films ayant bercé notre enfance nous réserve souvent de fort agréables surprises. Cette histoire sans fin, dont j’avais oublié la plupart des passages, m’a replongé dans un univers fantastique tout bonnement exceptionnel, et pour ainsi dire aujourd’hui disparu ; la grâce des effets spéciaux "en dur" rend vraiment attachant un personnage comme le géant de pierre, doté d’un chara design imparable. Plusieurs aspects rendent ce film tout simplement beau : d’abord la force évocatrice rendue à l’acte de lecture. Les expressions de Bastien, qui sort épisodiquement les yeux de son livre, ou qui fait le geste de fermer l’ouvrage pour regarder la couverture, sont vrais. De même, l’immersion dans le récit reste un modèle quasi parfait, par le biais d’un visuel onirique, fait d’un bestiaire imaginaire vraiment réussi -le dragon, le loup, l’escargot de course, et la tortue géante, extraordinaire- et de décors désolés ou foisonnants assez impressionnants. Filmé avec tout ce qu’il faut pour rendre ces décors majestueux, le métrage nous offre une ballade dans le souffle brumeux d’un rêve éveillé. Des moments durs, comme tout bon conte initiatique (la mort du cheval, cruelle) ou d’autres qui s’inscrivent directement dans une dimension mystique (le passage des Sphynx). Bien que tourné la langue de Shakespeare, le film est presque entièrement allemand, et constitue à ce jour l’un des plus gros budgets du pays ; peuplé d’un casting dont on n’avait jamais croisé les têtes ailleurs, le monde du film s’ouvre et se referme en même temps que la séquence-titre et le mot fin, telle une parenthèse magique.
La redécouverte de certains films ayant bercé notre enfance nous réserve souvent de fort agréables surprises. Cette histoire sans fin, dont j’avais oublié la plupart des passages, m’a replongé dans un univers fantastique tout bonnement exceptionnel, et pour ainsi dire aujourd’hui disparu ; la grâce des effets spéciaux "en dur" rend vraiment attachant un personnage comme le géant de pierre, doté d’un chara design imparable. Plusieurs aspects rendent ce film tout simplement beau : d’abord la force évocatrice rendue à l’acte de lecture. Les expressions de Bastien, qui sort épisodiquement les yeux de son livre, ou qui fait le geste de fermer l’ouvrage pour regarder la couverture, sont vrais. De même, l’immersion dans le récit reste un modèle quasi parfait, par le biais d’un visuel onirique, fait d’un bestiaire imaginaire vraiment réussi -le dragon, le loup, l’escargot de course, et la tortue géante, extraordinaire- et de décors désolés ou foisonnants assez impressionnants. Filmé avec tout ce qu’il faut pour rendre ces décors majestueux, le métrage nous offre une ballade dans le souffle brumeux d’un rêve éveillé. Des moments durs, comme tout bon conte initiatique (la mort du cheval, cruelle) ou d’autres qui s’inscrivent directement dans une dimension mystique (le passage des Sphynx). Bien que tourné la langue de Shakespeare, le film est presque entièrement allemand, et constitue à ce jour l’un des plus gros budgets du pays ; peuplé d’un casting dont on n’avait jamais croisé les têtes ailleurs, le monde du film s’ouvre et se referme en même temps que la séquence-titre et le mot fin, telle une parenthèse magique.
La deuxième dimension remarquable que l’on retrouve dans l’histoire sans fin est une mise en abîme particulièrement soignée, que l’on doit d’ailleurs au livre de Michael Ende dont est tiré le film. Cette mise en abîme marchait sûrement encore mieux avec le livre, car le lecteur se trouvait, de fait, dans la même posture que Bastien, qui lit lui aussi un livre nommé L’histoire sans fin. La possibilité entrevue d’interagir avec les personnage du roman est un rêve d’enfant, qu’on tenté de reproduire de façon bancale ces ouvrages "dont vous êtes le héros". Cela vous rappelle-t-il quelque chose ?
L’histoire est aussi un pur Creature Movie dont chaque nouvelle scène comprend une ou plusieurs créatures fantasmagorique, et dont le récent Hellboy II est un avatar (assez réussi). D’où une multitude de bonnes raisons de toujours apprécier ce film une fois adulte ; et aussi parce que le film s’ouvre sur une chanson typique des eighties (donc à l’orchestration dépassée mais à la mélodie terriblement entraînante), une NeverEnding Story bien-nommée... J’ai hésité à vous proposer le clip de la chanson sur Youtube qui est assez autre... Mais non. L’histoire sans fin de Wolfgang Petersen doit garder son intégrité artistique. A l’heure où un remake de ce chef d’œuvre est en discussion à Hollywood, proclamons notre attachement à l’original !
80's - Page 9
-
L'histoire sans fin (1984)
-
L'année du dragon (1985)
Un film de Michael Cimino
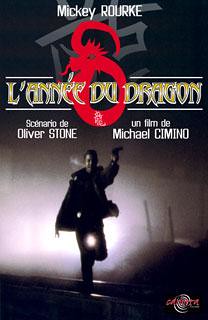 Ouf ! Après une longue semaine de silence critique (dûe entre autres à l’arrivée dans mon modeste lieu de vie d’un écran plat, à l’effet très hypnotisant...), nous découvrons aujourd’hui ce magnifique polar - film noir d’un Michael Cimino qui, décidément, est un grand metteur en scène. Après un Voyage au bout de l’enfer (1979) récemment visionné pour la première fois, ses films me font l’impression d’un grand choc tant esthétique que dramatique et lyrique, portés par des comédiens en état de grâce. C’est vraiment le cas ici avec la performance que livre Mickey Rourke, chien fou qui fonce tête baissée dans une croisade impossible contre le crime organisé dans Chinatown. Stanley White, son personnage, est hanté par l’échec (la guerre du Viêt-Nam, fantôme de l’œuvre de Cimino) et semble mener cette mission tant pour réussir enfin quelque chose, que pour fuir le monde qui l’entoure : son action peut être clairement interprétée comme une tentative de suicide, une fuite en avant. Entre sa femme qu’il délaisse et une journaliste chinoise qui l’attire, presque malgré lui, -représentant quand même tout ce qu’il cherche à oublier-, il semble définitivement ailleurs. Toujours flanqué d’un chapeau mou, réminiscence du film noir des années 40, son statut est flou : flic, il n’arbore pourtant jamais l’uniforme. Il semble se battre contre son propre camp, car c’est finalement un solitaire tant professionnellement que personnellement. Ces deux dimensions n’en font qu’une chez Stanley White, et de cet amalgame naîtront ses démons. En cela, il est l’architecte de sa propre déchéance.
Ouf ! Après une longue semaine de silence critique (dûe entre autres à l’arrivée dans mon modeste lieu de vie d’un écran plat, à l’effet très hypnotisant...), nous découvrons aujourd’hui ce magnifique polar - film noir d’un Michael Cimino qui, décidément, est un grand metteur en scène. Après un Voyage au bout de l’enfer (1979) récemment visionné pour la première fois, ses films me font l’impression d’un grand choc tant esthétique que dramatique et lyrique, portés par des comédiens en état de grâce. C’est vraiment le cas ici avec la performance que livre Mickey Rourke, chien fou qui fonce tête baissée dans une croisade impossible contre le crime organisé dans Chinatown. Stanley White, son personnage, est hanté par l’échec (la guerre du Viêt-Nam, fantôme de l’œuvre de Cimino) et semble mener cette mission tant pour réussir enfin quelque chose, que pour fuir le monde qui l’entoure : son action peut être clairement interprétée comme une tentative de suicide, une fuite en avant. Entre sa femme qu’il délaisse et une journaliste chinoise qui l’attire, presque malgré lui, -représentant quand même tout ce qu’il cherche à oublier-, il semble définitivement ailleurs. Toujours flanqué d’un chapeau mou, réminiscence du film noir des années 40, son statut est flou : flic, il n’arbore pourtant jamais l’uniforme. Il semble se battre contre son propre camp, car c’est finalement un solitaire tant professionnellement que personnellement. Ces deux dimensions n’en font qu’une chez Stanley White, et de cet amalgame naîtront ses démons. En cela, il est l’architecte de sa propre déchéance.
Plusieurs thèmes reviennent dans l’œuvre de Cimino ; parmi ceux-ci, la guerre du Viêt-Nam, mais aussi la dimension du sacré (la longue séquence du mariage dans Voyage au bout de l’enfer, ici les enterrements, les croix à tous les coins du cadre) et un pessimisme prégnant. Les flics s’arrangent avec la mafia, du coup ni vu ni connu, ils sont complices des pires atrocités. Les valeurs de bien ou de mal n’ont plus cours dans le monde de L’année du dragon. On y montre bien que chaque personnage abuse de la liberté qui lui est accordée, de la journaliste aux interpellations télévisées intrusives, au policier justicier qui doit bouleverser certains codes établis pour faire entendre sa voix, en passant par les mafieux, dont la fonction fondamentale est d’entraver les règles.
Le film de Cimino montre une communauté multi-ethnique (chinois, américains, polonais) qui résiste à l’image du melting-pot (celui-ci correspondant à un mélange harmonieux des hommes) et dessine plus un paysage compartimenté, où les différentes pièces communiquent mal. C’est dans cette partie que j’ai trouvé le film le plus juste et terrifiant. La mise en scène très opératique de Cimino (ah, La porte du paradis) accompagne à merveille cette sorte de danse d’amour et de mort. Utilisant bien les possibilités du Cinémascope, la ville en ressort comme un monstre tentaculaire qui semble porter en lui (ambiance poisseuse, ruelles sordides) les signes de la déliquescence qui est en marche. Un excellent moment de cinéma, d’ores et déjà mon film du mois (difficilement détrônable !). -
Tuer n'est pas jouer (1987)
Un film de John Glen
 Chaque opus de la saga James Bond a ses particularités. On peut ajouter qu’encore plus, les changements d’acteurs dans le rôle-titre occasionnent à chaque fois des mini-révolutions du ton, de l’ambiance, tout en restant fidèle à certains passages obligés. Il est vrai que Vivre et laisser mourir (Guy Hamilton, 1973) ne ressemble pas à un Sean Conney, que GoldenEye (Martin Campbell, 1995) n’a rien à voir avec Permis de tuer, que Casino Royale est très différent de tout le reste et, que Tuer n’est pas jouer, premier film dans lequel James Bond est incarné par l’acteur britannique Timothy Dalton, n’a rien à voir avec Roger Moore. Ou presque.
Chaque opus de la saga James Bond a ses particularités. On peut ajouter qu’encore plus, les changements d’acteurs dans le rôle-titre occasionnent à chaque fois des mini-révolutions du ton, de l’ambiance, tout en restant fidèle à certains passages obligés. Il est vrai que Vivre et laisser mourir (Guy Hamilton, 1973) ne ressemble pas à un Sean Conney, que GoldenEye (Martin Campbell, 1995) n’a rien à voir avec Permis de tuer, que Casino Royale est très différent de tout le reste et, que Tuer n’est pas jouer, premier film dans lequel James Bond est incarné par l’acteur britannique Timothy Dalton, n’a rien à voir avec Roger Moore. Ou presque.
Timothy Dalton incarne ici un James Bond plus humain, plus faillible, moins super-héroïque. Plus sombre également, il instaurera pendant son court règne le noir intégral comme tenue de prédilection, élément inédit qui en dit long sur l’état d’esprit qu’il donne (lui, et les producteurs qui voulaient modifier l’approche du personnage) à Bond. Malgré tout, le film n’échappe pas à une certaine continuité Mooresque ; aussi étrange que cela puisse paraître, certains dialogues semblent tout droit sortis d’un Bond période Moore, avec effet comique à répétition inclus, comme cette poursuite automobile où Dalton, entre deux coups d’arme à feu, plaisante sur les subtilités techniques de sa voiture avec Kara, James Bond girl en titre interprétée par Maryam d’Abo (qui entretient une sacrée ressemblance avec Natassja Kinski, soit dit en passant). On pense aussi à la fin de la séquence pré-générique, où Bond, en mauvaise posture avec son parachute abîmé, tombe comme par magie sur un bateau de plaisance où l’attend une femme en mal d’aventures : étonnant pour Timothy Dalton, qui s’interdira pratiquement tout humour dans Permis de tuer.
Lors de ce renouveau voulu de la franchise, l’accent est mis sur le retour aux sources ; entendons par là un récit d’espionnage dans la grande tradition de Bons baisers de Russie ; le trait tout à fait remarquable de ce Tuer n’est pas jouer réside dans l’accumulation de faux-semblants, caractéristique du genre, qui dominent toute l’histoire. La mission du pré-générique est une mission d’entraînement où les tirs sont à blanc ; mais, au cours de cette fausse mission, un élément va réellement tuer. Répond à cela la fausse reconversion du méchant Russe de service, Koskov (Jeroen Krabbé, vu dans les films de Verhoeven période hollandaise). Au sein de ses faux-semblants s’en insèrent d’autres, plus subtils : Kara nous est d’abord présentée comme une violoniste lors d’un concert au début du film, puis l’instant d’après comme un membre des tireurs d’élite chargé d’éliminer Koskov ; d’une part, c’est encore une couverture -Kara est en fait la maîtresse de Koskov, qui l’utilise pour brouiller les pistes-, d’autre part, elle n’est même pas un vrai sniper, mais part contre une vrai violoniste accomplie. Le faux-semblant est un peu plus complexe, comme celui qui consiste pour Bond à sortir avec Kara pour démêler le vrai du faux. S’il s’agit bien d’une mission, et donc d’un semblant d’affection, Bond va développer de vrais sentiments à son égard : dans la ronde interminable des faux que nous offre le film, les seuls qui jouent franc jeu sont Bond et Kara. Après la débandade de la fin d’exercice de Roger Moore, cette reprise réussie semblait inespérée. Même s’il est moins spectaculaire que le Bond suivant, Permis de tuer, cet opus apporte donc bien satisfaction ; la séquence pré-générique fait d’ailleurs preuve de beaucoup d’énergie, et les plans en vol sont assez exceptionnels. Seul l’éternelle rivalité est-ouest n’est pas si réussie avec son Russe caricatural (quel accent, quel jeu outré !). Du bon Bond, dans une saga jamais avare en surprises. -
Broadway Danny Rose (1984)
Un film de Woody Allen
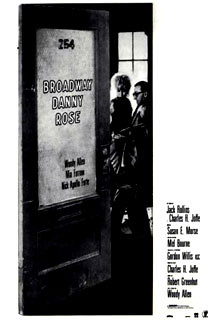 Nous sommes en 1984 et le cinéma de Woody Allen a déjà ses points culminants (Manhattan, Annie Hall, La rose pourpre du Caire). Son style est clairement établi : intellectuel, névrosé, parfois romantique et surtout, terriblement caustique.
Nous sommes en 1984 et le cinéma de Woody Allen a déjà ses points culminants (Manhattan, Annie Hall, La rose pourpre du Caire). Son style est clairement établi : intellectuel, névrosé, parfois romantique et surtout, terriblement caustique.
Danny Rose est un manager étrange, fantasque, capable de tout pour remonter le moral de ses troupes. C’est LE seul personnage de ce film ; tous les autres ne sont que périphériques, ou, mieux, des extensions de Woody Allen lui-même. Son humour, son élocution, sont l’unique objet du film, qu’il habite intégralement. Le flot des mots, dans une dynamique d’invasion, semble dicter sa loi au montage et à l’enchaînement des séquences. Une incroyable drôlerie émerge de ce flux ininterrompu, marquant un des meilleurs crus comiques du cinéaste New-yorkais. Une énergie hors du commun anime le tout, et, assortie à une faible durée (à peine 1h20), permet à l’ensemble de ressembler à une sorte de performance, un one-man show délirant. Les épisodes de la vie de Danny Rose sont vus au travers du prisme de ses amis, qui en discutent, attablés à un restaurant. On retrouvera la même construction plus tard, dans Accords et désaccords (1999), où des interviews de personnes connues (dont Allen) cautionnent le récit. Zelig, fameux docu-menteur réalisé par Allen un an avant Broadway Danny Rose, atteste encore de cette hésitation, cette impression de réel donnée par un dispositif qui installe le propos dans une sorte de réalité alternée qui préside au film.
La mise en scène, construite de longs travelling ou de plans fixes très composés (rehaussés par le choix du noir et blanc, typique du Woody Allen de la période fin 70’s-début 80’s) permet d’apprécier le spectacle d’un peu plus loin, ne se bornant pas à des plans rapprochés, ou à une simple mise en scène fonctionnelle, comme c’est le cas dans les films plus récents de Woody Allen.
Le passage de la poursuite dans le hangar à mascottes de la parade est un grand moment : après un coup de feu, une des baudruches est percée, laissant échapper dans l’air sa charge d’hélium. Les incartades entres les personnages prennent alors l’aspect d’un humour "cartoon" à la Tex Avery, à cause des voix, déformées par le gaz. C’est un bon exemple de l’imagination assez magique dont déborde le film. Mia Farrow, méconnaissable, fait penser à Faye Dunayay dans ce rôle d’une italienne hautaine, tellement high class comparé au pauvre Danny Rose que leur histoire donne au film un bel air de fantaisie, voire de parodie. En somme, un chef d’œuvre relativement méconnu du cinéaste. -
Permis de tuer (1989)
Un film de John Glen
 Permis de tuer, réalisé par John Glen, alias le réalisateur attitré de la franchise dans les années 80 et grand spécialiste des scènes d’action, nous ferait-il, une fois encore, voyager dans ce monde étrange, peuplé de "je-veux-devenir-le-maître-du-monde" en puissance, d’armes chimiques, d’explosions multiples, de cascades irréalistes et surtout, de belles demoiselles ? Pas tout à fait, ou pas seulement. Cet opus de l’éternelle saga d’espionnage, tout en dérogeant à quelques-unes de ces règles, tient bien la route encore aujourd’hui, alors que d’autres épisodes plus récents ont terriblement mal vieilli (je pense aux Pierce Brosnan, sans exception).
Permis de tuer, réalisé par John Glen, alias le réalisateur attitré de la franchise dans les années 80 et grand spécialiste des scènes d’action, nous ferait-il, une fois encore, voyager dans ce monde étrange, peuplé de "je-veux-devenir-le-maître-du-monde" en puissance, d’armes chimiques, d’explosions multiples, de cascades irréalistes et surtout, de belles demoiselles ? Pas tout à fait, ou pas seulement. Cet opus de l’éternelle saga d’espionnage, tout en dérogeant à quelques-unes de ces règles, tient bien la route encore aujourd’hui, alors que d’autres épisodes plus récents ont terriblement mal vieilli (je pense aux Pierce Brosnan, sans exception).Pour situer mon approche par rapport à notre cher agent secret, il faut savoir que de tous, je ne peux plus regarder ce qui constitue la pantalonnade Mooresque, qui fait de Bond un dandy maniéré sortant des vannes très moyennes toutes les deux secondes. Dans cette optique, la personnalité que Timothy Dalton insuffle au personnage, toute en rudesse mais également emplie de fragilités, hisse sa performance au sommet de mon Bondomètre personnel. Dalton, félin, pousse l’humain sur le devant de la scène. Ses relations personnelles fondent son code de conduite. De plus, il apporte de belles nuances grâce à un jeu toujours impeccable, alternant retenue et éclats de violence. En totale rupture avec Moore, il dit adieu à l’humour, et bonjour à l’aventure la plus violente de l’histoire de la franchise avec Permis de tuer. Le film a d'ailleurs souffert de nombre d’interdictions que n’avaient jamais eu à déplorer les films précédents. De nombreux moments gore sont au rendez-vous, mais ce n’est pas tout : la scène durant laquelle Bond essaye de savoir si Pam Bouvier est de mèche avec l’ennemi, témoigne d’une violence verbale et psychologique impressionnante. Le personnage y gagne grandement en crédibilité, en proximité De même, l’objectif de la mission de Permis de tuer n’est pas, contrairement à la tradition, commanditée par le MI6, mais constitue bel et bien une vendetta personnelle durant laquelle Bond n’est plus Bond ; son statut d’agent secret et son fameux permis de tuer lui sont retirés. Cette dimension nouvelle offre un modèle plus subversif de Bond, plus tête brûlée, qui sera évidemment mis à profit dans le dyptique Casino Royale/Quantum of Solace et par le tenant du titre actuel, Daniel Craig.
Le positionnement des James Bond girls, Pam Bouvier (Carey Lowell) et Lupe Lamora (Talisa Soto), est aussi bienvenu, s’engageant dans une dynamique de jalousie, formant avec Bond un ménage à trois lors de certaines scènes détonantes autant qu’inhabituelles. De plus, le film laisse vraiment réellement à Bond le soin de choisir sa préférence, plutôt qu’une solution de facilité très souvent exploitée au cinéma (soit l’une des deux meure, a un autre amant, ou est la vraie méchante de l’histoire, bref).
Le film étonne également par la place beaucoup plus grande qu’à l’accoutumée accordée à Q, assistant 007 sur le terrain. Il en ressort une certaine comédie, ce qui a toujours été le rôle privilégié de Q par delà les épisodes. La scène tordante dans laquelle il est déguisé en jardinier avec une grosse moustache et un balai rappellerait presque la folie de Clouseau pour les déguisements dans la Panthère rose ; las, la scène ne dure pas.
La saga sait se renouveler, et ses choix sont payants sur ce film qui, 20 ans après, fonctionne toujours. Le rythme est enlevé, malgré une durée conséquente (2h07) ; les péripéties, nombreuses, auront néanmoins tendance à perdre le spectateur ; comment Bond, par exemple, arrive jusqu’à l’usine-couverture de Sanchez et pourquoi ce dernier, sachant que l’agent secret n’est pas où il devrait être, ne s’en méfie pas plus ? On dira que si Permis de tuer gagne à tout focaliser sur le Bond nouvelle formule -éprouvé avec succès sur Tuer n’est pas jouer (John Glen, 1987)-, on n’échappe quand même à la machinerie gigantesque qui rentre dans le cahier des charges plus traditionnel des anciens Bond, en vigueur depuis Opération Tonnerre (Terence Young, 1965). Machines incroyables, lieux paradisiaques un brin mégalo (mais alors, juste un brin), armées de seconds couteaux auxquels est réservé un sort peu enviable (mention spéciale à une irruption de ninjas), séquences d’action aussi démesurées que surréalistes (ici, au choix, poursuite de camions-citernes avec passage sur deux roues à la clé, risque de collision en vol camion/avion, et encore, Tuer n’est pas jouer est loin d’être le plus démonstratif dans l’exercice).
Avouons-le, James Bond est le représentant quasi-unique d’un divertissement à échelle planétaire auquel on pardonne beaucoup de choses depuis le début (rappelez-vous quand même de Abondance Delaqueue, jeune fille qui accoste Bond, et à qui celui-ci répond : "ça vous vient de votre père, je pense ?", digne d’un American Pie). Un plaisir un peu honteux, une sorte de réalisation de fantasmes masculins variés qui fondent son succès public. Permis de tuer ne réussit cependant pas à être un grand succès à sa sortie, sûrement victime de ses écarts aux règles sus-citées. Malgré tout, le film tire sacrément bien son épingle du jeu et reste un épisode à part, marquant d’ailleurs la dernière participation de nombreuses personnes-clés de l’équipe, notamment Maurice Binder, qui réalisait ici son dernier générique et qui, grâce à son invention du fameux "gun barrel logo", avait défini l’image de la série dans son entier.