Un film de Alfred Hitchcock

Il fallait y passer tôt ou tard, à ce film qui donne son nom à ce blog. C’est, aussi bizarrement, le premier Hitchcock chroniqué en ces lignes. On ne l’avait pas revu depuis un bon moment, je dirais même que cela remonte à notre programmation de ce film au sein d’un ciné-club universitaire, en Avignon, aux alentour de la fin 2003. Notre souvenir en était un film plaisant, mais sans plus.
Adapté d’une pièce de théâtre de Frederix Knott, auteur déjà utilisé par Hitchcock pour La Corde (1948), Le crime était presque parfait a des similitudes avec ce même film. Il s’agit d’abord de la perpétration d’un crime parfait, mûrement réfléchi ; Tony Wendice (Ray Milland) prépare depuis au moins un an le meurtre de sa femme, tandis que La Corde voit deux hommes tuer un total inconnu, raison même, pensent-ils, de leur innocence. Ressemblance assez frappante aussi, avec L’inconnu du Nord-Express (1951), dans lequel Guy Haines (Farley Granger), tennisman, comme Wendice, se voit proposer un échange de meurtres, poursuivant toujours l’idée de la stratégie soi-disant parfaite de ce crime.
Histoire de meurtre donc, dont la présentation est un modèle d’économie narrative : un plan nous montre l’adorable couple Ray Milland - Grace Kelly s’embrasser, prendre le petit déjeuner, et le plan suivant nous montre le même baiser... sauf que le partenaire de Kelly a changé. Robert Cummings a pris la place de Ray Milland, et Grace Kelly est vêtue de rouge au lieu du blanc auparavant. L’image du couple idéal est démontée, et l’on sait désormais que sous les sourires de façade se cache un échec, celui du couple. Grace Kelly a l’air de s’ennuyer, tout comme Ray Milland, qui aura consacré un temps non négligeable aux préparatifs de son plan. On s’occupe comme on peut...
La première demi-heure est extrêmement bavarde, Wendice expliquant à un pauvre gars comment il a réussi à la piéger pour l’obliger à commettre le meurtre de sa femme. On pourrait se croire dans un épisode de Columbo un peu fade, mais la précision de l’explication, les dialogues aux mots si bien choisis, repris de la pièce, garantissent que l’on soit toujours menés vers un objectif clair. Le spectateur découvre ici, au fur et à mesure du premier récit de Wendice, comment il a échafaudé tout son plan. Avec quelle soin il a paramétré chacune des éventualités de l’affaire. C’est là, dans la différence entre l’extrême préparation et l’échec progressif de chaque action, que le film est intéressant. Une montre arrêtée, un meurtrier bien lourdaud, une improvisation continue de Wendice / Milland pour pallier aux ratés du plan, ... Tout s’emboîte finalement avec tant d’intelligence que l’intérêt du spectateur est continuellement renouvelé. Alors, même si Hitchcock ne compte pas ce film parmi ces réussites (voir le livre Hitchcock / Truffaut, à ce propos très éloquent), le public l’aura consacré comme un succès. Premier Hitchcock de Grace Kelly (qui jouera aussi dans Fenêtre sur cour (1954) et La main au collet (1955), il est tout de même honorable.
Si le film n’a pas la maestria visuelle de certaines réalisations du maître, certaines séquences sont très réussies, notamment celle du meurtre, commençant par cette montre arrêtée, et l’agression en direct au téléphone, un moment très bien géré. Entendre les cris étouffés de la victime, sans pouvoir rien y faire, n’est-ce pas le comble de l’horreur ? Ce ne l’est pas pour Wendice, qui, avec un accent bien sado-masochiste quand même, a attendu ce moment pendant des mois. C’est presque avec délectation qu’il reste pendu au téléphone, ne pipant mot, dans l’attente de la preuve sonore de la réussite du contrat.
Un film qui assure le minimum syndical, mais un minimum syndical d’Hitchcock ; ce qui reste toujours le haut du panier, question suspense !
Source image : affiche du film © Collection AlloCiné / www.collectionchristophel.fr


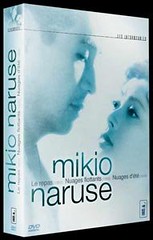 Après les visions pour le moins enthousiastes de
Après les visions pour le moins enthousiastes de