Un roman de Orson Scott Card et un film de Gavin Hood
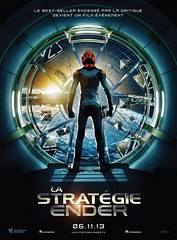 La stratégie Ender, le roman d'Orson Scott Card, procure une lecture jouissive : l'apprentissage du jeune Ender Wiggin, dans sa future bataille contre les Doryphores, alterne scènes de combats galactiques proches du jeu vidéo, tactique, peinture du quotidien tendu de l'entraînement militaire, alliances, camaraderie, sans oublier un récit parallèle sur Terre incluant le frère et la sœur d'Ender, qui permet de relier les destinées individuelles des personnages à un ensemble universel. L'adaptation de ce monument de SF pouvait susciter autant d'attentes que de craintes.
La stratégie Ender, le roman d'Orson Scott Card, procure une lecture jouissive : l'apprentissage du jeune Ender Wiggin, dans sa future bataille contre les Doryphores, alterne scènes de combats galactiques proches du jeu vidéo, tactique, peinture du quotidien tendu de l'entraînement militaire, alliances, camaraderie, sans oublier un récit parallèle sur Terre incluant le frère et la sœur d'Ender, qui permet de relier les destinées individuelles des personnages à un ensemble universel. L'adaptation de ce monument de SF pouvait susciter autant d'attentes que de craintes.
La première crainte soulevée fut celle de l'âge d'Ender Wiggin : alors qu'il est âgé de 5 ans dans le roman, le personnage, interpété par Asa Butterfield, en a 12 dans le film ; le but recherché est certainement de rendre plus crédible l'intelligence d'Ender. Clairement, c'est finalement loin d'être le problème majeur du film ; c'est même une ses rares qualités. Butterfield est juste impeccable dans le rôle, terriblement intelligent et sensible. Le rôle du colonel Graff, échu à Harrison Ford, pose lui un problème : par sa présence beaucoup plus importante que dans le roman, il devient bien moins ambivalent qu'il n'aurait du, moins sympathique et moins antipathique à la fois. Les extrêmes se perdent avec l'emploi d'acteur de la stature de Ford, qui doit incarner ce personnage entièrement. Pareillement, Mazer Rackam, joué par Ben Kingsley, perd beaucoup de nuances. Enfin, la problématique majeure du film reste évidemment qu'il faut tout montrer : on ne peut plus être laissé dans le flou (sur la forme de l'avant-poste des Doryphores, dont on ignore la nature pendant un long moment dans le roman). Par exemple, la stratégie de guerre et les exercices doivent être visualisés, or on comprend peu de choses sur ce qui se passe, et comment les joueurs arrivent à élaborer leurs formation, à part qu'ils sont toujours sur pont, jour comme nuit. On nous dit qu'ils sont fatigués, mais on ne le voit pas à l'image. Les cessions d'exercice en apesanteur sont, certes magnifiques visuellement, mais incompréhensibles...
Pourtant, les scènes cultes du bouquin sont retranscrites : les incursions d'Ender dans le jeu vidéo (des séquences casse-gueule qui ne passent pas vraiment dans le film), les bastonnades et humiliations dont est victime le héros, la première apparition de Mazer Rackam, les batailles majeures, les scènes de la première guerre contre les Doryphores... mais le compte n'y est pas. Pour cause, le spectateur est toujours à distance de ce qu'on lui montre, incapable de comprendre l'univers qu'on lui montre. Devant trousser un film de moins de 2h et privilégiant les scènes à effets, Gavin Hood rate le coche en ne donnant pas assez de temps à la mythologie pour se mettre en place. Le début commence ainsi trop rapidement, alors qu'on a pas de notion sur le temps qui passe par la suite ; l'apprentissage d'Ender dure plusieurs années dans le livre, alors qu'on a l'impression que quelques semaines à peine s'écoulent entre le début et la fin du film ; le sacrifice du personnage de Valentine et de Peter, le frère et la sœur de Ender, est symptomatique du sort réservé à l'intrigue : resserré sur les morceaux de bravoure, qui n'en sont plus faute d'explications.
Décidément, Gavin Hood n'a pas le nez creux sur ses projets hollywoodiens : entre X-Men Origins : Wolverine et Ender, les deux films resteront de très chers ratages.
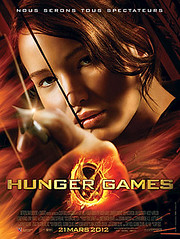 Disons l'évidence sans attendre : ces Hunger Games ne me disaient rient qui vaille, devant leur évident rapport avec
Disons l'évidence sans attendre : ces Hunger Games ne me disaient rient qui vaille, devant leur évident rapport avec 
 Ayant tout pour réussir, l'adaptation animée de DC se casse la figure dès le début : le design anguleux peu amène et caricatural (et surtout sans aucun rapport avec le style de Gary Frank) est typique de ces productions peu coûteuses dont l'animation est sous-traitée en Corée. Les quelques images de synthèse se repèrent à des kilomètres, les décors sont pauvres, sauf lors de la dernière séquence de combat entre Brainiac et Superman ; visuellement, seul le vaisseau de Brainiac s'en sort. La romance Clark / Lois n'est pas non plus très fine. Donnons tout de même quelque crédit à la première rencontre entre les deux personnages principaux, Superman, dérivant dans l'espace infini, se faisant absorbé par la tête de mort tentaculaire de Brainiac... Même si l'animé est donc décevant, il aura le mérite de faire revenir sur le devant de la scène ce personnage maléfique et intéressant qu'est Brainiac. L'année précédente, DC avait pourtant épaté tout le monde avec sa monumentale adaptation du définitif
Ayant tout pour réussir, l'adaptation animée de DC se casse la figure dès le début : le design anguleux peu amène et caricatural (et surtout sans aucun rapport avec le style de Gary Frank) est typique de ces productions peu coûteuses dont l'animation est sous-traitée en Corée. Les quelques images de synthèse se repèrent à des kilomètres, les décors sont pauvres, sauf lors de la dernière séquence de combat entre Brainiac et Superman ; visuellement, seul le vaisseau de Brainiac s'en sort. La romance Clark / Lois n'est pas non plus très fine. Donnons tout de même quelque crédit à la première rencontre entre les deux personnages principaux, Superman, dérivant dans l'espace infini, se faisant absorbé par la tête de mort tentaculaire de Brainiac... Même si l'animé est donc décevant, il aura le mérite de faire revenir sur le devant de la scène ce personnage maléfique et intéressant qu'est Brainiac. L'année précédente, DC avait pourtant épaté tout le monde avec sa monumentale adaptation du définitif 
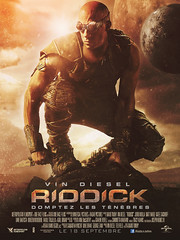 Pitch Black, le premier film de ce qui allait devenir une trilogie, était un survival à petit budget que se sortait bien des limites imposées par son budget. En 2004, Les chroniques de Riddick, grâce à une enveloppe autrement plus conséquente, s'enfonçait dans une fantasy à grand spectacle qui ne lui a pas vraiment réussi. De plus, le film est un four : 120 million de budget, 58 millions de recettes au États-Unis (115 millions monde). Cela en aurait refroidi plus d'un, mais c'est sans compter Twohy et la star du film, Vin Diesel, très attachés au personnage. Diesel s'investit financièrement dans l'affaire, et, au bout de quelques années, le projet est sur pied.
Pitch Black, le premier film de ce qui allait devenir une trilogie, était un survival à petit budget que se sortait bien des limites imposées par son budget. En 2004, Les chroniques de Riddick, grâce à une enveloppe autrement plus conséquente, s'enfonçait dans une fantasy à grand spectacle qui ne lui a pas vraiment réussi. De plus, le film est un four : 120 million de budget, 58 millions de recettes au États-Unis (115 millions monde). Cela en aurait refroidi plus d'un, mais c'est sans compter Twohy et la star du film, Vin Diesel, très attachés au personnage. Diesel s'investit financièrement dans l'affaire, et, au bout de quelques années, le projet est sur pied.