Deux films de Rian Johnson et Len Wiseman

Le rapprochement de certains films aident parfois à percevoir des points de convergences et des différences fondamentales de traitement : aujourd'hui, penchons-nous sur deux films de science-fiction sortis en 2012, qui possèdent de prime abord de sérieux antagonismes.
A prioris
Looper est un petit film avec une solide réputation, Total Recall : mémoires programmées est lui un blockbuster contenant déjà dans son titre un handicap pour les critiques. C'est un remake, d'un film presque culte et pas si vieux, Paul Verhoeven l'ayant réalisé en 1990. Looper et ses 30 millions de budget ne font économiquement pas le poids, face à un Total Recall : mémoires programmées et ses 200 millions. Rian Johnson, le réalisateur de Looper, avait épaté les quelques personnes qui avaient vu Brick, son film au bon goût de polar hard-boiled délocalisé dans les cours d'école. Len Wiseman, de son côté, s'est laissé catalogué dans les films d'action gothique avec la franchise Underworld, commercialement valable mais qualitativement douteuse. Cette situation de base génère des a priori bien compréhensibles, pour le public comme pour les critiques. Ceci étant, rien ne nous préparait à la réception de deux films aussi différents.
L'imagerie de science-fiction

Aborder la science-fiction au cinéma s'opère, au choix, sous deux prismes opposés : embrasser une imagerie fantastique débridée, validée par le décalage temporel que le genre propose, nous emmenant souvent à des dizaines voires des centaines ou des milliers d'années dans le futur, ou sur de lointaines galaxies. Ou bien, la jouer profil bas, en se tenant à quelques artefacts science-fictionnels (armes, véhicules, objets divers) entourés d'un monde pas si différent que celui que nous côtoyons chaque jour. On notera que, si cette tendance résulte de la pensée d'un futur pessimiste, misant sur l'effondrement du système capitaliste et donc, l'abandon d'un possible progrès technologique soutenu par la finance, ce choix est avant tout guidé par des contraintes budgétaires.
Les deux approches peuvent fournir de très bons films ; le scénario, une certaines vision et le sens du rythme font toute leur réussite. Dernièrement, Eva, un petit film de SF espagnol, est venu encore confirmer, s'il en était besoin, de la très bonne santé du genre ; du côté des blockbusters, Prometheus, même s'il ne fait pas l'unanimité, constitue malgré tout une très grande réussite SF.
Looper fait part de cette vision de science-fiction modeste visuellement : des voitures déglinguées rongées par la rouille pourrissent sur des parkings aux airs de terrain désaffectés, les habitudes vestimentaires n'ont que peu changées avec le vingtième siècle, les armes des loopers sont des tromblons crasseux plus proches d'un Mad Max que d'un Minority Report. Même la machine à remonter le temps, nœud central du film, est un globe métallique bricolé. Total Recall : mémoires programmées, lui, est un pur film de designers, tant chaque plan regorge de détails sur les cités tentaculaires, éclairés au néons et rempli d'objets ouvertement futuristes : implants téléphoniques, véhicules volants, écrans virtuels omniprésents... Deux conceptions du futur au cinéma s'affrontent.
Original versus copie
Looper est un film "original" : entendons par là, qu'il n'est ni une adaptation littéraire, ni un remake, ni une suite ou une version cinéma d'une série ou d'une idée sortie d'un parc d'attraction. Ce qui, avouons-le, est rare. Là où Total Recall, le remake, fait également clairement référence à des films majeurs de la science-fiction moderne (Blade Runner en tête pour l'aspect visuel), Looper tente le coup de la nouveauté... ou plutôt de la nouveauté déguisée. En effet, on remarque des inspirations très claires dans le déroulement de Looper, qu'il lorgne vers Akira (Katsuhiro Otomo, 1988) ou Terminator (James Cameron, 1984), mais aussi sur L'armée des 12 singes (Terry Gilliam, 1998), ... ce dernier étant déjà très inspiré par La jetée (Chris Marker, 1962). L'originalité se situe bien sîr dans le télescopage de plusieurs genres antagonistes, idées, atmosphères, rythmes. Et si Total Recall : mémoires programmées ne peut être qualifié d'original (malgré le nom d'une des sociétés productrices du films : Original Film, ça ne s'invente pas), il ne manque pourtant pas de qualités... qui sont plus difficiles à trouver du côté de Looper.
Total Recall, en sa qualité de remake d'un film très ancré dans la culture fantastique des cinéphiles, notamment le fameux passage de la femme aux trois seins, qu'on retrouve évidemment ici ; des références, il y en a d'autres, mais le film n'avait pas besoin de cela. Il demeure en l'état un film d'action tonitruant, habité d'une mise en scène dynamique et inventive (le plan-séquence du changement de point de vue au début du film, entre l'ancien et le nouveau Doug Quaid/Colin Farrell). De plus, il mixe son argument SF avec une tonalité post-apocayptique qui conditionne tout le récit. Il n'existe en effet plus que deux groupes de pays, l'alliance britannique et l’Australie. Le reste du monde n'est que poussière et vapeurs toxiques, héritées de guerres chimiques. Le remake est, en vérité et hormis les quelques clins d'oeil superflus, bien différent de son modèle : la planète Mars n'est pas visitée (conformément à la nouvelle de K. Dick), la configuration du monde et l'approche science-fictionnelle - qui mêlait aussi l'horreur dans le film de Paul Verhoeven- marque des divergences évidentes.

Looper, au-delà des quelques inspirations détaillées plus haut, souffre d'un trop plein d'idées, qu'on imagine pourtant bien élaguées : il y a fort à parier que le DVD/ Blu-ray à venir contienne un lot non négligeable de scènes coupées. Entre le voyage dans le temps, le rôle des loopers, ces boucleurs qui tuent par contrat des malfrats du futur, le mythe du faiseur de pluie, un concept général qui semble nous dire "tout n'est qu'un recommencement", « tout ce qui se passe a déjà eu lieu", et une sous-intrigue totalement inutile (un des loopers est poursuivi par ses employeurs mafieux pour vouloir échapper à sa mort programmée), le film mange à tous les râteliers et oublie de resserrer sa narration principale. Pire, avec le virage au milieu du film qui délocalise l'histoire dans une ferme au milieu de nulle part, on a à la fois l'impression de perdre l'atmosphère construite jusque-là, et la désagréable impression d'avoir changer de salle de cinéma en un instant : au voyage temporel, se substitue un voyage spatial qui manque terriblement de cohérence. Et, alors même que son scénario a été porté aux nues dans une multitude de festivals, c'est celui-là même qui fait dévisser le film.
Total Recall : mémoires programmées, malgré un passif assez lourd (qui l'a sûrement fait échouer lamentablement au box-office US), s'avère autrement plus réjouissant dans son approche. Dans son director's cut rallongé de 20 minutes disponible en vidéo, il fait preuve, a contrario de Looper, d'une belle cohérence, même si ses schémas sont traditionnels. Et si le doute "réalité ou fiction ?" habite moins le remake que le film de Verhoeven, la perfection du design, et l'histoire rondement menée autour de La Chute, seul moyen de relier les deux derniers territoires habitables, suffisent à lui procurer un degré de réussite bien supérieur à Looper. Et si l'on reconnaît sans l'ombre d'un doute l'ombre de Blade Runner ou celle de Minority Report, l'on est en droit de préférer l'approche de Total Recall, l'écran bardé de trouvailles science-fictionnelles délirantes, à celle de Looper, incohérente et tristement fade.
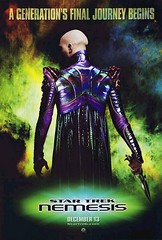 L'aventure cinématographique Star Trek avait de bonnes raisons de s'arrêter au numéro 9,
L'aventure cinématographique Star Trek avait de bonnes raisons de s'arrêter au numéro 9, 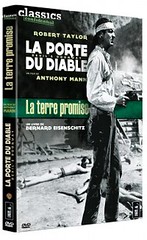 Quel film atypique que cette production du début de la décennie (le projet a réellement débuté en 1946) : il s'agit d'un des premiers films américains montrant la réalité du traitement des Indiens sur leur propre territoire. Cela explique sûrement pourquoi ce film, en avance sur son temps, est sorti en catimini et a fait un beau bide aux Etats-Unis. C'est un autre film, La flèche brisée (Delmer Daves), sorti la même année mais commencé plus tard que La porte du diable, qui aura les honneurs historique d'être qualifié de "premier film pro-Indien". La porte du diable possède pourtant un force réelle, bien expliquée dans le livre qui accompagne l'édition DVD prestigieuse parue chez Wild Side Video en juillet 2012.
Quel film atypique que cette production du début de la décennie (le projet a réellement débuté en 1946) : il s'agit d'un des premiers films américains montrant la réalité du traitement des Indiens sur leur propre territoire. Cela explique sûrement pourquoi ce film, en avance sur son temps, est sorti en catimini et a fait un beau bide aux Etats-Unis. C'est un autre film, La flèche brisée (Delmer Daves), sorti la même année mais commencé plus tard que La porte du diable, qui aura les honneurs historique d'être qualifié de "premier film pro-Indien". La porte du diable possède pourtant un force réelle, bien expliquée dans le livre qui accompagne l'édition DVD prestigieuse parue chez Wild Side Video en juillet 2012.