-
-
Ivanhoé (1952)
Un film de Richard Thorpe
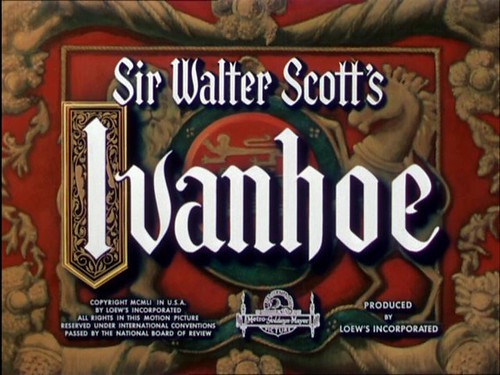
Digne film de chevalerie que Richard Thorpe réalise un an avant son autre classique Les chevaliers de la table ronde, toujours avec Robert Taylor (aucun lien avec Elizabeth), Ivanhoé conte les aventures de celui-ci, parti à la recherche de son bon roi Richard, dépossédé de la couronne d’Angleterre par son félon de frère, Jean.
Les constantes du film de chevalerie sont toutes ici réunies, tant et si bien qu’on a l’impression de voir un frère jumeau aux Aventures de Robin des Bois (Michael Curtiz, William Keighley, 1938), chef d’œuvre incontesté du genre. Robin, de son véritable nom Locksley, est bien présent dans le film, mais seulement en tant que partenaire de Ivanhoé ; lui et sa troupe (on reconnaît frère Tuck entre autres) vont aider notre chevalier à destituer le Prince Jean. Chose étonnante, le personnage n’est jamais nommé par son appellation universelle de Robin des Bois, et ses compagnons le sont encore moins. Sûrement dans le but de ne pas perturber le spectateur sur l’identité du véritable héros de l’histoire, les scénaristes et le réalisateur n’ont-ils pas voulu mettre un nom beaucoup plus connu que celui de Wilfried d’Ivanhoé dans le film. Cela reste tout de même très étrange, car on a tôt fait de se rendre compte qu’il s’agit de la même histoire, sous un autre angle, où les personnages annexes (Richard Cœur de Lion, Prince Jean) sont les mêmes.
Les passages obligés (tournois où l’arc est remplacé par la joute à cheval, duels à l’épée dans la plus grande tradition du genre) désignent une mythologie pure, faite de serments gardés et toujours tenus par les bons, et de traîtrises (un temps) impunies par les fielleux grimaçants. Mais l’esprit est là, débonnaire, et les acteurs portent bien cet idéal de pureté ou de malice. Robert Taylor est le seul, l’unique qui a persévéré pendant des années pour retrouver Richard Cœur de Lion. Il chante pour entendre une réponse, la suite de sa mélodie. Ce geste indique déjà combien le héros symbolise le héros classique dans sa pureté -et assume son origine romanesque via Walter Scott-, où dans un intemporel Moyen-âge sans nuage, des troubadours égayaient la vie des seigneurs avec chansons et drôleries. Pour le côté comique, Ivanhoé s’adjoint de Wamba, un esclave qu’il affranchit, et qui jouait auparavant le rôle du bouffon ; libre, il en sera toujours un.
L’histoire s’enrichit d’un triangle amoureux malheureusement sans enjeu car on sait bien que la droiture du héros empêche de rompre un serment préalablement fait à Lady Rowena (Joan Fontaine). Ainsi, la brune Rebecca (Elizabeth Taylor) aura un rôle plutôt ténu dans cette production hollywoodienne ; mais sa position est paradoxalement plus intéressante, valorisante que celle de sa rivale : elle est juive et en est fière, dans une lutte esquissée entre la chrétienté et le judaïsme ; l’ensemble donne d’ailleurs une bien meilleure image aux juifs qu’aux chrétiens. De plus, elle est experte en médecine "parallèle" -en cela c’est le personnage le plus moderne du film- car a fait son apprentissage avec une femme suspectée de sorcellerie : pour le Prince jean, ces informations sont suffisantes pour vouloir la faire mettre à mort au terme d’un procès truqué.
Les décors et les costumes, magnifiés par un Technicolor flamboyant, façonnent le mythe de la plus belle façon, même si le souffle épique aurait pu être plus accentué. Au lieu de cela, la musique symphonique typique des productions hollywoodiennes de l’âge d’or est de tous les plans, ce qu’on peut regretter, mais participe en même temps au charme d’une époque qui, aujourd’hui, semble bien lointaine, telle le fruit d’un rêve éveillé. En l’état, Ivanhoé est un bon rejeton classique du cinéma de la chevalerie, porteur d’un certain idéal, à ne pas négliger par ces temps de morosité... -
Permis de tuer (1989)
Un film de John Glen
 Permis de tuer, réalisé par John Glen, alias le réalisateur attitré de la franchise dans les années 80 et grand spécialiste des scènes d’action, nous ferait-il, une fois encore, voyager dans ce monde étrange, peuplé de "je-veux-devenir-le-maître-du-monde" en puissance, d’armes chimiques, d’explosions multiples, de cascades irréalistes et surtout, de belles demoiselles ? Pas tout à fait, ou pas seulement. Cet opus de l’éternelle saga d’espionnage, tout en dérogeant à quelques-unes de ces règles, tient bien la route encore aujourd’hui, alors que d’autres épisodes plus récents ont terriblement mal vieilli (je pense aux Pierce Brosnan, sans exception).
Permis de tuer, réalisé par John Glen, alias le réalisateur attitré de la franchise dans les années 80 et grand spécialiste des scènes d’action, nous ferait-il, une fois encore, voyager dans ce monde étrange, peuplé de "je-veux-devenir-le-maître-du-monde" en puissance, d’armes chimiques, d’explosions multiples, de cascades irréalistes et surtout, de belles demoiselles ? Pas tout à fait, ou pas seulement. Cet opus de l’éternelle saga d’espionnage, tout en dérogeant à quelques-unes de ces règles, tient bien la route encore aujourd’hui, alors que d’autres épisodes plus récents ont terriblement mal vieilli (je pense aux Pierce Brosnan, sans exception).Pour situer mon approche par rapport à notre cher agent secret, il faut savoir que de tous, je ne peux plus regarder ce qui constitue la pantalonnade Mooresque, qui fait de Bond un dandy maniéré sortant des vannes très moyennes toutes les deux secondes. Dans cette optique, la personnalité que Timothy Dalton insuffle au personnage, toute en rudesse mais également emplie de fragilités, hisse sa performance au sommet de mon Bondomètre personnel. Dalton, félin, pousse l’humain sur le devant de la scène. Ses relations personnelles fondent son code de conduite. De plus, il apporte de belles nuances grâce à un jeu toujours impeccable, alternant retenue et éclats de violence. En totale rupture avec Moore, il dit adieu à l’humour, et bonjour à l’aventure la plus violente de l’histoire de la franchise avec Permis de tuer. Le film a d'ailleurs souffert de nombre d’interdictions que n’avaient jamais eu à déplorer les films précédents. De nombreux moments gore sont au rendez-vous, mais ce n’est pas tout : la scène durant laquelle Bond essaye de savoir si Pam Bouvier est de mèche avec l’ennemi, témoigne d’une violence verbale et psychologique impressionnante. Le personnage y gagne grandement en crédibilité, en proximité De même, l’objectif de la mission de Permis de tuer n’est pas, contrairement à la tradition, commanditée par le MI6, mais constitue bel et bien une vendetta personnelle durant laquelle Bond n’est plus Bond ; son statut d’agent secret et son fameux permis de tuer lui sont retirés. Cette dimension nouvelle offre un modèle plus subversif de Bond, plus tête brûlée, qui sera évidemment mis à profit dans le dyptique Casino Royale/Quantum of Solace et par le tenant du titre actuel, Daniel Craig.
Le positionnement des James Bond girls, Pam Bouvier (Carey Lowell) et Lupe Lamora (Talisa Soto), est aussi bienvenu, s’engageant dans une dynamique de jalousie, formant avec Bond un ménage à trois lors de certaines scènes détonantes autant qu’inhabituelles. De plus, le film laisse vraiment réellement à Bond le soin de choisir sa préférence, plutôt qu’une solution de facilité très souvent exploitée au cinéma (soit l’une des deux meure, a un autre amant, ou est la vraie méchante de l’histoire, bref).
Le film étonne également par la place beaucoup plus grande qu’à l’accoutumée accordée à Q, assistant 007 sur le terrain. Il en ressort une certaine comédie, ce qui a toujours été le rôle privilégié de Q par delà les épisodes. La scène tordante dans laquelle il est déguisé en jardinier avec une grosse moustache et un balai rappellerait presque la folie de Clouseau pour les déguisements dans la Panthère rose ; las, la scène ne dure pas.
La saga sait se renouveler, et ses choix sont payants sur ce film qui, 20 ans après, fonctionne toujours. Le rythme est enlevé, malgré une durée conséquente (2h07) ; les péripéties, nombreuses, auront néanmoins tendance à perdre le spectateur ; comment Bond, par exemple, arrive jusqu’à l’usine-couverture de Sanchez et pourquoi ce dernier, sachant que l’agent secret n’est pas où il devrait être, ne s’en méfie pas plus ? On dira que si Permis de tuer gagne à tout focaliser sur le Bond nouvelle formule -éprouvé avec succès sur Tuer n’est pas jouer (John Glen, 1987)-, on n’échappe quand même à la machinerie gigantesque qui rentre dans le cahier des charges plus traditionnel des anciens Bond, en vigueur depuis Opération Tonnerre (Terence Young, 1965). Machines incroyables, lieux paradisiaques un brin mégalo (mais alors, juste un brin), armées de seconds couteaux auxquels est réservé un sort peu enviable (mention spéciale à une irruption de ninjas), séquences d’action aussi démesurées que surréalistes (ici, au choix, poursuite de camions-citernes avec passage sur deux roues à la clé, risque de collision en vol camion/avion, et encore, Tuer n’est pas jouer est loin d’être le plus démonstratif dans l’exercice).
Avouons-le, James Bond est le représentant quasi-unique d’un divertissement à échelle planétaire auquel on pardonne beaucoup de choses depuis le début (rappelez-vous quand même de Abondance Delaqueue, jeune fille qui accoste Bond, et à qui celui-ci répond : "ça vous vient de votre père, je pense ?", digne d’un American Pie). Un plaisir un peu honteux, une sorte de réalisation de fantasmes masculins variés qui fondent son succès public. Permis de tuer ne réussit cependant pas à être un grand succès à sa sortie, sûrement victime de ses écarts aux règles sus-citées. Malgré tout, le film tire sacrément bien son épingle du jeu et reste un épisode à part, marquant d’ailleurs la dernière participation de nombreuses personnes-clés de l’équipe, notamment Maurice Binder, qui réalisait ici son dernier générique et qui, grâce à son invention du fameux "gun barrel logo", avait défini l’image de la série dans son entier.
