Un film de Bong Joon-ho
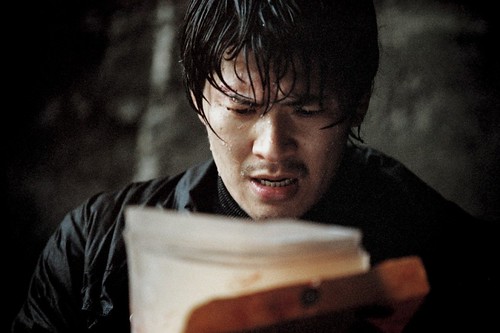
Découvrir Memories of murder après The Host, second film de Bong Joon-Ho, n'a pas grande importance : il confirme ou fait découvrir un talent raffiné pour le cinéma. Memories of murder, resitué dans le contexte de sa sortie salles, correspond à un essor du cinéma sud-coréen en France, témoignant de l'intérêt des distributeurs et des spectateurs. D'abord orienté film d'auteurs (on découvre L'île et Printemps, été, automne, hiver... et printemps de Kim Ki-Duk, Ivre de femmes et de peinture de Im Kwon-Tep, le cinéma coréen importé en France montre son visage le plus jouissif, celui du film de genre. Investissant parfois l'horreur ou le fantastique (2 Soeurs, Kim Jee-woon, 2003, 3 extrêmes, 2004), il se fait massivement le héraut d'un polar léché et condensé (Old Boy, Park Chan-wook, 2004, A Bittersweet Life, Kim Jee-woon, 2006, The Chaser, Hong Ji-na, 2009). C'est dans cette deuxième catégorie que rentre Memories of murder, que l'on pourrait prophétiquement rapprocher du grand Zodiac (2007) de David Fincher. Basé comme ce dernier sur les méfaits d'un serial-killer dont one ne retrouvera pas la trace, le film est autant la tragédie d'un petit village de la province de Gyunggi, que le portrait joyeusement délirant d'un petit monde de policiers ratés et de doux illuminés.
Le mélange des genres, si cher à Bong Joon-ho, semble être la potion magique de ses films, captivant le spectateur en laissant toutes les portes ouvertes : la comédie se mêle au drame, l'horreur à la chronique des petits maux quotidiens ; comme la vie... en un peu plus fou.
Les personnages semblent tout droit sortis d'un manga (Song Kang-ho en tête, vu récemment dans Thirst, ceci est mon sang, et déjà dans The Host) et s'insèrent dans un canevas extrêmement élaboré, où l'oeil du technicien (cadrages extrêmes, très composés) ne quitte pas celui de l'amoureux des personnages, qui, par leurs petites manies et leur naturel très peu professionnel, nous intéresse avant que l'action principale du film ne commence réellement. Celle-ci ne traîne d'ailleurs pas, et l'on prend le train en marche dès les premières minutes. L'enquête et les méthodes employées pour obtenir des résultats, loin d'être orthodoxes, proposent une relecture des films de serial-killers, comme l'anti Se7en (encore un film de David Fincher, 1995). AU cadre glauque de la ville dans Se7en, le réalisateur sud-coréen préfère le calme apparent la sérénité des paysages d'un petit village. Pour entériner ce contrepied, l'inspecteur Seo Tae-yoon quitte Séoul pour venir, attiré par l'affaire. Très méthodique et bien plus professionnel que ses nouveaux collègues, ce sera lui, pourtant, qui basculera dans l'obsession pour ce mystère, voulant à tous prix boucler le coupable, perturbant ainsi son objectivité. Tout comme Paul Avery dans Zodiac, s'exposant alors que des plaies psychologiques le minait déjà de l'intérieur.
Avant The Host, un très bon film qui ne lâche jamais le spectateur, lui intimant l'ordre de suivre, captivé, le déroulement de son imprévisible intrigue.
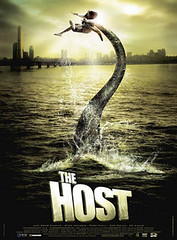 Caractéristique de la très haute qualité de films de genre produits par la Corée du sud, The Host déjoue toute classification rationnelle, slalomant entre les étiquettes. Cette histoire de famille confrontée à un monstre surpuissant provenu des profondeurs du fleuve Han, mêle ainsi comédie et drame (dans la même scène, au même instant), ainsi que pure action et, évidemment, film de monstre. Et quel monstre ! Sorti tout droit du studio Weta Workshop (qui a créé tout le bestiaire du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson), il est fabuleusement détaillé, ultra-réaliste dans ses interactions avec les êtres humains du film. The Host est donc un vrai film de monstres, héritier des Kaiju Eiga japonais et de Godzilla, son porte-étendard mondial. La façon de dévoiler le monstre en plein jour, dans des séquences où l’on peut clairement être témoin des dommages qu’il crée à l’environnement, ainsi que l’origine humaine de son caractère monstrueux (ici pollution via des produits hautement toxiques, hier fruit de la bombe nucléaire) crée un parallèle parfait entre les deux monstres.
Caractéristique de la très haute qualité de films de genre produits par la Corée du sud, The Host déjoue toute classification rationnelle, slalomant entre les étiquettes. Cette histoire de famille confrontée à un monstre surpuissant provenu des profondeurs du fleuve Han, mêle ainsi comédie et drame (dans la même scène, au même instant), ainsi que pure action et, évidemment, film de monstre. Et quel monstre ! Sorti tout droit du studio Weta Workshop (qui a créé tout le bestiaire du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson), il est fabuleusement détaillé, ultra-réaliste dans ses interactions avec les êtres humains du film. The Host est donc un vrai film de monstres, héritier des Kaiju Eiga japonais et de Godzilla, son porte-étendard mondial. La façon de dévoiler le monstre en plein jour, dans des séquences où l’on peut clairement être témoin des dommages qu’il crée à l’environnement, ainsi que l’origine humaine de son caractère monstrueux (ici pollution via des produits hautement toxiques, hier fruit de la bombe nucléaire) crée un parallèle parfait entre les deux monstres. Après l’uppercut Old Boy (2004), le cinéaste coréen avait déjà quelque peu déçu les spectateurs de son Sympathy for lady vengeance (dont nous ne gardons qu’un souvenir lointain et... vide). Découvrant Je suis un cyborg (dont le titre anglais, I’m a cyborg but that’s OK, donne déjà plus d’indices sur le décalage assumé du propos), on ne peut qu’être qu’objectivement gêné.
Après l’uppercut Old Boy (2004), le cinéaste coréen avait déjà quelque peu déçu les spectateurs de son Sympathy for lady vengeance (dont nous ne gardons qu’un souvenir lointain et... vide). Découvrant Je suis un cyborg (dont le titre anglais, I’m a cyborg but that’s OK, donne déjà plus d’indices sur le décalage assumé du propos), on ne peut qu’être qu’objectivement gêné.