Un film de Joss Whedon
 Le cinéma américain nous offre depuis une dizaine d'années notre dose de super-héros, devenus désormais incontournables sur le médium. Cependant, la démarche initiée par Marvel depuis Iron Man (Jon Favreau, 2008) est inédite : introduire les personnages marquants de son univers, puis en offrir la synthèse par leur regroupement dans un seul film : ainsi aboutira le projet Avengers. De la même façon, dans la réalité des films, Nick Fury (Samuel L. Jackson) compose "the Avengers Initiative", recrutant à chaque nouveau film le personnage principal. Captain America, Hulk, Thor et Iron Man ont tenu le haut de l'affiche, avec des fortunes diverses : si Iron Man proposait un personnage rock n' roll, cynique, un orgueilleux magnifique, les autres ne sont pas logés à la même enseigne. Si Captain America est à peu près épargné grâce au décalage propre au film d'époque -sans transcender un schéma très routinier-, L'Incroyable Hulk (Louis Leterrier, 2008) est un actioner comme les autres, Thor (Kenneth Branagh, 2011) se noie dans un ridicule assumé, sans parler d'un Iron Man 2 (Jon Favreau, 2010) souffrant quant à lui d'un contre-performance d'anthologie. Bref, le super-héros boit la tasse. Compte tenu de ce passif très moyen, que pouvait-on espérer de ces Avengers enfin réunis ?
Le cinéma américain nous offre depuis une dizaine d'années notre dose de super-héros, devenus désormais incontournables sur le médium. Cependant, la démarche initiée par Marvel depuis Iron Man (Jon Favreau, 2008) est inédite : introduire les personnages marquants de son univers, puis en offrir la synthèse par leur regroupement dans un seul film : ainsi aboutira le projet Avengers. De la même façon, dans la réalité des films, Nick Fury (Samuel L. Jackson) compose "the Avengers Initiative", recrutant à chaque nouveau film le personnage principal. Captain America, Hulk, Thor et Iron Man ont tenu le haut de l'affiche, avec des fortunes diverses : si Iron Man proposait un personnage rock n' roll, cynique, un orgueilleux magnifique, les autres ne sont pas logés à la même enseigne. Si Captain America est à peu près épargné grâce au décalage propre au film d'époque -sans transcender un schéma très routinier-, L'Incroyable Hulk (Louis Leterrier, 2008) est un actioner comme les autres, Thor (Kenneth Branagh, 2011) se noie dans un ridicule assumé, sans parler d'un Iron Man 2 (Jon Favreau, 2010) souffrant quant à lui d'un contre-performance d'anthologie. Bref, le super-héros boit la tasse. Compte tenu de ce passif très moyen, que pouvait-on espérer de ces Avengers enfin réunis ?
Comprenons-nous bien, j'abordai la vision du film avec bonheur : d'abord assez indifférent au projet malgré mon grand intérêt pour le genre, l'emballement public m'avait convaincu. Or, si Avengers reste dans la norme Marvel, point d'étincelles à l'horizon : il ne détrônera pas Iron Man, premier du nom.
Empruntant à plusieurs films pré-existant sa matière scénaristique, le début peut ainsi désarçonner pour qui n'a pas suivi les dernières péripéties des héros Marvel : la place prépondérante du Tesseract, le cube cosmique vu dans Thor, puis Captain America, est symptomatique du récit "sériel" que tente de filer Marvel.
Avengers subit également la dynamique du "bigger, faster, louder" dont est coutumière l'industrie hollywoodienne. Ainsi, la séquence d'ouverture, se clôturant par un explosion dantesque, pourrait très bien s'insérer comme climax final d'un autre film. Après cette détonante scène d'intro qui nous prend un peu de court, le film continue d'enchaîner les scènes d'action en laissant peu de chance aux personnages d'exister, en particulier Thor (dont l'entrée en scène arrive comme un cheveu sur la soupe), et même le Cap, souvent réduit à une caricature par les piques -très drôles- de Tony Stark. Dommage, car l'interprétation excellente de Mark Rufallo (Bruce Banner / Hulk) méritait d'être plus développée. Petite incompréhension au passage : comment Hulk, dont le comportement incontrôlable est bien démontré lors de sa première transformation, devient policé en ne prenant pour cible que les adversaires des Avengers, sauvant même Iron Man ? Le contrôle de la personnalité montrueuse de Banner, justifié par un "Je suis toujours en colère", n'est pas non plus très clair... Est-t-il toujours lui-même alors qu'il est Hulk ? Les auteurs du comic-book ont depuis toujours tranché pour l'autre option, allant même jusqu'à faire aujourd'hui du docteur Banner et de Hulk deux personnes distinctes !
Un peu comme Thor (et ses références à la pop-culture un peu dépassées, remember Xéna), Avengers essaye de trouver un ton décalé, en insérant dans des séquences relativement sérieuses des appartés totalement farfelues, à l'instar de cet informaticien qui, une fois le grand speech de Fury passé, jette un œil autour de lui et se met à jouer à Space Invaders... Clin d’œil geek tellement décalé qui ne marche pas vraiment, nous sortant de l'univers du film, au contraire des surnoms donnés par Stark, assimilant Thor au Patrick Swayze de Point Break, et surtout Oeil de Faucon (Jeremy Renner) à Legolas du Seigneur des Anneaux, réflexion que le spectateur se fait dès qu'il voit le personnage décocher ses flèches. Au final, le film manque de respirations, et aussi d'une musique à la hauteur. Alan Silvestri, si inspiré par le passé, ne propose ici qu'une partition déjà entendue, mêlant une orchestration à la Danny Elfman pour Spider-Man (par exemple dans Assemble : percussions métalliques, envolées de violons). A part ses bonnes saillies, rien de neuf à l'horizon, donc, pour cet Avengers pas déhonorant, mais bien peu enthousiasmant : la synergie annoncée n'a pas eu lieu.
 Peu de temps après le succès public de
Peu de temps après le succès public de 
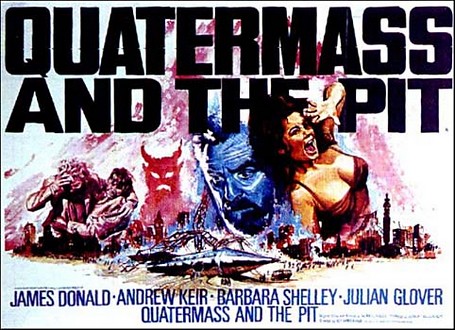
 Sept ans après
Sept ans après 