Un film de Sam Mendes
"Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes"
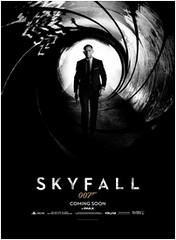 Le James Bond de l'an 2012 est différent. Après la paire Casino Royale / Quantum of Solace, de nouvelles aventures attendent l'agent secret le plus connu de la planète. Trop influencé par le style heurté de Jason Bourne dans l'opus précédent, la franchise revient plus posée, plus torturée (comme le veut la mode des séries aujourd'hui), plus profonde aussi. Ancienne recette, nouveau goût. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle saga : James Bond reste James Bond.
Le James Bond de l'an 2012 est différent. Après la paire Casino Royale / Quantum of Solace, de nouvelles aventures attendent l'agent secret le plus connu de la planète. Trop influencé par le style heurté de Jason Bourne dans l'opus précédent, la franchise revient plus posée, plus torturée (comme le veut la mode des séries aujourd'hui), plus profonde aussi. Ancienne recette, nouveau goût. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle saga : James Bond reste James Bond.
Les films James Bond ont rapidement créé un ensemble d'aspects indissociables de la mythologie, balisant le cours de leur intrigue avec un certain nombre de passages obligés : la séquence pré-générique, qui montre la fin d'une mission réussie, le plus souvent sans rapport avec le reste du métrage ; le générique, véritable film dans le film, immortalisé par les trucages optiques de Maurice Binder, dont les héritiers suivent aujourd'hui les pas. Viennent ensuite l'entrée en scène des James Bond Girls, de la nemesis en titre, la présentation des gadgets par Q, l'arrivée du fameux "Bond ; James Bond", présentation héritée du tout premier film, Dr. No (Terence Young, 1962).
Cinquante ans plus tard, tout est encore là, ou presque. Les films, tout en s'inscrivant clairement dans la tradition bondienne, posent également un regard post-moderne sur ces passages obligés. Si certains sont dans la droite ligne des précédents, d'autres s'en démarquent allègrement. Pour les premiers, notons dans Skyfall la séquence pré-générique, qui se conclue par la mort supposée de Bond, que vient confirmer la note nécrologique rédigée par M en personne. Ces images rappellent tout à la fois celles de Bons baisers de Russie (Terence Young, 1963), où un tueur s'entraîne sur un faux James Bond, ou encore d'On ne vit que deux fois (Lewis Gilbert, 1967), et son enterrement maritime en bonne et due forme pour l'agent préféré de sa Majesté. Mais elles s'inscrivent elles-mêmes dans la tradition des serials, dont chaque scène se clôturait par un cliffhanger, misant tout sur le suspense. Le générique de Skyfall ne déroge pas non plus à la règle, sublime, cauchemar de mort épaulé par la voix suave de la chanteuse Adele.
La rupture viendra d'abord dès la fin du générique, où James Bond est amoché, presque vieilli par une barbe de trois jours qu'il garde un moment. L'élégance britannique n'est plus ce qu'elle était, mais James reste cool et est toujours amateur de top-models. Pour l'intronisation du nouveau Q ("Q" désignant désormais un corps de spécialistes en espionnage informatiques, et accessoirement en gadgets), on passe du côté réinvention. Grâce à l'excellent Ben Wishaw, la rencontre entre Bond et Q brille d'un force de comédie toute en retenue, faite de petites piques gentilles ; puis pour la présentation des gadgets proprement dits, on sert à nouveau (comme c'est le cas depuis le redémarrage de la franchise avec Daniel Craig et Casino Royale) la carte du minimalisme, Bond utilisant une radio portative -minimalisme rappelé avec ironie par les deux camps à deux reprises.
Oscillant constamment entre modernité et tradition, le film fait également le grand écart entre blockbuster et film d'auteur ; entre l'art et le commerce, les limites ne sont plus juste brouillées : elles n'existent plus. Sam Mendes, réalisateur reconnu au cinéma, metteur en scène également au théâtre, ose des séquences qui n'auraient pas trouvé leur place dans un Bond il y a dix ans ; notamment la première apparition de Silva (Javier Bardem), qui suit en un long plan fixe la première confrontation entre Bond et son ennemi. Là où d'autres auraient entrecoupé la scène d'inserts sur les mains du personnage, pour accentuer sa gestuallle particulière, ou sur ses pas, afin de dynamiser l'ensemble, on reste ici témoin sur la durée de la folie du personnage. Un personnage dont les tics névrotiques rappellent ceux du Joker dans The Dark Knight ; assurément une référence pour le James Bond nouveau genre. L'autre séquence qui plane au-dessus du reste du film est le passage à Shanghaï où, sous des néons à la dominante bleutée, Bond observe et rampe telle une ombre, se confondant constamment avec le décor, donnant un côté à la fois technoïde et planant à cette aventure.
Les personnages ainsi que certaines scènes exotiques sont mémorables ; Mendes semble ne pas vouloir reproduire les erreurs de Quantum of Solace, en posant davantage sa caméra, et en développant un arc narratif étonnant dans le troisième tiers du film, mettant au centre le personnage de M, puis donnant quelques informations sur le passé de Bond. Cependant, pour autant que le choix soit osé, il n'est pas payant (pas en tous cas, à hauteur de l'enjeu) ; le film bifurque en effet dans sa dernière partie, enfermant les personnages et leurs destinées dans un petit coin de campagne perdue, où se déroulera certes un sauvage affrontement. Cette bifurcation est un retour au passé, comme Bond le fait bien comprendre à M en empruntant une Aston Martin, clone de celle de Sean Connery dans Goldfinger.
Les James Bond Girls sont malheureusement peu exploitées, peu présentes, nouant une relation des plus basiques avec Bond ; ainsi, si l'on a gardé en mémoire l’extraordinaire changement qu'a incarné Vesper (Eva Green) dans Casino Royale, on retrouve là un canevas bien connu, commun à beaucoup de films de la franchise. La belle fille est là, qui n'attend que son tour pour succomber à l'étreinte dépassionné d'un Bond en pleine mission. L'humour a par contre disparu de ces scènes, pourtant coutumier à l'ère Roger Moore, et même Connery. Entre tradition et modernité, toujours.
Là où l'on attendait vraiment pas Skyfall, c'est donc dans son dernier mouvement, très low profile (on ne se croit plus du tout dans un Bond, mais un film de vengeance lambda) ; et là, surprise du chef que personne n'avait vu venir : une fin savoureuse (que je vous laisse découvrir) en forme d'hommage au début de la saga, avec des clins d’œil extrêmement appuyés au décorum, aux personnages et à l'ambiance qui a fait toute la réussite de cette collection de films depuis cinquante ans. Donc, Bond a changé... pour redevenir exactement celui qu'il a toujours été. En ce sens, et malgré la qualité fluctuante de ce Skyfall un brin dépressif, il incarne une des icônes les plus éclatantes du septième art.

 Sorti en salles en catimini en plein été, cette nouvelle version de l’œuvre de Charlotte Brontë mérite qu'on s'y attarde. Jane Eyre, avec plus d'une dizaine d'adaptations au cinéma, ne laisse pas de fasciner les réalisateurs, avec son histoire tragique, sur fond d'histoire d'amour contrariée. Ici, la lande brumeuse et les teintes, quasi-transparentes, transforment le récit en ballade onirique, complexifiant un peu la trame chronologique du roman avec quelques allers-retours temporels.
Sorti en salles en catimini en plein été, cette nouvelle version de l’œuvre de Charlotte Brontë mérite qu'on s'y attarde. Jane Eyre, avec plus d'une dizaine d'adaptations au cinéma, ne laisse pas de fasciner les réalisateurs, avec son histoire tragique, sur fond d'histoire d'amour contrariée. Ici, la lande brumeuse et les teintes, quasi-transparentes, transforment le récit en ballade onirique, complexifiant un peu la trame chronologique du roman avec quelques allers-retours temporels. Le cinéma américain nous offre depuis une dizaine d'années notre dose de super-héros, devenus désormais incontournables sur le médium. Cependant, la démarche initiée par Marvel depuis Iron Man (Jon Favreau, 2008) est inédite : introduire les personnages marquants de son univers, puis en offrir la synthèse par leur regroupement dans un seul film : ainsi aboutira le projet Avengers. De la même façon, dans la réalité des films, Nick Fury (Samuel L. Jackson) compose "the Avengers Initiative", recrutant à chaque nouveau film le personnage principal. Captain America, Hulk, Thor et Iron Man ont tenu le haut de l'affiche, avec des fortunes diverses : si Iron Man proposait un personnage rock n' roll, cynique, un orgueilleux magnifique, les autres ne sont pas logés à la même enseigne. Si Captain America est à peu près épargné grâce au décalage propre au film d'époque -sans transcender un schéma très routinier-, L'Incroyable Hulk (Louis Leterrier, 2008) est un actioner comme les autres, Thor (Kenneth Branagh, 2011) se noie dans un ridicule assumé, sans parler d'un
Le cinéma américain nous offre depuis une dizaine d'années notre dose de super-héros, devenus désormais incontournables sur le médium. Cependant, la démarche initiée par Marvel depuis Iron Man (Jon Favreau, 2008) est inédite : introduire les personnages marquants de son univers, puis en offrir la synthèse par leur regroupement dans un seul film : ainsi aboutira le projet Avengers. De la même façon, dans la réalité des films, Nick Fury (Samuel L. Jackson) compose "the Avengers Initiative", recrutant à chaque nouveau film le personnage principal. Captain America, Hulk, Thor et Iron Man ont tenu le haut de l'affiche, avec des fortunes diverses : si Iron Man proposait un personnage rock n' roll, cynique, un orgueilleux magnifique, les autres ne sont pas logés à la même enseigne. Si Captain America est à peu près épargné grâce au décalage propre au film d'époque -sans transcender un schéma très routinier-, L'Incroyable Hulk (Louis Leterrier, 2008) est un actioner comme les autres, Thor (Kenneth Branagh, 2011) se noie dans un ridicule assumé, sans parler d'un  Sept ans après
Sept ans après 