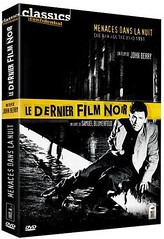Un film de Robert Wise
 L'histoire de la naissance cinématographique du film, tirée de la série de science-fiction humaniste de Gene Roddenberry, est sans nulle doute plus passionnante que le film qui en a résulté. Souhaitant porter la mythologie Star Trek à l'écran dès le milieu des années 70, Paramount mise d'abord sur un projet de long-métrage, Star Trek : Planet of the Titans, dans lequel l'équipage du vaisseau Enterprise était opposés à leur ennemis classiques, les Klingons, autour d'un peuple antédiluvien, point d'origine de tous les autres, les Titans. Au détour d'un voyage dans le temps, l'équipage de Kirk se retrouvaient à incarner ces fameux Titans. Envisagé jusqu'au alentours de 1977 puis annulé, le projet laisse la place à une nouvelle série télé, baptisée Star Trek : Phase II, qui ira beaucoup plus loin dans sa phase de pré-production, le casting, scénarios et les storyboards ayant été produits (quelques-uns de ces derniers ont été utilisés dans la série Star Trek : The Next Generation). Quatre semaines avant le début de la production, la série est elle aussi annulée, mais le succès de Star Wars au cinéma ne peut laisser les exécutifs de Paramount insensibles. Un des scénarios écrits pour la série mort-née fut donc l'idée de départ de ce Star Trek : le film, qui est le seul de la série cinématographique à avoir été envisagé en indépendant, sans fin vraiment ouverte pour la suite des aventures. Intituler le métrage Star Trek : le film, fait d'ailleurs augurer d'un dernier baroud d'honneur, la conclusion de la série sur grand écran. Qui aurait pu imaginer que presque 50 ans après la série, un nouveau film serait encore en préparation ?
L'histoire de la naissance cinématographique du film, tirée de la série de science-fiction humaniste de Gene Roddenberry, est sans nulle doute plus passionnante que le film qui en a résulté. Souhaitant porter la mythologie Star Trek à l'écran dès le milieu des années 70, Paramount mise d'abord sur un projet de long-métrage, Star Trek : Planet of the Titans, dans lequel l'équipage du vaisseau Enterprise était opposés à leur ennemis classiques, les Klingons, autour d'un peuple antédiluvien, point d'origine de tous les autres, les Titans. Au détour d'un voyage dans le temps, l'équipage de Kirk se retrouvaient à incarner ces fameux Titans. Envisagé jusqu'au alentours de 1977 puis annulé, le projet laisse la place à une nouvelle série télé, baptisée Star Trek : Phase II, qui ira beaucoup plus loin dans sa phase de pré-production, le casting, scénarios et les storyboards ayant été produits (quelques-uns de ces derniers ont été utilisés dans la série Star Trek : The Next Generation). Quatre semaines avant le début de la production, la série est elle aussi annulée, mais le succès de Star Wars au cinéma ne peut laisser les exécutifs de Paramount insensibles. Un des scénarios écrits pour la série mort-née fut donc l'idée de départ de ce Star Trek : le film, qui est le seul de la série cinématographique à avoir été envisagé en indépendant, sans fin vraiment ouverte pour la suite des aventures. Intituler le métrage Star Trek : le film, fait d'ailleurs augurer d'un dernier baroud d'honneur, la conclusion de la série sur grand écran. Qui aurait pu imaginer que presque 50 ans après la série, un nouveau film serait encore en préparation ?
Les débuts atypiques du film se retrouvent par bribes dans ce que l'on connaît aujourd'hui comme le premier opus d'une longue saga. Le capitaine Decker (Stephen Collins, qui officiera de longues années en tant que pater familias dans l'inénarrable série 7 à la maison) commande L'Enterprise ; enfin, avant l'apparition de William Shatner, qui tient dur comme fer à redevenir le capitaine de son vaisseau. Leonard Nimoy (Spock) ne devant pas réapparaître dans la série, a du se faire prier pour le film et figure en bonne place, d'abord dans une belle séquence sur Vulcain. Ce n'est que plus tard, profondément changé (reconnaissant sa part d'humain), qu'il embarquera à bord de l'Enterprise, dégageant du même coup le pauvre Decker, déjà rétrogradé du rand de Commandant à officier scientifique. Star Trek, comme toute saga, se doit d'avoir à chaque opus sa Trek Girl ; il s'agit ici de la regrettée Persis Khambatta, très bien dans son rôle d'alien au physique renversant.
Le film entend tisser des liens étroits avec la série-mère ; plus que la continuité de la mythologie, Star Trek : le film va jusqu'à reprendre de façon éhontée le script d'un épisode de la saison 2, Le Korrigan (The Changeling). Nomad, une intelligence artificielle y attaque l'Enterprise, et dit vouloir "rencontrer son créateur", tout en analysant toutes les "unités carbones" (comprendre les êtres humains) du vaisseau. Pour le film, la menace est amplifiée, l'entité mesurant plusieurs unités astronomiques (la distance Terre-soleil) et concerne la Terre entière, mais une majeure partie des éléments est commune. Pour asseoir sa puissance, l'entité s'offre en ouverture un vaisseau romulien, grands méchants classiques. Et, même si ce n'est précisé dans le film (mais ça l'est dans le scénario), Decker n'est autre que le fils de Matt Decker, commandant malheureux dans La machine infernale, épisode 6 de la saison 2 de la série originale.
Choisir Robert Wise (Le jour où la Terre s'arrêta, La maison du diable, etc.), réalisateur versatile dans la tradition hollywoodienne, ainsi que Douglas Trumlbull (2001, l’odyssée de l'espace) pour les effets spéciaux (après que John Star Wars Dykstra et sa société Apogée ait été remerciés) est important pour comprendre que le film devient, sous son égide, un trip métaphysique sur l'origine du monde qui pourrait en déconcerter plus d'un, notamment par sa propension à la lenteur. D'un côté, Trumbull réalise de splendides trucages optiques, épaulés par la musique orchestrale de Jerry Goldsmith, qui donne un réel sens du spectacle aux aventures spatiales du groupe. De l'autre, Wise organise son film de manière à privilégier non pas l'action, mais de larges plages de déambulations spatiales, dont on peut être agacé. En effet, entre la découverte d'un Enterprise new-look et une promenade dans les entrailles de "l'autre", entité qui se nomme elle-même V'Ger, on aura déjà passé 45 minutes ! On aurait pu être alerté par Le mystère Andromède (1971), film paranoïaque d'espionnage sur fond de SF, où Wise et Trumbull coopérait déjà pour un résultat d'une lenteur presque surhumaine. Le reste n'apparaît pas d'importance notable, si ce n'est l'obsession de Kirk pour l'Enterprise, qui veut le faire décoller dans la minute alors qu'aucun test tehnique n'a confirmé la fiabilité du vaisseau, et qui vire Decker sans ménagement.
On retiendra pour note finale une certaine incompréhension quant à avoir repri une trame existante bien connue des passionnés, ceux pour qui le film était a priori dédié. Plus encore que cela, tout le mystère du film repose sur le nom de l'entité, V'Ger ; on se demande bien comment la machine, qui ne va pas lire son nom sur son propre corps, peut induire en erreur l'équipage quant à sa véritable identité. Cette erreur fait partie, elle aussi, de l'histoire peu commune de premier Star Trek cinématographique...